La réalisatrice au bord

Le style caractéristique du cinéma d'Alice Rohrwacher est reconnaissable dans son désir d'explorer en profondeur l'âme humaine et ce qui transcende l'aspect matériel de la vie.
Quatre longs métrages, cinq courts métrages, trois documentaires « collectifs » : une filmographie essentielle, primée à de nombreuses reprises, précise, qui exprime non seulement une production artistique inspirée, mais aussi une manière d'appréhender le quotidien, dans une continuité entre l'existence et la représentation, entre la pensée et son expression.
Des convictions qui caractérisent la vie et deviennent des « manifestes » dans les films de cette réalisatrice originaire d'Ombrie, peut-être plus appréciée et reconnue à l'étranger qu'en Italie.
Le sacré, l'ailleurs, le spirituel sont les thèmes qui animent ses histoires, qu'il s'agisse de longs ou de courts métrages. Son regard transcende les apparences, dans un flux de personnes, de situations, d'histoires, d'expériences qui parfois au rythme d'un pas de danse, souvent dans de pénibles progressions, recherchent une forme de salut.
La vie d'une communauté paroissiale qui tente de maintenir en vie les formes du sacré, mais en égare le cœur et le sens, a été au centre de ses débuts fulgurants et très réussis avec Corpo celeste, qui doit beaucoup au recueil d'écrits d'Anna Maria Ortese du même nom.
Mais on retrouve aussi ces thèmes dans le court-métrage qui fit partie des cinq finalistes aux Oscars 2023, Le Pupille, où dans le style d'un conte de fées, un orphelinat de jeunes filles devient le théâtre où est représenté le sens authentique du beau, du vrai et du bon : la promesse de la bonté d'un gâteau désirable n'est pas soumise aux intérêts, aux hiérarchies, aux règles, à la morale, aux comportements éthiques, mais elle est « gaspillée » dans la gratuité des cœurs simples qui la reçoivent sans mérite en don comme une « grâce ». Un gâteau qui ne peut pas être une monnaie d'échange pour des faveurs, mais qui tombera par terre, du ciel, et sera le festin des humbles, des ramoneurs.
La relation entre l'homme et la nature, la façon dont l'homme peut être le protagoniste de la création, est la force motrice du court métrage Omelia contadina, une réflexion artistique qui se révèle en parfaite harmonie avec l'encyclique Laudato si' du Pape François.
L'humanité est appelée à préserver et à cultiver le jardin qu'est le monde, comme le raconte le livre de la Genèse, comme Alice elle-même le fait dans sa chère campagne d'Ombrie entre un tournage et un autre, dans ce travail ininterrompu de l'existence qui s'écoule de manière inséparable entre la vie et l'art.
Son rapport au visible est égal à celui avec l'invisible. Elle l'a prouvé avec La Chimera, son dernier long métrage sur la recherche douloureuse et spasmodique du contact entre le monde terrestre et le monde de ceux qui désormais ne sont plus là.
Alors que tout est marchandisé par la société contemporaine et que la soif d'argent tient l'humanité en otage, la véritable essence de toute expérience humaine se révèle dans la beauté simple et cachée, dans le soin accordé aux relations, dans les expressions artistiques, dans la mémoire qui ne constitue pas de simples « archives » mais est ce qui a touché le cœur et qui est capable de donner une direction à la vie.
C'est cette signification intime que l'on retrouve dans chacun de ses films qui a incité la Fondazione Ente dello Spettacolo, en collaboration avec le Dicastère de la Culture et de l'Education et le Dicastère de la Communication du Saint-Siège, à lui décerner le Prix Bresson en 2021.
A cette occasion, elle a elle-même défini l'âme de ses œuvres : « Ce ne sont pas des films ouvertement spirituels, mais intensément et secrètement spirituels ».
Alice Rohrwacher – qui a étudié l'histoire des religions à l'université de Turin – s'est interrogée tout au long de ses films sur la manière de représenter le sacré et de le ramener au centre de la vision, dans l'art et dans la société contemporaine.
Elle le fait en racontant des expériences de vie presque toujours intemporelles, dans un « aujourd'hui » qui est un lieu de mémoire mais aussi un « toujours » », en liant sa caméra à la terre, aux traditions, en se concentrant sur les passions, les relations entre les gens.
Comme cela se produit dans Lazzaro felice, dans le contraste entre la pauvreté et la richesse, entre l'égoïsme des maîtres et l'innocence des paysans.
Lazzaro est presque un ange qui par sa simplicité éclaire les désespérés. Si dans Corpo celeste le protagoniste s'éloigne de la société moderne par un mouvement intérieur «vertical» et tente, à travers la religion, de se rapprocher du « haut », Lazzaro, lui, se déplace « horizontalement » par un mouvement spirituel et solidaire avec ses semblables, afin de ne jamais abandonner ceux qui sont en difficulté. C'est la réponse à une humanité qui ne sait plus communiquer et se reconnaître.
Cette même humanité ayant vision restreinte se retrouve dans Le meraviglie, où les règles du père de famille créent une réalité petite, fermée, oppressante, qui entre en crise avec l'arrivée d'un groupe d'étrangers, avec l'avènement de la télévision. Dans cette histoire, seuls le sentiment et le dialogue peuvent conduire au salut. L'idée de la famille que Rohrwacher esquisse est celle d'un refuge, libre et sans modèle, que chacun devrait avoir et dont chacun a besoin, révélant ainsi que l'être humain n'est qu'une petite partie d'un univers mystérieusement fascinant et infini.
Si Corpo celeste fait référence à la foi, La chimera est un film sur la capacité de l'homme à aller au-delà, à raisonner sur ce qui nous attend après la mort. Nous vivons à une époque où le matérialisme est omniprésent, où les médias sociaux veulent nous convaincre que tout doit être concret, immédiat. La chimera nous incite au contraire à réfléchir à ce qui échappe aux yeux. Il s'agit d'une enquête sur la façon dont nous concevons « l'invisible ». Des pilleurs de tombes affrontent le passé, le violentent, rompent le lien de respect avec l'au-delà. La mémoire fait son chemin, une prière sur le respect naît. L'invitation faite aux nouvelles générations est de réfléchir non seulement à ce qu'elles veulent devenir, mais aussi à ce qu'elles veulent laisser derrière elles.
Alice Rohrwacher s'interroge aussi sur les jeunes, comme elle l'a fait en participant à Futura, le documentaire tourné à six mains avec Francesco Munzi et Pietro Marcello. C'est un voyage à travers les rêves et les peurs de chaque génération, sans jamais abandonner une veine romantique. La grande question de notre temps se trouve peut-être déjà dans son dernier titre : quelles sont les chimères aujourd'hui? Tout ce que qu'on n'arrive pas à atteindre, le mirage d'un horizon meilleur à construire. Pour Alice Rohrwacher, la réalité n'a pas à tendre vers une perfection géométrique et formelle, artificielle, mais même au risque de paraître « de travers » (comme sa manière de filmer), elle a besoin d'être transfigurée en conte de fées, donnant la possibilité d'une réflexion universelle sur cet ailleurs qui donne sens aux expériences et est capable d'en remodeler la forme.
Davide Milani
Prêtre, président de la Fondazione Ente dello Spettacolo et directeur de la Rivista del Cinematografo









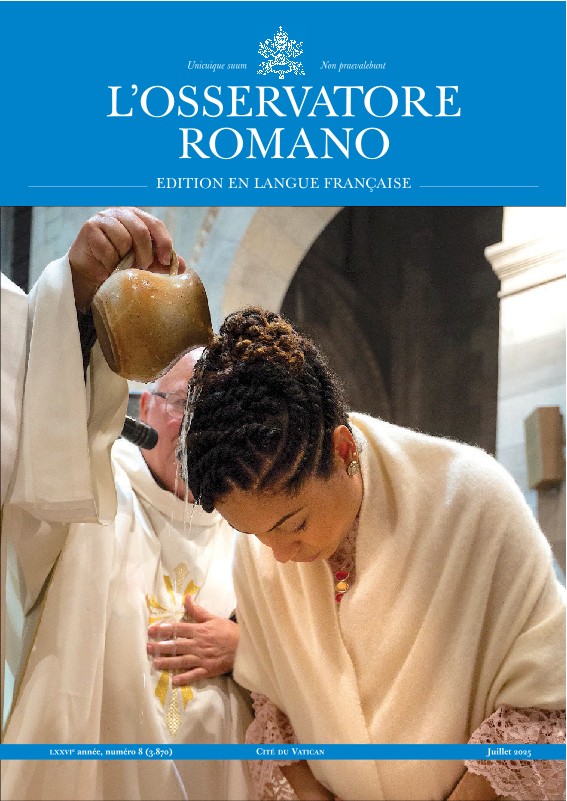



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
