
La figure de Jeanne d'Arc, surnommée la Pucelle d'Orléans, attire les «conteurs» de tout genre : romanciers, acteurs de théâtre et cinéastes abordent le mystère de sa vie avec fascination. La sainte présente des traits extraordinaires : une riche humanité animée par une foi inébranlable la pousse à accomplir des actions hors du commun, inimaginables pour une adolescente du XVe siècle, fille de paysans et analphabète. Elle est l'une des héroïnes de l'Histoire les plus représentées sur le grand écran. Les chefs-d'œuvre vont des débuts du cinéma - le mémorable Domremy : La maison de Jeanne d'Arc (1899) des frères Lumière - au récent et merveilleux Jeanne (2019) de Bruno Dumont.
Née vers 1412 en Lorraine, Jeanne affirme entendre des voix mystérieuses dès l'âge de 13 ans. Saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite lui demandent de libérer la France de l'occupant anglais et de faire couronner le dauphin Charles VII. A 16 ans, ayant obtenu une armée alors qu'elle n'a aucune expérience militaire, elle libère en seulement huit jours Orléans, assiégée depuis sept mois. Elle obtient ensuite le couronnement de Charles VII à Reims. Mais, abandonnée par le roi de France, elle est faite prisonnière et livrée aux Anglais. Après un an d'emprisonnement, en 1431, elle est condamnée comme hérétique et brûlée vive à Rouen à l'âge de 19 ans. Béatifiée en 1909, elle est canonisée en 1920 par Benoît XV. En 1922, Pie XI la proclame patronne de la France.
Pourquoi Jeanne d'Arc est-elle encore en mesure - en France, et ailleurs - de fasciner et émerveiller et pas seulement dans le monde catholique?
Il y a deux raisons principales, évoquées dans les nombreux films consacrés à la Pucelle d'Orléans.
Tout d'abord, la sainte est le symbole d'une femme courageuse et inculte, capable de s'affranchir de sa condition et de ses devoirs respectifs. Il est impensable pour une femme de l'époque, qui plus est fille de paysan, d'accéder à des postes de commandement militaire. Jeanne monte à cheval, lance des ordres et porte une épée : son obstination à porter des vêtements masculins lui est reprochée tout au long du procès comme une grave hérésie contraire à la loi naturelle.
Deuxièmement, la situation de la jeune femme - analphabète et porteuse d'une Parole divine - ébranle la position de pouvoir de la hiérarchie ecclésiastique, malgré le fervent désir de communion de la femme avec l'Eglise exprimé à plusieurs reprises au cours du procès.
Ces deux dimensions - la portée socio-révolutionnaire de Jeanne et son opposition farouche à la hiérarchie ecclésiastique - sont omniprésentes dans les nombreux films consacrés à la Pucelle d'Orléans. La diversité des approches cinématographiques offre une grande richesse de points de vue, en mesure de parler à des publics de tous horizons.
Certains films ont relevé le difficile défi de raconter sa vie, de sa jeunesse à sa mort sur le bûcher. Parmi eux, trois grands colosses du cinéma méritent d'être cités.
Jeanne d'Arc (1948) de Victor Fleming est un biopic hollywoodien classique, édifiant, avec une «atmosphère maniéristique» de péplum biblique au service de l'actrice principale, une Ingrid Bergman radieuse, au sommet de sa carrière. Les ciels rouge-incandescents et la composition des plans rappellent son film précédent Autant en emporte le vent (1939). Jeanne-Bergman se distingue par son humilité et sa fragilité, malgré ses glorieux succès.
Le film Sainte Jeanne (1957) d'Otto Preminger, tiré d’une pièce de théâtre de George Bernard Shaw et mis en scène par Graham Green, est également d'origine hollywoodienne. Certaines interprétations du texte théâtral confèrent originalité et fraîcheur au film. Jeanne (une belle et talentueuse Jean Seberg) revient du ciel pour réconforter Charles VII. C'est l'occasion de reparcourir ses aventures avec quelques-uns de ses anciens compagnons, morts ou vivants. Non sans quelques accents miraculeux, comme la présence d’une jeune fille, habile à encourager le Dauphin de France à assumer ses responsabilités. D'abord sûre d’elle-même, le procès mettra à dure épreuve ses certitudes.
La même ambition de suivre les gestes de la sainte, de l'enfance au martyre, caractérise également le film Jeanne d'Arc (La Messagère) de Luc Besson (1999). Une production française, mais avec un casting hollywoodien allant de John Malkovich à Dustin Hoffman, qui dépeint une Jeanne (interprétée par Milla Jovovich) comme une super-héroïne et une combattante féroce. Le mysticisme de la sainte est « violemment » explicité à travers la représentation de certaines de ses visions : ce qui domine est une esthétique de jeu vidéo.
D'une toute autre nature sont deux films, deux pierres milliaires dans l'histoire du cinéma et indispensables à la représentation cinématographique de la Pucelle d'Orléans : La Passion de Jeanne d'Arc, film muet de Carl Theodor Dreyer (1928) et Le Procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson (1962). Les deux films sont unis par l'intention de limiter la narration aux actes du procès et à la mort de Jeanne sur le bûcher. L'œuvre de Dreyer évoque la conformation progressive de la sainte au Christ, volonté rendue évidente par le choix du titre et les nombreuses croix, cadrées avec insistance dans les séquences précédant son martyre. La matérialité des corps et des visages (gros plans véhéments sur le visage non maquillé de l'actrice Renée Falconetti) et l'utilisation de la lumière illuminent le film de mysticisme et de sacralité. C'est un cinéma essentiel et intense, la puissance expressive des images étant renforcée par l'absence de son.
Le chef-d'œuvre de Bresson est tout aussi fort, malgré la différence radicale de style.
Jeanne est interprétée par Florence Delay, actrice non professionnelle. Elle est l'une de ses «modèles», terme utilisé par le réalisateur pour désigner ses acteurs et actrices : le refus du jeu d’une récitation expressive suggère la vérité des gestes et des regards. Dépouillé de toute dimension spectaculaire, adhérant à la réalité historique des minutes du procès, son cinéma « par soustraction » place l'homme devant la réalité nue, devant les données les plus pauvres. Son « essentialité interrogative » suggère la présence d'un autre monde, perceptible dans la plus simple matérialité. C'est peut-être la meilleure façon de suggérer le mystère de la vie de la sainte et de sa relation avec Dieu.
Le poétique Jeanne au bûcher (1954) de Roberto Rossellini, tiré d’un texte de Paul Claudel, mérite en outre d’être mentionné. Dans le rôle de la sainte, on retrouve une Ingrid Bergman plus mûre. Une fois au ciel, Jeanne rencontre saint Dominique : c'est l'occasion d'évoquer - avec un style théâtral - les principaux événements de sa vie et l'injustice dont elle a été victime.
Enfin, il vaut la peine de souligner deux films récents - époustouflants par la fraîcheur du langage et la force expressive - du réalisateur français Bruno Dumont, lauréat cette année du Prix du jury au Festival du film de Berlin avec L’Empire. Le premier, Jeannette (2017) est un opéra-rock sur l'enfance de Jeanne d'Arc, une comédie musicale dotée d'un lyrisme capable d'évoquer, pour le grand public d'aujourd'hui, le monde intérieur de la sainte. Le second, Jeanne (2019), suit Jeanne de ses combats à sa mort sur le bûcher. L’actrice principale des deux films est Lise Leplat Prudhomme, âgée de dix ans au moment du second film : c'est une petite fille en armure, hors du temps et dotée d’un puissant éclat de lumière et de mystère.
En conclusion de ce bilan (incomplet), soulignons combien le cinéma de Bresson et celui de Dumont présentent deux manières opposées et efficaces de suggérer l'insaisissable grandeur de Jeanne d'Arc : d'une part, l'essentialité la plus pure ; d'autre part, un langage original et contemporain, éloigné d'une vision historico-réaliste.
Piero Lorendan
Prêtre, étudiant en théologie au Centre Sèvres de Paris - Rivista del Cinematografo









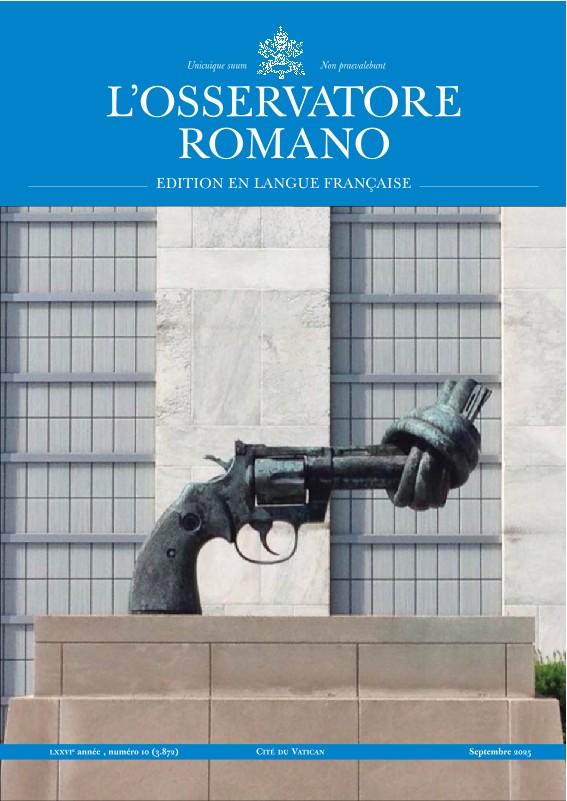


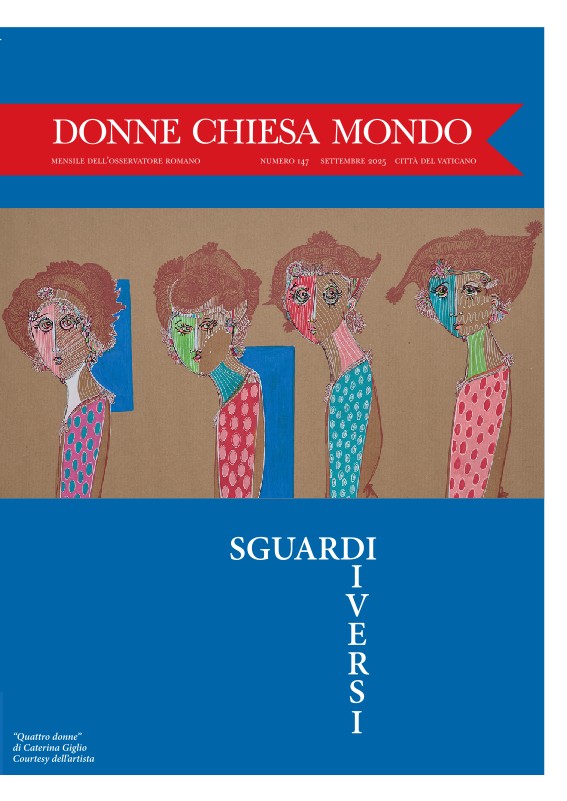
 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
