
Dans le vieux quartier populaire de Matonge à Kinshasa, dix-huit millions d’habitants, capitale de la République démocratique du Congo, il y a une maison qui accueille des enfants dits sorciers (ndoki), gérée par la Compagnie de Jésus. Ce sont des enfants des rues (bashege), avec une stigmatisation supplémentaire dont ils se convainquent parfois eux-mêmes, comme Shada, qui raconte: «Nayibaka, naza diable, motema mabe, moi je suis pas un pasteur» («Je vole, je suis le diable, j’ai un cœur mauvais, je ne suis pas un pasteur»). Selon l’anthropologue Jourdan, «les enfants sorciers et les enfants soldats sont devenus des figures ordinaires du panorama social: victimes et acteurs dans le même temps, ces nouvelles formes d’enfance, difficile à situer».
Ce sont des enfants accusés d’être sorciers, dont la seule présence est considérée comme la cause des maux de la famille: cancer, perte de travail, sida, séparation. Il est important de souligner que dans diverses traditions locales, une maladie ou un problème ont une base culturelle/relationnelle: une offense aux ancêtres, la violation d’un tabou, des influences négatives de la part d’autres personnes. Dans certains cas, parmi ces autres personnes, il peut y avoir un enfant: son propre enfant. Si les soupçons sont confirmés, on a recours à des pratiques de libération accomplies par des guérisseurs traditionnels ou par des mouvements religieux, appelés «Eglises réveillées ou de réveil», qui sont apparues sur le continent africain au début du xxe siècle. Il existe en effet des groupes «religieux» qui, exploitant la misère, prennent en charge des dizaines d’enfants qu’ils soumettent à une période de quarantaine, de purification physique et rituelle; ils sont ensuite soumis à des interrogatoires, également en présence des parents, suivis d’un moment de confession publique (l’enfant admet avoir mangé des personnes), devant le «pasteur» qui accomplit ensuite un rite de libération.
Dans d’autres cas, il peut arriver que quelqu’un donne de la nourriture «empoisonnée» à l’enfant, qui peut transmettre la sorcellerie (par exemple, quelqu’un offre une mangue, mais en réalité il s’agit de chair humaine sous une apparence camouflée), surtout pour des raisons de kimpela (jalousie). A la fin, si, après le rite de libération, le problème persiste, il ne reste à la famille qu’à éloigner «le mal».
C’est pour cette raison que des centaines d’enfants sont abandonnés au destin d’une vie dans la rue, et c’est là que les agents sociaux du Centre Monseigneur Munzihirwa, à Kinshasa, les prennent en charge. Comme l’explique le père Olivier Mushamuka Ziganira, jésuite et responsable de deux centres d’accueil pour enfants, «l’hospitalité est temporaire; notre devoir est de faire comprendre aux familles que l’enfant n’est pas un sorcier, mais un fils. Pendant plusieurs mois, nous nous plongeons dans les histoires tragiques de ces enfants, nous nous battons contre leurs angoisses, leurs peurs, leurs espérances, jusqu’à ce qu’ils atteignent ce lieu que nous appelons tous communément maison».
A partir du jeu, les enfants racontent leurs histoires à travers des dessins, des jeux, des paroles: «La cause de cet abandon est la pauvreté, et les divorces; dans aucune de leurs histoires n’est présent un couple de parents, et parfois, les pères et mères de ces enfants vivent eux aussi dans la rue». Toutefois, il s’agit également d’un phénomène typiquement urbain, qui a connu une accélération avec la croissance des villes: le passage du village à la modernité. Les figures centrales de référence ont été perdues, comme celles du chef du village, en général également guérisseur, sorcier, en mesure d’apporter un soutien et un sens aux événements importants de la vie. De plus, la ville a apporté ce que les anthropologues appellent la «déparentalisation»: le village qui éduque l’enfant est absent et il y a souvent une mère seule et pauvre.
Les enfants de rue et les enfants sorciers sont l’une des conséquences de ce changement: celui qui naît, écrit Henri Collomb, vient de quelque part; dans les villes, on ne sait plus d’où l’on vient ni où l’on va, tout au moins jusqu’à ce que l’on trouve une maison à Matonge.
Fabrizio Floris









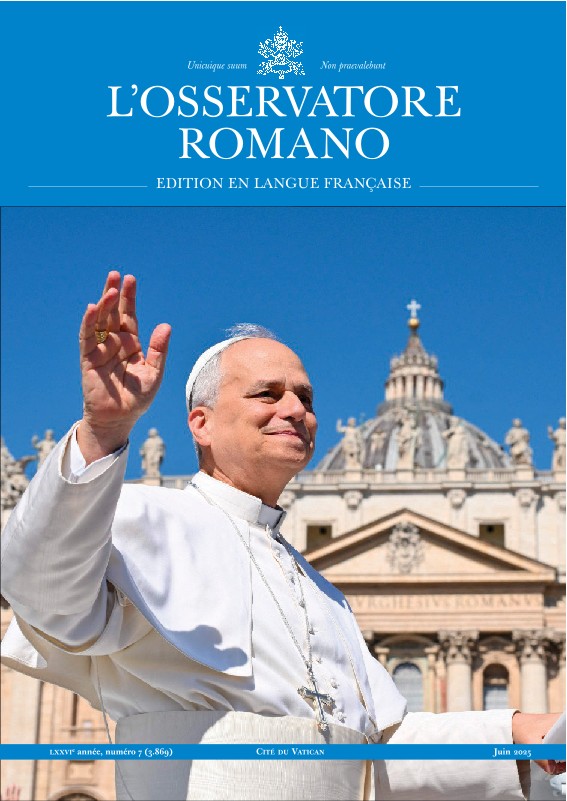



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
