Ce mois-ci

Dans l’une de mes dernières conversations avec Silvano Maggiani, célèbre liturgiste italien décédé il y a deux ans, je lui confiais mon malaise à participer à la liturgie. Je lui disais que tout me semblait faux : les gestes, les paroles, les vêtements... Si je regarde autour de moi, ajoutais-je, je vois des gens qui s’ennuient, de moins en moins nombreux, et qui sont là par habitude... Bref, pas de joie, pas de communauté, rien qui touche vraiment les personnes présentes, y compris le célébrant, lui aussi peu convaincu et peu convaincant. Je disais cela avec douleur. Il m’a répondu que ce malaise était aussi le sien. Cet homme de mon âge avait vécu le début de la réforme liturgique de Vatican II, les années d’expérimentation et d’enthousiasme, sous le signe de la noble simplicité à laquelle les rites devaient être restitués et sous le signe de la participation actuosa, créative, du peuple de Dieu dans la symphonie active de ses charismes-ministères.
Près de 60 ans se sont écoulés depuis la promulgation de Sacrosanctum Concilium, la magna carta de la réforme liturgique, et, en regardant autour de soi, on constate que cette avancée, cet effort, n’ont pas suffi, ne serait-ce que parce que tout est en perpétuel mouvement et demande une adaptation constante et flexible. Sans parler des nostalgiques de l’ancien rite.
Oui, la célébration liturgique constitue aujourd’hui un grand, très grand problème. Et l’un de ses nœuds concerne les femmes. En effet, une dystonie du « genre » s’y observe de façon évidente.
Leur participation n’a jamais été facile. Ayant quitté l’ekklesia kat’oikon, l’Eglise dans les maisons, où elles ont peut-être aussi présidé la Cène, elles ont le plus souvent été repoussées dans les limbes de la non-participation, comme les laïcs du reste. Augustin témoigne de la séparation des hommes et des femmes dans la nef et la justifie par l’entrelacement des voix masculines et féminines. Chrysostome, quant à lui, affirme que ce n’était pas le cas à une certaine époque et regrette que l’on se soit éloigné du style des communautés plus anciennes.
Certes, le lien entre les femmes et la prière n’est pas rompu, et d’ailleurs, la vie commune, d’abord informelle, puis institutionnalisée dans des formes communautaires, inscrit la louange dans leurs devoirs. Leur tâche est la sanctification du temps ; et comme elle est caractérisée par l’usage des Psaumes et des Ecritures, c’est grâce à cette tâche « liturgique » qu’elles sont obligées de savoir lire et écrire. C’est ainsi que naîtra cette théologie féminine dans laquelle excellent d’illustres moniales.
C’est ainsi, par exemple, que dans la paix du monastère de la Sainte-Croix, la diaconesse Radegonde commande à Venance Fortunat l’hymne que nous chantons encore aujourd’hui le Vendredi saint. Et plus tard, avec une créativité géniale, la grande Hildegarde écrit le déroulement du rite, le texte et la musique pour son monastère. On trouve également des traces de créativité liturgique monastique en Orient. L’hymne chanté aujourd’hui encore dans le rite byzantin du mercredi saint est attribuée à Cassienne, celle qui faillit être l’épouse de l’empereur Théophile...
Cette inventivité et cette fonction orante, celle-là même qui, aujourd’hui encore, confie le livre de la Liturgie des Heures aux moniales dans le cadre du rite de la Profession, ne se retrouvent pas dans l’exercice d’un ministère liturgique féminin. Pourtant, surtout en Orient, les diaconesses ont existé. Leur fonction principale, celle-là même qui a conduit plus tard à leur déclin, était l’onction des femmes au moment du baptême. En vérité, elles faisaient aussi d’autres choses. Mais nous n’avons aucune preuve irréfutable de leur ministère, même si nous savons qu’elles comptaient parmi les membres du clergé.
De pâles traces de leur service subsistent dans les formules relatives à la profession religieuse et monastique et dans le privilège des abbesses de chanter/proclamer l’Evangile dans le contexte de leur communauté.
Aujourd’hui, rien ne subsiste de tout cela. Si la perception et le statut des femmes dans l’Eglise ont beaucoup changé, elles restent marginales par rapport à la liturgie. Seuls les hommes la président, sauf dans le cas d’une célébration dominicale en l’absence d’un prêtre. Depuis peu, les femmes sont admises aux ministères de lectorat et d’acolytat, c’est-à-dire à proclamer les lectures et à servir à l’autel. Des tâches dont elles ont longtemps été exclues en raison de leur sexe, considéré comme inadapté au ministère liturgique. Ce n’est pas un hasard si, dans les dispositions relatives à la musique sacrée, Pie X, au début du XXe siècle, les a privées du chant, qu’il considérait à juste titre comme un ministère.
Il serait néanmoins réducteur d’attribuer le malaise à la seule absence ministérielle des femmes. Le problème les touche – et pas seulement elles – en termes de langage. Nos euchologies, l’ensemble des prières, enracinées dans un patriarcalisme aveugle, en reproposent les stéréotypes culturels. Si l’on prête attention à la déclinaison de Dieu « père », on constatera que c’est le pater familias de l’ancienne mémoire qui est invoqué/évoqué, émule et substitut du pater deorum. Il en va de même pour l’adjectivation de Dieu, pour l’aura sacrée qui l’entoure.... Il reste bien peu de choses de Celui que Jésus de Nazareth invoquait comme abba, père, renversant ainsi toute hiérarchie patriarcale. La nomination des saintes, à l’exception des martyres, liée à des stéréotypes de genre, est également problématique. Les thèmes du sacrifice, de la satisfaction, du péché, des hiérarchies entre les hommes et les femmes nous paraissent encore plus difficiles et lointains... Je crois que pour la plupart des gens, le langage de nos liturgies est pour le moins étranger. La rupture des lieux traditionnels de transmission de la foi a rendu incompréhensibles d’anciennes et belles métaphores... Il nous faudrait pour le moins un traducteur ! Sans parler des homélies, elles aussi distantes, qui tentent désespérément de toucher et de stigmatiser le présent, sans jamais chercher à donner la clé du rite célébré.
Soyons clairs, le rituel est inscrit dans notre structure anthropologique. Et, de fait, nous célébrons une infinité de rites laïcs. Nous parlons même de liturgie du stade en renversant la métaphore. Ce n’est donc pas le rite qui est en cause. Le verbe célébrer implique la réitération d’une action et leithurghia résulte de laos (peuple) et urghia (action). En toute rigueur, il devrait donc s’agir d’une action impliquant l’ensemble du peuple de Dieu, hommes et femmes, qui rendent ensuite un culte au Père par le Christ et dans l’Esprit. Mais, en dehors de notre cercle restreint, qui comprendrait ce dont je parle ?
Nos églises se vident, les femmes d’âge mûr, les jeunes, garçons et filles, ne les fréquentent plus, certainement à cause de la fracture qui a fait perdre le code de reconnaissance et de l’église édifice et de l’église de pierres vivantes que nous sommes.
En effet, un seul nom relie l’édifice et le mystère. A strictement parler, c’est d’ailleurs l’édifice lui-même qui devrait fournir le code de signalétique du mystère : l’autel est le Christ, l’ambon est le monument de la résurrection, le baptistère est le lieu de la renaissance. On devient chrétien dans la synergie de Parole et d’Esprit, d’Eau et d’Esprit ; et le lieu mémorial de cet accomplissement est l’Autel, la table préparée pour partager le Corps et le Sang du Seigneur.
En somme, nous sommes invités à un banquet festif, qui exige une connaissance et une attention réciproques, un partage des joies et des espoirs. Et, comme dans toute fête authentique, chacun doit apporter son don pour la croissance des autres. Au lieu de cela, nous nous retranchons derrière des mots abscons, nous revêtons des parements démodés, ridicules dans certains détails ; au lieu d’être des protagonistes, nous sommes des spectateurs, des récepteurs passifs, à qui l’on offre en outre un pain sec, car non seulement nous ne participons pas à la coupe, mais nous ne participons pas non plus au pain rompu au cours de cette célébration.
Personne ne perçoit le lien qui existe entre les fidèles rassemblés et les ministères qu’ils exercent en dehors de la liturgie. Et la même ministérialité, faite également d’actions différentes (écouter, répondre, acclamer, se lever, se rassoir, aller en procession...), semble être une routine et non l’exercice d’un sacerdoce commun.
Ajoutez à cela – et le discours va bien au-delà de la partie émergée de l’iceberg de l’insatisfaction féminine – la rupture de la pandémie, la prétention cléricale à célébrer en l’absence du peuple, l’horrible exposition médiatique de messes insignifiantes, honteusement négligées ou théâtrales. Et, ensuite, l’idée qu’après tout, la présence physique n’est pas nécessaire : on peut participer à l’Eucharistie même à distance, éventuellement en récitant l’horrible formule de la communion spirituelle...
La liturgie est véritablement une « Eglise en devenir », comme l’a dit Crispino Valenziano, qui a enseigné pendant de nombreuses années à l’Institut liturgique pontifical Saint-Anselme à Rome ; il est véritablement nécessaire d’entreprendre une « réforme de la réforme », comme l’a dit Adrien Nocent, moine belge, l’un des plus grands experts en liturgie, qui a été impliqué dès le début dans la préparation et la mise en œuvre de la réforme liturgique voulue par le Concile Vatican II... Il faut réinventer la liturgie et faire place à la créativité et à de nouvelles subjectivités. Peut-être que, si nous le voulions, même les liturgies dites féministes, dans leur revendication impérieuse de la corporéité et de la nature, pourraient suggérer un autre panneau indicateur qui n’a pas besoin d’être médiatisé.
Après tout, le « en mémoire de moi » a scellé la Cène du Seigneur, mais bien avant cela, il a scellé, au féminin, le geste d’onction de la femme non nommée – gestes et événements accomplis dans l’intimité ecclésiogénétique d’un foyer ! Nous avons besoin de cela et nous avons besoin de parfum et donc d’odeurs, de goût, de vue, d’ouïe, de toucher. Nos liturgies doivent revenir à l’expression de la corporalité du salut. Nous sommes le corps du Christ et ce n’est pas une métaphore.
Cettina Militello
Théologienne, vice-présidente de la Fondation Accademia Via Pulchritudinis









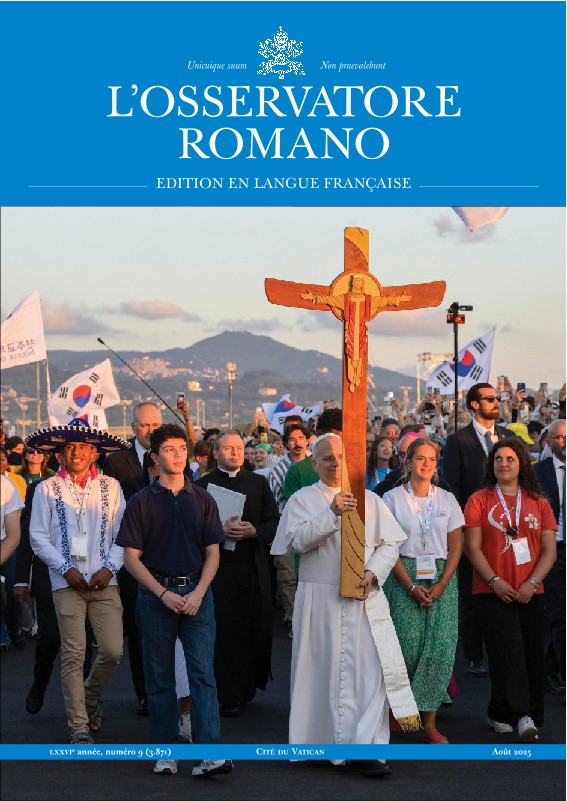



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
