Le témoignage

J’enseigne l’italien aux étrangers dans une école du soir à Padoue. La perception constante est que je suis leur première interlocutrice et eux sont les miens. Pas immédiatement, pas toujours. Par exemple, la jeune fille nigérienne qui s’appelle Cindy, dans les premières semaines, n’arrivait pas à regarder mon visage et détournait constamment son regard. Parfois, elle mettait ses écouteurs et écoutait son portable en souriant à quelque chose qui n’était pas nous, à ce moment-là. Un soir, j’ai rendu les épreuves corrigées et celle de Cindy s’était bien passée. « Tu es douée », lui ai-je dit. Alors, elle a levé les yeux, et nous nous sommes reconnues. La majorité est arrivée en Italie parfois depuis quelques mois seulement, ou bien depuis deux ou trois ans, mais ils n’ont jamais fréquenté d’école italienne et ne sont jamais entrés en contact de façon prolongée avec une personne du lieu comme moi. Nous nous regardons donc comme si nous étions arrivés ensemble au sommet d’une colline, chacun provenant d’une direction différente, enfin réunis dans un espace commun. C’est une rencontre qui surprend, leçon après leçon. Les étudiants asiatiques découvrent que les occidentaux consacrent un temps considérable à la salle de gym, aux chiens, aux soirées au bar avec les amis. Les étudiants occidentaux écoutent avec émerveillement que la journée des asiatiques ne comprend rien d’autre que le travail, la famille et la prière.
Et dans cet espace commun, dès le premier moment, Dieu est toujours présent. Je parle du fait que mes élèves, comme on appelle les étrangers qui suivent un cours d’italien, sont presque tous musulmans. Ils sont nés et ont grandi en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, au Liban, au Maroc, en Tunisie, en Somalie. Les femmes portent le burka si elles sont bengalaises, uniquement le hijab si elles sont indiennes, ou encore, elles portent leurs cheveux longs et libres si elles sont maghrébines. Les discussions sur Dieu et la prière sont très fréquentes, parce que l’expérience de la foi se trouve dans les choses concrètes et quotidiennes, d’une manière qui, pour les Européens, semble en partie anormale, très nouvelle.
Dans cette dimension de communauté, je réussis à me voir avec leurs yeux. Je porte des jeans, je viens en voiture à l’école, je ne suis pas mariée et je n’ai pas d’enfant. Une femme sans famille, pourquoi ? Qu’est-ce qui a pu arriver ? Et pourtant, la plus grande surprise est arrivée lorsque j’ai répondu à une nouvelle question, pour eux cruciale. Je ne prie pas mon Dieu ? Qu’est-il arrivé de si grave ? Un soir, le groupe est réduit et les thèmes de l’unité didactique conclus ; nous nous mettons donc en cercle pour bavarder. Il est prévu dans le programme qu’on explique aux étudiants les traditions de Noël et de Pâques, y compris les coutumes qui ne sont pas directement liées à la religion, mais aux racines antiques et païennes comme l’arbre illuminé, les œufs, les lumières qui ornent les villes. Voyez, ai-je indiqué sur le tableau numérique, ceci est la Palestine. C’est un lieu nouveau pour beaucoup d’entre eux, nés en Inde ou aux alentours. « C’est ici que Dieu est né dans une mangeoire, à côté de deux animaux qui réchauffaient son berceau de paille ». Ils m’écoutent avec un grand intérêt. Puis, dis-je, Jésus a commencé à prêcher. Il racontait des histoires pour faciliter la compréhension on les appelle des paraboles. « Raconte-nous-en une », me demande Kazhi, le jeune homme bengalais. Je raconte donc la parabole de la femme adultère qui était sur le point d’être lapidée, une de mes préférées. Je demande à mon petit groupe d’étudiants : « Et vous, qu’auriez-vous fait ? ». Mon étudiante indienne conserve un sourire énigmatique. Elle est combattue. La femme a mal agi, elle a commis un fait impardonnable. « Jésus », dis-je, « dit qu’il est facile de prier pour nos amis. Et que c’est pour cela qu’il faut prier pour nos ennemis ». « Mais vous, professeure, vous ne priez pas », me rappelle le jeune homme pakistanais. Khalid n’a que dix-neuf ans, il en a passé six à marcher du Pakistan à l’Italie. Il a réussi à conserver ses habitudes et sa foi comme un caillou précieux conservé dans sa poche.
L’étudiante nigérienne Cindy est pentecôtiste et intervient : « Dieu regarde le cœur des hommes et des femmes, il voit s’il est bon. C’est cela qui compte ». Le jeune homme du Liban se tait parce qu’un jour il m’a confié qu’il ne prie pas et n’observe pas le Ramadan ; pourtant, il croit que Dieu existe. Pour lui aussi il est important de discuter, c’est pourquoi il dit : « Quand je vois une forêt, un fleuve, le ciel étoilé, il m’est impossible d’imaginer qu’il n’existe pas un Dieu qui a créé tout cela ». Il s’est lié d’amitié avec l’étudiant somalien, qui en quelques années, a parcouru toute l’Europe à la recherche d’un lieu sûr, il a trois enfants qui vivent en Suède et qu’il ne peut pas voir parce qu’ils ont découvert qu’il a laissé ses empreintes digitales en Italie et donc, selon la loi, il doit demander l’asile dans ce pays qu’il connaît à peine.
Le garçon somalien, Hassan, ne comprend pas l’utilisation du vin dans la liturgie. Quand Pâques approche, je leur parle de la Cène et entre temps, je cherche une image du Cénacle de Leonardo de Vinci. « Bien qu’il sache ce qui est sur le point d’arriver, Jésus prend le pain – vous le voyez sur la table ? ». « Jésus devient le pain qui est mangé par les fidèles ? ». Ils m’observent tout ébahis. Le garçon du Liban a étudié la littérature et enseigne l’arabe : « Comme pour les poésies, nous les comprenons à un niveau plus intime et sage que notre esprit ».
Les conversations avec mes étudiants sont parmi les plus profondes que j’ai eues. Je conclus en parlant des derniers jours de la vie de Jésus et par la crucifixion. Je montre une image du Golgotha : « Voilà pourquoi les chrétiens font le signe de la croix et disent amen ». Amen ? Ils sont stupéfaits. Amen est le mot qu’ils prononcent au terme de la prière, amin. Pendant le cours, nous trouvons souvent des mots qui sont nés et se sont développés dans des lieux très lointains, dont le son est très semblable : l’italien « babbo » et « abbu » en hindi. Nous découvrons des étymologies impensables : « sciroppo » (sirop ndt) et « ciabatta » (chausson ndt) ont un son presque identique à celui de l’italien. Et en Somalie, plusieurs mots italiens sont restés dans la langue locale, comme « gonna » (jupe ndt) ou « macchina » (voiture, ndt). Au fond, nous tissons des fils communs. Le fil qu’ils préfèrent est celui de la foi, mais il existe de nombreux autres fils : les mots, la nourriture, la gentillesse. Souvent, toutes nos trames se mêlent.
Un jour, j’ai pensé que ma classe d’italien est composée des personnes que je voudrais apporter comme exemple à mes étudiants d’alternative à l’heure de religion, dans l’institut professionnel où j’enseigne le reste de mes heures. Les jeunes de cette classe ont seize ans et sont issus de familles non-croyantes ou de familles étrangères musulmanes ou protestantes. Ils sont agités, souvent apathiques. Comme beaucoup de jeunes de leur âge auxquels j’enseigne l’anglais, ils possèdent des talents diversifiés, mais ne sauraient même pas dire lesquels, ou bien, s’ils les ont déjà identifiés, ils semblent convaincus qu’ils ne serviront à quasiment personne. Ils ne possèdent pas ce sens de la familiarité et de la communauté que je retrouve en revanche dans mon cours d’italien. Ils sont dépaysés, en particulier les Italiens. Ils ressemblent énormément au protagoniste du film que je leur ai fait voir – Will Hunting, Good Will Hunting, dans lequel un garçon vit une vie monotone et violente jusqu’à ce qu’il découvre qu’il est un génie en mathématique. Pourtant, dans le final, ce qui le préoccupe le plus n’est pas la carrière universitaire, mais trouver une façon de rester proche de la jeune fille dont il est tombé amoureux. Mes étudiants ont beaucoup aimé le film.
Dans les derniers jours du mois de mars, le Ramadan a commencé. Etant donné que mon cours commence à 20h00, mes étudiants musulmans du cours d’italien craignaient d’arriver en retard car après une journée entière de jeûne, ils doivent manger, puis prier. Kazhi, le garçon bengalais qui a trouvé un travail dans un restaurant vénitien, arrive une demi-heure en avance avec de la nourriture dans un petit sac et attend poliment que le personnel de l’école ouvre la porte de la salle où les étudiants de l’école peuvent enfin faire l’iftar, l’interruption du jeûne. Ils commencent par boire de l’eau et manger des dattes. Ils ouvrent leurs barquettes dont s’échappe une bonne odeur de nourriture. Les femmes des familles, souvent bengalaises ou marocaines, apportent de la nourriture en surabondance pour l’offrir à leurs compagnons de classe qui n’ont pas pu cuisiner parce qu’ils travaillaient l’après-midi. Tout cela a lieu dans un silence de paix tandis que de la fenêtre, le regard rencontre tout d’abord saint Antonino, l’église dans le quartier nord de Padoue qui abrite la cellule où mourut saint Antoine le 13 juin 1231, puis le ciel coloré du crépuscule.
Shaila, la jeune fille indienne, arrive lorsqu’il fait désormais nuit. « La petite », me dit-elle toujours. Elle veut dire qu’elle a dû attendre le retour de son mari de l’école pour ne pas laisser sa fille seule. Elle apporte presque toujours un récipient avec de la nourriture pour moi. Elle me raconte qu’elle étudie aussi pour passer son permis de conduire. Et elle voudrait passer son brevet d’étude. Six mois après le début du cours, nous avons appris beaucoup les uns des autres. Nous célébrons les événements de la vie. Le garçon polonais a offert des chocolats quand il a réussi à obtenir un crédit, tandis que le garçon pakistanais a annoncé qu’il s’absentera pour une opération chirurgicale. « J’ai peur », a-t-il dit. Alors, les femmes bengalaises lui ont préparé des petites boules sucrées au lait pour le réconforter.
Laura Eduati









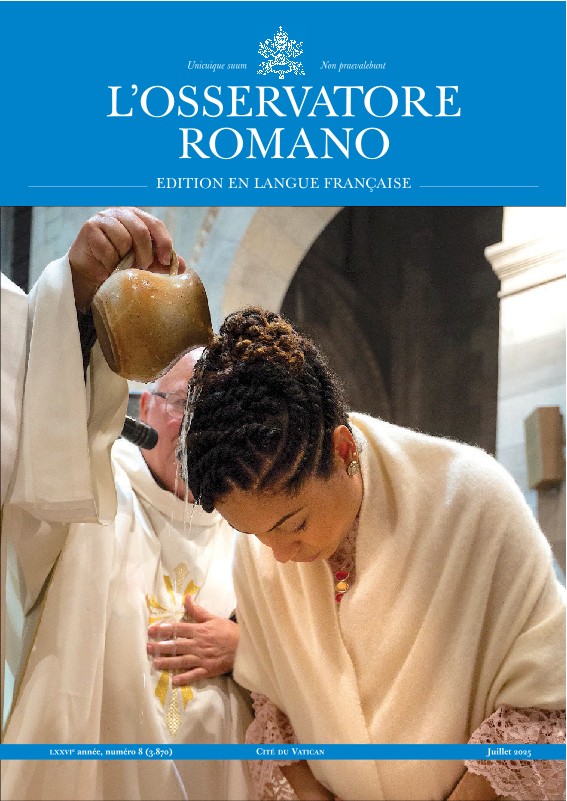



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
