Pages historiques
Et la marquise changea

Cela eut lieu le dimanche in albis du 17 avril 1814, dans une rue de Turin, la petite capitale d’un royaume enclavé entre la France et l’Italie. Le tourbillon napoléonien était passé. La jeune Juliette Colbert, héritière d’une antique aristocratie française, arrière-petite-fille de Jean-Baptiste Colbert qui avait été le puissant ministre des finances du « roi Soleil » Louis XIV de France, était l’épouse depuis huit ans du marquis Tancredi Falletti di Barolo et vivait avec lui au pied des Alpes, à Turin. Ce dimanche matin, la marquise était agenouillée au passage de la procession et entendit une voix criant du palais derrière : « Ce n’est pas le viatique qu’il nous faut, c’est de la soupe ! ». Suivirent des hurlements et des jurons.
La marquise, troublée, voulut enquêter. Elle entra impulsivement dans le palais d’où provenaient les cris et découvrit une terrible réalité. C’était une prison. Dans le cachot des détenues, la scène qui l’accueillit fut brutale. Dans ses Mémoires sur les prisons, elle écrira : « Leur état de dégradation provoqua en moi douleur et honte. Ces pauvres femmes et moi étions de la même espèce, filles du même Père, elles aussi étaient une plante des Cieux, elles avaient eu un âge de l’innocence et étaient appelées au même héritage céleste ».
Ce jour-là, la marquise de Barolo vit des jeunes femmes et des vieilles femmes, abruties, sales, vêtues de haillons, allongées sur d’immondes paillasses dans le froid et l’obscurité. Un vertige de dégradation physique et morale dont elle sortit bouleversée et fermement convaincue de devoir changer cet état de choses. De cette rencontre devait naître une expérience extraordinaire qui a changé l’histoire de la détention des femmes, d’abord à Turin, puis en Italie et enfin, en Europe. Un héritage incroyable. Juliette Falletti di Barolo avait 29 ans et n’avait pas d’enfants. Avec son mari, noble et pieux, elle se consacrait déjà intensément aux œuvres de bienfaisance. Elle était mue par une foi intense, puissante. Ce n’est pas un hasard si sa famille venait de Vendée, où elle avait guidé en secret la révolte contre les révolutionnaires athées. Entre temps, elle s’était mariée avec le marquis italien, connu à la cour du roi de France avant la Révolution. Après plusieurs vicissitudes, ils s’étaient établis dans la propriété de l’époux. Et dans la petite ville provinciale de Turin, la marquise Juliette, belle et élégante, riche, cultivée, resplendissait de sa propre lumière. Sûre d’elle et de son bon droit, même trop.
Etablir un rapport avec les femmes en prison fut un parcours long et difficile. Elle passa de la distribution d’argent aux vêtements propres, à la distribution de la soupe. Juliette dut s’inscrire à l’archiconfraternité de la Miséricorde pour avoir accès aux cellules. Petit à petit, elle obtint de passer plus de temps seule avec les détenues. Au début, elle ne recueillait que du mépris quand elle parlait de repentir, de charité chrétienne, de prière. Mais elle ne démordait pas. Elle recueillait de l’argent, des médicaments et des vêtements, elle investissait beaucoup de ses propres moyens. Les lieux s’améliorèrent. Les logis également. Avec l’humanité arriva finalement la confiance. Et avec celle-ci, également une certaine sérénité, la disposition envers la prière, une première alphabétisation. Cinq années compliquées s’écoulèrent, mais à la fin, fut achevé « un programme de rééducation plus structuré – comme l’écrit l’historienne Simona Trombetta – selon un modèle qui exigeait avant tout obéissance et soumission, auquel devait suivre la résignation et enfin la récompense chrétienne, sous forme de petits prix à distribuer à celles qui se distinguaient dans la couture, et qui avaient suivi avec constance la prière commune et l’enseignement religieux ». Une forme très particulière d’ora et labora.
Telle fut en effet la révolution introduite par la marquise de Barolo : la prison ne devait plus être uniquement un lieu d’exclusion de la société, mais de rééducation spirituelle et dans le même temps matériel. Il fallait à ces femmes marginalisées une occupation pour s’émanciper de la pauvreté, pour être indépendantes hors de la prison et ne pas retomber dans le délit. Dans le même temps, il était indispensable d’alimenter leur renaissance intérieure. C’est pourquoi, disait-elle, elles devaient apprendre un métier, mais il était nécessaire de séparer les hommes des femmes, parce que la promiscuité était une source de scandale et de problèmes constants. La marquise signalait également qu’il fallait séparer les personnes placées sous enquête des condamnées, parce que leurs situations juridiques et leurs perspectives personnelles étaient très différentes.
Son projet fut si apprécié, et elle exerça pour sa part assurément toutes les pressions nécessaires, car elle n’était pas dénuée de caractère impétueux, qu’on lui confia la deuxième prison féminine de Turin. D’autres dames l’assistèrent. Les donations augmentèrent, à partir de celles du roi. Et l’expérience du Piémont fut remarquée hors des ses frontières. Elle reçut la visite de Francis Cunningham, beau-frère d’Elizabeth Fry, dame de Londres, philanthrope passionnée par la vie misérable des détenues, de religion quaker, animée elle aussi par une foi fervente. A partir de ce moment, Juliette et Elizabeth correspondirent souvent. Ce qu’Elizabeth Fry expérimentait à Londres, Juliette le faisait à Turin. Et réciproquement.
A Londres naquit en 1817 la British Society of Ladies for Promoting the Reformation of Female Prisoners. Quatre ans plus tard, quand la marquise était désormais prête à présenter un projet complet aux autorités du Piémont pour créer en ville une nouvelle prison pour femmes, moderne, civile, à gérer selon ses critères, Juliette Faletti cita l’expérience londonienne. Elle proposa que les détenues soient confiées à un comité de femmes, les Dames, qui se seraient appuyées sur des religieuses pour la gestion de la structure.
C’est ainsi que naquit la prison des Détenues ; à la marquise fut accordé le titre de surintendante et même le pouvoir de décider qui accepter. Il y avait enfin de la lumière et de l’air, des lits et des couvertures propres, une infirmerie, une chapelle, des locaux pour les activités manuelles (filature du chanvre et du lin, confection de bas et de vêtements), une cour. Elle fit planter à ses frais des fleurs et des arbres fruitiers. Comme dans la prison londonienne de Newgate, sur laquelle s’était concentrée l’attention d’Elizabeth Fry, à Turin également, Juliette prépara le règlement et en discuta avec les détenues. Les cartes à jouer et l’eau de vie étaient interdites. Les livres, uniquement ceux approuvés par les Dames et par l’aumônier. Le travail était distribué par les Dames ; deux-tiers des profits étaient distribués immédiatement, un tiers tenu à part pour être remis quand elles seraient libérées. Pour la gestion quotidienne de la prison, arrivèrent les sœurs de Saint-Joseph de Chambéry.
Mais la marquise avait un projet plus ample et ambitieux. Elle avait touché du doigt que la pauvreté, matérielle et spirituelle, était le drame caché derrière les barreaux. Il fallait donc un retour bien accompagné à la vie libre. En 1823, dans une ferme achetée par le gouvernement et rénovée à ses frais, elle fonda l’œuvre pieuse du Refuge, qui accueillait 70 femmes sorties de prison, avec des règles extrêmement strictes : seule la supérieure décidait quand les anciennes détenues étaient prêtes à partir au service des familles.
Elle voulut prévenir toute chute. En 1831 naquit le Refuge pour les enfants orphelines de moins de 15 ans « victimes des plus troubles les plus fâcheux ». Puis l’Institut Sainte-Anne « pour instruire et éduquer de façon chrétienne les jeunes filles et en faire de bonnes chrétiennes et de bonnes mères de famille ». Son charisme prit forme en 1834 avec la fondation d’une congrégation, les religieuses de Sainte-Anne, très active aujourd’hui encore en Italie et dans le monde pour l’assistance et la formation des plus petits et des plus pauvres. Et étant donné que de nombreuses femmes avaient redécouvert la foi en prison grâce à sa catéchèse, une seconde congrégation naquit, les Sœurs pénitentes de Sainte Marie Madeleine, aujourd’hui Filles de Jésus Bon Pasteur, pour qui voulait racheter son passé à travers la prière et la pénitence.
Entre temps, la marquise avait croisé un jeune prêtre passionné nommé don Bosco qui devint l’aumônier du Refuge. Il s’occupa des jeunes filles accueillies au Refuge, mais il voulut deux pièces pour ses gamins, les petits garçons abandonnés de Turin.
On comprit très tôt que la coexistence entre les deux groupes ne fonctionnait pas. Et leurs routes se séparèrent. La marquise voulait en effet que le prêtre ne s’occupe que des jeunes femmes. « Il y a bien assez à faire au Refuge. Ne cherchez pas d’autres occupations… ». Et lui, le seul qui osait lui tenir tête lui répondit : « Je ne cherche pas d’autres occupations. Avec tout le respect, je suis un prêtre et pas un secrétaire ».
Leur collaboration prit fin avec le licenciement de don Bosco, mais paradoxalement, ce fut elle qui s’agenouilla devant le saint qui partait et qui continua à l’aider dans l’œuvre de Valdocco en faveur des jeunes pauvres et abandonnés.
L’histoire ne se termina pas de façon tout à fait heureuse. En 1850, Juliette Falletti entra en conflit avec les autorités civiles de Turin. Elle n’accepta pas les compromis et voulut quitter la direction de la prison des Détenues. En signe de force, elle prétendit emporter ce qu’elle avait apporté personnellement au cours des trente ans d’activité. Il en découla une liste infinie de lits, bancs, chaises, tables, nappes, matelas, couvertures, vaisselle, etc.
La marquise abandonna tout, mais elle avait remporté son défi. La prison pour femmes était devenue comme elle l’avait imaginée : un lieu séparé où le travail était émancipation, mais également rédemption, dirigé par des sœurs qui alliaient fermeté et douceur, et son modèle dura en Italie jusqu’en 1970, quand les religieuses furent remplacées par des fonctionnaires civils.
Elle fut appréciée par de nombreux intellectuels libéraux du Risorgimento italien. Le célèbre Silvio Pellico, par exemple. C’était un patriote qui avait tramé à Milan contre la domination autrichienne. Arrêté, condamné à la détention forcée détenu pendant dix ans dans la forteresse du Spielberg, Silvio Pellico devint célèbre dans toute l’Europe avec le livre « Mes prisons ». A sa libération, il avait été employé par les marquis de Barolo et assista la marquise dans son activité épique en prison, qu’il raconta par la suite dans le livre « La marquise Giulia Falletti de Barolo née Colbert. Mémoires », un autre succès éditorial.
Voilà sa synthèse de tant de travail : « Ce lieu de punition, ordonné de façon si chrétienne, prit l’aspect d’un monastère doux et sage, plutôt que d’une prison ». A l’époque du libéralisme et de l’anticléricalisme, Silvio Pellico paya le prix d’une sévère critique pour un jugement aussi favorable, mais il se sentait redevable et voulut que la marquise reste ainsi à jamais dans les mémoires. Avec elle, en outre, le patriote entra en 1851 dans le laïcat franciscain comme tertiaire. Juliette et son mari Tancredi Falletti de Barolo ont été déclarés vénérables par l’Eglise catholique.
Francesco Grignetti
Journaliste, «La Stampa»









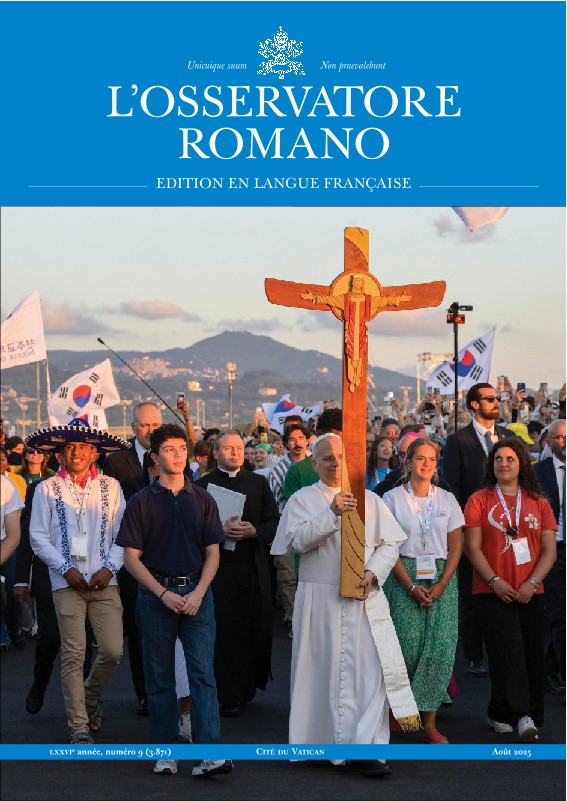



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
