Regards différents

La première rencontre est avec l’Auxiliatrice. Elle est là, en haut, toute blanche, le regard tourné vers ceux qui vont franchir le seuil. En un éclair, je me retrouve enfant : nous sommes sur la terrasse de l’Institut, au pied de l’Auxiliatrice qui domine du regard le village, sœur Graziella vient de laisser tomber une allumette allumée sur les feuilles avec nos dessins, du seau monte une fumée noire : « Vos prières montent au ciel, mes enfants », nous dit-elle, satisfaite ; nous suivons la fumée du regard et nous nous perdons dans le bleu. Je reviens au présent, à cette Vierge qui m’accueille avec bienveillance et qui m’émeut, je franchis l’entrée et il me semble être revenue à la maison.
Sœur Zvonka Mikec a un beau sourire, un léger embarras se lit sur son visage calme : elle sait qu’une écrivaine est venue l’interviewer, pour lui poser des questions sur l’Afrique, où elle vit depuis trente ans comme missionnaire ; elle me regarde perplexe, ne s’attend pas à un cœur en émoi.
« C’est que j’ai grandi parmi vous », me hâtai-je d’expliquer.
Ses yeux et son sourire s’allument : « Où » ?
« En Sicile ».
« Alors vous avez été notre élève ».
« Oui, depuis l’école maternelle ».
Les rôles se renversent de façon surprenante, elle pose des questions et je réponds. Je lui parle de sœur Graziella, de sœur Maria avec laquelle j’ai suivi pendant des années un groupe missionnaire, des jeunes d’Amazonie qui nous envoyaient des lettres et des photographies exotiques, dont celle inoubliable d’un enfant avec un gros serpent autour du cou ; je lui raconte aussi qu’ensuite, j’ai perdu de vue les sœurs : « En réalité, chemin faisant, j’ai perdu beaucoup de choses », dis-je dans un murmure. Un autre échange rapide et Dieu est déjà dans nos discours, dans notre récit de vies parallèles. Nous avons le même âge – elle est née le 14 mai 1962, moi le 10 mai 1963 – mais nous venons de deux réalités différentes : elle de Slovénie – « Je suis née à Novo Mesto, une région magnifique appelée la petite Suisse » –, dans un régime communiste qui empêchait les croyants d’accomplir des activités en dehors de l’église, moi d’une terre qui déverse hors de l’église des rites et des liturgies autour desquels elle axe la vie de ses habitants, elle est consacrée à Dieu, moi vouée à une plume qui me permet de parler aussi de Dieu.
Je la regarde. C’est une femme solide, aux yeux sombres et au sourire franc. On m’a dit qu’elle a l’Afrique tatouée sur la peau. A travers quels signes physiques se montre-t-elle, l’Afrique ? La peau brunie par le soleil ? Le regard empreint de la douleur de peuples victimes de vexations diverses, affamés par les guerres et les famines ? Il n’y a rien de tout cela en elle. Donc ?
« Pourriez-vous me raconter votre Afrique ? ».
Un rire franc, beau : « Par où commencer ? », dit-elle par un signe exprimant l’ampleur de la question.
« Par le moment où vous avez compris que vous vouliez devenir missionnaire ? ».
Elle acquiesce. « J’ai toujours aimé les enfants », commence-t-elle, « je savais que je serais éducatrice. Notre curé, même dans un régime d’interdiction, inventait toujours de nouvelles façons de nous réunir quand nous étions enfants. Quand j’ai grandi, j’ai compris que le presbytère était l’aumônerie ».
Elle raconte que lorsqu’elle avait onze ans, un missionnaire du Burundi arriva dans la paroisse : ses paroles, unies aux diapositives qu’il projetait, étaient si vivantes qu’elles la passionnaient, ainsi que deux de ses amies au point qu’elles se dirent : « Devenons missionnaires ». Mais comment faire ? Elles en parlèrent au curé. « Vous devez grandir », répondit-il, mais, « le malin ! » ajoute-elle en souriant, il les mit en contact avec des religieuses vincentiennes et leur proposa de participer à trois jours d’exercices spirituels dans la proche ville de Bled.
« Je me souviens encore de cette première rencontre, nous étions dans nos chambres, petites, toutes serrées comme des sardines, il y avait ce climat de joie, de fête… Nous étions des gamines espiègles », la petite fille espiègle vit encore en elle, affleure dans ses sourires, dans ses yeux si capables de manifester la joie.
A Bled, elle rencontra une religieuse âgée, Francesca, qui aimait parler avec les nouvelles venues. « Je lui dis que je voulais devenir éducatrice. Elle perçut ma vocation », en effet, elle continua de la suivre, lui écrivant des lettres qui accompagnèrent son chemin de vocation. A la fin de la troisième, elle revint à Bled. « J’aimais être avec les religieuses, mais je n’étais pas certaine que je voulais devenir religieuse ». Mais sœur Francesca lui demanda dans une lettre ce qu’elle voulait faire de son avenir.
« Je ne lui répondis pas, je vivais dans un pays communiste, si j’avais manifesté mes intentions, j’aurais eu des difficultés à étudier : le régime interdisait aux enseignants de pratiquer la foi. Je m’inscrivis alors à une école professionnelle. Mais le contact avec les religieuses se maintenait. Je savais bien en moi ce que je voulais, mais je continuais de le taire. Puis, la religieuse me demanda une fois de plus ce que je pensais faire. J’en ai parlé avec ma mère et j’ai décidé. J’ai fréquenté le lycée à Ljubljana de 1976 à 1981, cela a été une période heureuse, puis un an de postulat, puis le noviciat à Castel Gandolfo. Le 5 août 1984, à Bled, j’ai fait ma première profession religieuse ».
« Et la mission ? »
« Je sentais en moi la voix missionnaire, mais je n’en parlais pas. Mais rien n’arrive par hasard : j’étais à Conegliano Veneto pendant que l’on préparait la première expédition pour Madagascar. J’étais une petite sœur, je regardais toute cette agitation et je me demandais si j’aurais aimé partir, alors je présentais une demande ; mais j’étais encore à ma première année, on me répondit d’attendre les vœux perpétuels et après, si j’en avais toujours l’intention, je pouvais partir ».
Elle s’arrête, regarde mon stylo qui court sur le papier. Elle attend que j’aie fini d’écrire. Elle recommence : « La préparation aux vœux perpétuels est un moment de réflexion sérieuse, le temps où le Seigneur vient à ta rencontre. Je priais de pouvoir discerner, de comprendre : Sa voix disait quelque chose, mais je ne comprenais pas bien. Un jour, l’inspectrice me demanda si je pensais encore aux missions. Cela me sembla un signe. “D’accord, Seigneur”, me dis-je, j’envoyais la demande et, en deux semaines, j’eus la réponse : “Termine tes études et pars”. Je finis mes études, et la destination arriva : l’Angola ! », elle me regarde rêveuse : « L’Angola, je savais que c’était en Afrique, mais rien de plus, pas même qu’il y avait la guerre ». Elle semble perdue dans ses souvenirs.
Ce qui me fascine dans son histoire est l’attente silencieuse, vivre en se contentant de la vie au fur et à mesure qu’elle passe, se trouver comme devant une porte qui, en s’ouvrant lentement, dévoile des fragments d’avenir.
« Le 25 avril 1990, avec douze autres sœurs, j’ai reçu le crucifix missionnaire et je suis partie pour Vérone, où il y a un centre diocésain de préparation. Ce sont des missionnaires ayant une expérience de l’Afrique qui instruisent : on te dit ce que tu trouveras, les cultures, les tabous… Mais la vraie préparation se fait sur place. Avant de partir, je ne me demandais pas : “Comment cela sera ? Que ferai-je ?”, je pensais : “Afrique, enfants, fête, catéchèse, parler de Jésus”, et j’étais contente ».
« Quelle langue deviez-vous utiliser ? »
« Le portugais. J’ai étudié cinq mois à Cascais ».
« Quelle a été la première impression quand vous êtes arrivée en Angola ? »
« En descendant de l’avion, tout m’est apparu rouge : la terre, les maisons, des montagnes de terre rouge. L’air n’était pas trop chaud, comme chez nous en juin. J’étais très émue. J’allais tout doucement avec les autres, quand j’ai vu les religieuses, j’ai eu un soupir de soulagement. La communauté de Luanda – la capitale – se trouvait au quatrième étage d’un immeuble, j’ai été étonnée, elle était petite, à peine quatre sœurs, tout était très simple, très pauvre, mais si accueillant que je me suis sentie chez moi. Deux sœurs sont venues me chercher pour m’emmener à Cacuaco, à quinze kilomètres de Luanda. Le voyage en Range Rover m’a immédiatement donné le sentiment de la mission. J’étais attendue par les sœurs, avec plein d’enfants qui chantaient. L’un deux m’a souhaité la bienvenue avec un immense régime de bananes (j’aime beaucoup les bananes). Cela a été une arrivée merveilleuse ».
Elle dit qu’à cette époque, la zone était pleine de réfugiés, la guerre, finie depuis peu, avait détruit de nombreuses familles et ceux qui arrivaient de l’intérieur du pays avaient besoin de tout.
« Nous donnions ce que nous pouvions, nous faisions des catéchèses, nous enseignions la couture aux mères, nous apprenions à lire et à écrire aux enfants. Au début il n’y avait pas d’école, nous l’avons construite en 2002 avec l’aide des jeunes ».
« Vous arriviez à les payer ? »
« Oui, ils recevaient un salaire qui leur permettait de maintenir leur famille. Nous avons commencé de rien, en fabriquant les briques avec la terre rouge, et nous avons réalisé un très beau centre, qui accueille aujourd’hui plus de mille cinq cents enfants ; certains d’entre eux travaillent encore avec nous, ils sont très doués, un électricien est capable de faire l’installation d’une école tout entière ».
« Le premier Noël en Angola ? »
Elle sourit : « Oh, j’ai passé le jour de la veillée dans la chapelle d’un village à distribuer de la nourriture. Pas vraiment des décorations de Noël ! La décoration la plus belle a été de distribuer du maïs, des haricots, de l’huile. La réalité des villages est la plus critique, il y a là des situations d’extrême pauvreté ».
« Est-ce qu’on émigre vers l’Europe? »
« Non, on se déplace principalement vers la capitale. Les jeunes arrivent en ville et ne trouvent pas ce qu’ils espèrent, certains restent dans les rues et vendent, d’autres s’adaptent à n’importe quel travail pour survivre, ils sont sans famille : si tu trouves quelque chose, bien, sinon tu finis délinquent. Il y a de très jeunes gens qui nous préoccupent, nous essayons d’offrir des possibilités d’école, d’un intérêt qui les préserve de la faim et de la délinquance, mais ce n’est pas facile ».
« Je sais qu’ensuite, vous êtes allées ailleurs ».
« Au Mozambique. J’y ai vécu de 2010 à janvier de cette année. C’est une réalité plus pauvre et plus difficile que celle angolaise, bien que la guerre soit finie avant. Au nord, il y a une recrudescence de la violence causée par des groupes djihadistes qui attaquent et brûlent les villages. Notre communauté vit des situations difficiles, certains enseignants ont vu leurs proches être tués, il y a beaucoup d’orphelins, trop de gens qui fuient pour se sauver. Au sud, la situation est plus pacifique, là nous nous occupons de la formation ; les jeunes étudient, ils apprennent des métiers : couture, fabrication du pain, travail dans les champs. Nous avons également créé deux centres pour l’accueil des jeunes filles à risque. Un grand nombre de nos enseignants à présent sont des enfants que nous avons formés. Je dis toujours qu’avec un peu d’application, beaucoup de prière et beaucoup de travail, on peut recueillir de bons fruits ».
« J’en suis convaincue ».
Elle sourit.
Je regarde ma montre, je comprends qu’il est l’heure de prendre congé. Nous passons par la chapelle, un salut au Très Saint Sacrement, un à la Vierge, je l’embrasse alors qu’elle m’accompagne jusqu’à l’entrée puis, au moment de nous quitter : « Au revoir », me dit-elle, « reviens quand tu veux ».
Tea Ranno
L’auteur
Tea Ranno, née à Melilli, dans la province de Syracuse, vit à Rome. Elle est titulaire d’une maîtrise en droit et s’occupe de droit et de littérature. Elle a publié chez e/o les romans Cenere (2006, finaliste aux prix Calvino et Berto, lauréat du prix Chianti) et In una lingua che non so più dire (2007). En 2018 chez Frassinelli Sentimi Chez Mondadori sont sortis La sposa vermiglia (2012), Viola Fòscar (2014), L'amarusanza (2019), Terramarina (2020), Gioia mia (2022). Son dernier livre est Un tram per la vita, Il Battello a Vapore, librement inspiré de l’histoire d’Emanuele Di Porto, qui a échappé à la rafle nazie du 16 octobre 1943 à Rome.









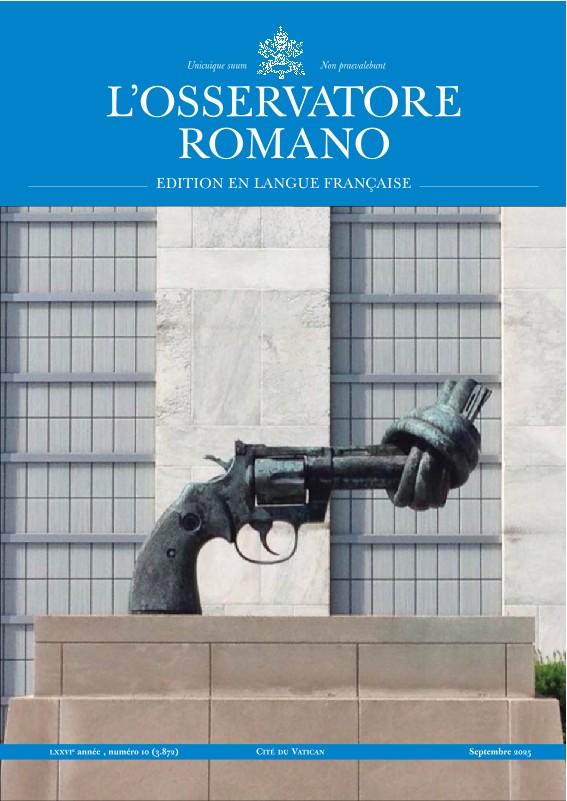



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
