
Le soir du 11 octobre 431, une foule en liesse, munie de flambeaux, accueille les pères qui, réunis en concile à Ephèse, — même si, d'une manière discutable pour notre sensibilité —, avaient condamné le patriarche de Constantinople, l'Antiochien Nestorius, pour avoir contesté l'attribution à Marie de Nazareth du titre de théotokos (celle qui engendre Dieu). Pour Nestorius, il était préférable de l'appeler anthropotokos, c'est-à-dire la mère de l'homme Jésus, puisqu'une créature humaine ne pouvait pas engendrer Dieu. Sa préoccupation était de ne pas en faire une déesse... Pour trancher la controverse, il avait également proposé de l'appeler Christotokos (celle qui engendre le Christ). Mais même cela avait semblé insuffisant et inadéquat pour le fanatique et querelleur Cyrille, patriarche d'Alexandrie. Il avait piloté le concile et, d'un revers, en l'absence des légats du patriarche d'Occident, retardés par une tempête, avait obtenu l'excommunication de Nestorius. Les légats, qui étaient enfin arrivés, avaient entériné ses décisions. Aujourd'hui, la tendance est de libérer Nestorius du voile dans lequel Cyrille l'avait enveloppé. Probablement, dans ce cas comme dans d'autres, la distance était nominale plutôt que théologique. En bref, plus qu'un problème doctrinal, ce qui les opposait était un vice de vocabulaire. D'autre part, de manière littérale theotokos, traduit en latin par deipara, ne signifie pas « mère de Dieu ». Les théories qui considèrent que la femme est absolument passive dans le processus de génération dissipent l'impossibilité pour la créature d'être un sujet actif. Comme le dira saint Bernard des siècles plus tard, Marie était un simple « canal », un pur et unique intermédiaire. Disons aussi, une sorte de couveuse qui s'était prêtée à la conception, à la croissance et à la naissance de l'humanité du Verbe.
Comme l'a brillamment montré la théologienne norvégienne Kari Børresen dans Marie au Moyen-Age, si le dogme marial s'est intéressé à Marie en la qualifiant de « théotokos » et « toujours vierge » ou, plus tard, au deuxième millénaire, en la définissant « immaculée » et « assumée » (assomption), ce n'est pas pour la célébrer Elle, mais bien plus son Fils, d'ailleurs en recourant à des théories génétiques ou à des suggestions anthropologiques, aujourd'hui définitivement dépassées.
Deux questions se posent. La première est liée à Ephèse, la ville du concile et au pathos qui suivirent ses vicissitudes. L'autre, plus importante mais qui y est liée, concerne le dogme christologique, c'est-à-dire la nécessité pour la communauté croyante de confesser Jésus de Nazareth comme vrai homme et vrai Dieu.
Ephèse
Il y a quelque temps, j'ai été troublée par un film montrant comment Marie de Nazareth, après la résurrection de son Fils, a suivi le disciple Jean et s'est installée avec lui à Ephèse. Une sorte de reportage détaillé sur ses voyages a été proposé à partir de la Vie de Marie de Katharina Emmerick, une mystique allemande qui a vécu au XIXème siècle
Le jésuite et théologien allemand Karl Rahner a parlé dans les années 1970 de prophéties et de visions. Assurément sincère et de bonne foi, le visionnaire donne corps à son expérience, en respectant les clichés culturels, la piété et le sentiment de son époque. Ce serait la seule façon de justifier certaines affirmations de Katharina Emmerick sur des pratiques pieuses —chemin de croix, « viatique », célébrations solennelles présidées par l'apôtre Pierre — en usage des siècles plus tard, et non la mort de Marie à l'âge de 62 ans, selon la voyante… Et de toute façon, les visions de qui que ce soit ne sont jamais accueillies comme des preuves d'événements ou des déclarations de foi.
Un large éventail d'apocryphes, dits « assomptionnistes », rendant compte sur ce point, situent la mort de Marie à Jérusalem. Cette tradition littéraire, qui est devenue un patrimoine commun autour du Vème siècle, semble aujourd'hui également soutenue par des témoignages archéologiques.
Mais pourquoi alors, aujourd’hui encore, celle que l’on appelle la « maison de Marie » est-elle encore visitée à Ephèse ? Peut-être faut-il rappeler que c'est précisément dans cette ville qu'avait été érigé un temple, très vénéré, dédié à la déesse Artémis. Les Actes des Apôtres témoignent comment la nouvelle religion prêchée par Paul apparaissait dangereuse à ceux qui vivaient de son culte au point de susciter, au cri : « Grande est l'Artémis des Ephésiens », une agitation telle qu’elle obligea l'apôtre à quitter précipitamment la ville. Et comme le trophée de l'apôtre Jean a toujours fait l'objet de vénération à Ephèse, il semblait évident d'associer sa tombe au lieu où il aurait vécu avec Marie et où Marie serait morte.
Ephèse constituait véritablement un des sites où la suggestion du féminin « divin » était la plus palpable, à savoir une représentation de la divinité selon les symétries de genre, épigone malgré tout de la religion matriarcale de la déesse si répandue dans le bassin méditerranéen.
J'ajoute que les religions du Livre sont fortement patriarcales. Leur représentation de Dieu le rend uniquement masculin et, là où quelque chose échappe ou reste, il y a de l’acharnement, comme dans le cas du Coran concernant les soi-disant « versets sataniques », ombre lointaine d'un culte au féminin.
Artémis, dans le Panthéon gréco-romain, est une divinité lunaire. Proche de la Diane des Latins, elle est solitaire et chasseresse intrépide, déesse vierge indifférente à la séduction.
Le simulacre de la déesse éphésienne n'a à ce jour toujours pas d'interprétation certaine. Elle est couverte jusqu'à la taille de protubérances arrondies, interprétées soit comme des seins, soit comme des testicules de taureau. Elle évoque assurément une féminité puissante et sensuelle.
C'est donc dans cette ville que s'est développée une dévotion particulière à Marie. Probablement, ce qui est visité et vénéré comme sa maison, était une église qui lui était dédiée. Très vite en effet, devenu un culte reconnu et accepté par l'empire, le christianisme a dédié des lieux de culte également à la mère du Seigneur. Les temples dédiés aux anciennes déesses ont souvent connu ce que l'on appelle en anthropologie culturelle la « transculturation ».
En d'autres termes, ayant exclu les femmes du divin, il fallait y remédier d'une manière ou d'une autre. Qui mieux que la mère de Jésus pouvait sublimer cette demande ? Comment ne pas la mêler à ce sentiment méditerranéen orphelin et épigone de la Grande Mère ? Et comment ne pas l'adopter dans ce but, en lui donnant une puissance hors de toute proportion ? N'est-ce pas la jeune fille de Nazareth qui a engendré dans la chair le Fils de Dieu ? Et n'est-ce pas la maternité qui donne un sens aux femmes ? Et qui plus qu'elle peut en offrir une puissante représentation ? Les épithètes de Cybèle, l'ancienne déesse anatolienne de la nature, et de la déesse égyptienne Isis ne transparaissent-elles pas à travers elle ? Il est certain que dans la fête qui, à Ephèse, acclame Marie comme théotokos, nous devons aussi lire la continuation de ce fil rouge qui appelle à une diction équilibrée pour dire Dieu, même dans une perspective de genre.
A ce stade, il semblerait que le besoin d'un correctif au patriarcat considère la théologie et le sentiment populaire comme synergiques. En réalité, ce n'est pas le cas. La théologie intériorise et sublime le patriarcat. Appeler Marie theotokos ne parle pas d'elle dans son pouvoir maternel, mais consacre sa relation fonctionnelle au Fils, dont elle garantit l'incarnation en tant que « né d'une femme ». Si le Verbe n'avait pas été engendré dans la chair, nous ne pourrions pas parler d'incarnation et de rédemption.
La controverse christologique
Naturellement, le discours n'est pas simple. Les Evangiles synoptiques indiquent que Marie est la mère de Jésus. Une locution que l'on retrouve également chez Jean qui, en revanche, ne nous donne pas son nom. L'Evangile de Luc, en particulier, la dépeint selon le canon le plus authentique de la vie de disciple. Dans son Evangile de l’Enfance, il est dit que Marie a gardé en elle les événements en les affrontant dans son cœur. Pourtant, comme un correctif aux louanges qui lui sont adressées par une femme non nommée — Béni soit le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont nourri ! — Jésus oppose la maternité physique qui y est exaltée aux valeurs de la vie de disciple : accueillir la parole de Dieu et la mettre en pratique. Ce sont précisément les attitudes qui, selon Luc, caractérisent Marie de Nazareth.
Comme le prouvent les Evangiles et les Apocryphes de l'enfance, l'attention placée sur la mère de Jésus n'est pas immédiate. Dans un premier temps, l'accent est mis sur la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth qui a annoncé le Royaume de Dieu. Celui qui a été crucifié et est ressuscité est désormais au cœur de l'Evangile qui rassemble ses paroles et ses gestes.
Le comprendre Lui, le Fils de Dieu, né d'une femme, justifie cependant que l'on prête attention à celle qui l'a mis au monde et à la manière dont Il est né. En vérité, les Evangiles nous disent peu de choses sur Marie. Ils attestent d'une sorte de rupture entre Jésus et sa famille d'origine et nous offrent très peu d’éléments pour nous dire qui est cette famille, comme pour montrer l'incongruité entre ceux à qui il appartient, les gestes qu'il accomplit et les paroles qu'il prononce.
C'est donc le dogme christologique qui met en jeu Marie. Contre le gnosticisme et le manque d’attention à la corporéité, il faut affirmer que la naissance de Jésus est une vraie naissance, inscrite dans la puissance de Dieu, sans le concours de l'homme. D'où sa lecture dans une clé virginale ; bien que précisément dans une clé anti-gnostique, même au IIIe siècle, certains Pères affirmaient la conception virginale de Jésus mais pas sa naissance.
Dans la difficulté pour énucléer le nœud christologique, l'épithète theotokos lutte pour être acceptée. Il suffit de constater son absence ou sa faible récurrence chez les Pères. Comment la nature humaine pourrait-elle engendrer le divin ? Et d'autre part, affirmer que Marie génère la seule humanité de Jésus risque d'opposer ou de juxtaposer humanité et divinité. Tel est le danger qui sous-tend les termes anthropotokos et christotokos, chacun dans son unilatéralité.
Je n’entre pas dans le détail des différentes positions. La controverse christologique a occupé les Eglises tout au long des IIIème et IVème siècles. C'est une floraison d'hérésies visant à minimiser l’importance de l'humanité aux dépens de la divinité ou de la divinité aux dépens de l'humanité. Pour Cyrille d'Alexandrie, seul le terme theotokos garantit la coprésence de l'humanité et de la divinité dans l'unique personne du Verbe. Cyrille, chevauche la corde sensible d'une dévotion primitive et inconditionnelle, d'une emphase qui touche déjà la mère du Seigneur, du moins dans l'imaginaire populaire.
En arrière-plan — je le répète — se trouvent les cultes d'Isis et de Cybèle. Qu'on le veuille ou non, ce sont ces éléments culturels qui animent une querelle théologique très délicate, qui, par ailleurs, n'est pas résolue au concile d'Ephèse mais à celui de Chalcédoine (451). Ici, en effet, malgré la distinction des deux natures, il est considéré comme légitime d'attribuer à l'humanité ce qui connote la divinité et vice-versa. C'est pourquoi Marie de Nazareth, la mère de Jésus, peut être appelée theotokos. Un titre qui est pour la première fois solennellement incorporé dans une définition conciliaire. Cette dernière nous enseigne que le Fils, parfait en humanité et parfait en divinité, vrai homme et vrai Dieu, de la même substance que le Père selon la divinité et de notre substance selon l'humanité... pour nous les hommes et pour notre salut a été engendré par Marie, vierge, mère de Dieu (theotokos).
A partir de ce moment, Marie sera vénérée et chantée comme theotokos, poussant toutefois l'expression au-delà de la lettre en la qualifiant de meter theou, « mère de Dieu ». Mais en cela il y a une cohérence avec ce qui est dicté par Chalcédoine, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser indifféremment les expressions et les attributs, non pour confondre humanité et divinité, mais pour affirmer leur coprésence dans l'unique personne du Verbe.
Que le torrent de dévotion aille ensuite jusqu'à certaines dérives emphatiques est une autre question. La jeune fille de Nazareth offre néanmoins un correctif miséricordieux à une religion qui risque de faire disparaître le féminin.
La constitution Lumen gentium de Vatican II et son chapitre VIII, intitulé « La Bienheureuse Vierge Marie Mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l'Eglise » nous soutient. Nous y trouvons une vision équilibrée de Marie, qui n'est jamais une déesse ou une créature entre l'humain et le divin, mais notre sœur dans le travail quotidien de la croyance, notre compagne dans le « pèlerinage de la foi », binheureuse parce qu'elle a cru « à l'accomplissement des paroles du Seigneur ».
Cettina Militello
Théologienne, présidente de la Société italienne pour la recherche théologique (sirt ).
Ephèse
La Maison de Marie (en turc Meryem Ana Evi) à Ephèse, est un lieu sacré de chrétiens et de musulmans, situé sur le mont Solmisso dans l’actuelle Turquie occidentale. Elle est considérée comme l’habitation où elle vécut jusqu’à la fin de ses jours terrestres, autour de 48 après Jésus Christ, confiée par Jésus à l’apôtre Jean, qui se trouvait avec Marie au pied de la Croix.
Les fondements du petit édifice ont été découverts le 18 octobre 1881 par le père et abbé parisien Julien Gouyet sur la base des indications contenues dans les journaux intimes rapportant les visions de la mystique et bienheureuse Anna Katharina Emmerick, transcrits par Clemens Brentano, poète et essayiste de la période romantique.
Au Ve siècle fut édifiée la première basilique de l’histoire humaine consacrée à Marie. Au sommet du mont Solmisso subsisterait une petite grotte étroite, dans laquelle les apôtres déposèrent le corps de la Vierge Immaculée qui peu après, fut élevée au ciel.
Lorette
L’un des principaux lieux de vénération de Marie est la basilique sanctuaire de la Sainte Maison à Lorette. A l’intérieur se trouvent les restes de ce qui est, selon la tradition, la Sainte Maison de Nazareth, le lieu de l’Annonciation.
Selon la tradition, au début du mois de mai 1291, alors que Nazareth et toute la Palestine étaient sous la domination des Mamelouks d'Egypte, des anges prélevèrent la Sainte Maison et la transportèrent dans les territoires de l'ancienne Illyrie. Plus tard, en 1294, les anges ont apporté la précieuse relique à Lorette. Il s'agit d'un petit bâtiment de 9,50 x 4 mètres. Dans son noyau d'origine, il ne comporte que trois murs d'environ 3 mètres de haut, et on pense qu'il était composé d'une partie taillée dans la roche, c'est-à-dire la grotte qui se trouve encore aujourd'hui dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth, et d'une partie en pierres. Les dimensions de l'habitation coïncident avec celles du « trou » resté à l’endroit où elle se trouvait auparavant.









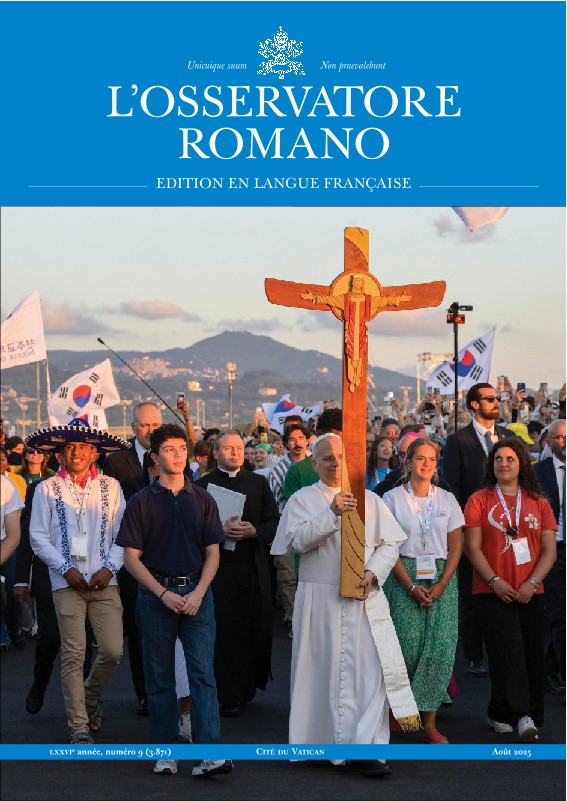



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
