Une aiguille
Nous devrions parler des quatre-vingt douze. Des quatre-vingt douze personnes, parce qu’il s’agit de personnes humaines, qui ont été trouvées hier à la frontière entre la Turquie et la Grèce. Ce sont tous des hommes et ils sont tous vivants. Mais ils ont été trouvés nus et portant des blessures visibles, après avoir traversé le fleuve Evros, frontière naturelle entre les deux pays. Selon les autorités grecques, ils ont subi des mauvais traitements graves, et ont été soumis à des traitements dégradants. Nous devrions parler d’eux. Nous devrions nous arrêter, dans notre travail de «débit constant de nouvelles» et donner une place, dans nos premières pages, à ces personnes.
Nous ne devrions pas, en réalité, parler des quatre-vingt douze, mais de chacun d’entre eux. Ce sont des hommes d’origine afghane et syrienne mais nous ne savons rien d’autre, à part ce que nous racontent leurs blessures et leur nudité. Ils sont comme des «linceuls vivants». Qui sont-ils vraiment? Avant tout, comment s’appellent-ils? Où sont leurs familles, leurs maisons, leurs amis, leurs biens? Comment vivent-ils, quel travail exercent-ils, que font-ils quand ils ne travaillent pas, qu’aiment-ils faire dans leur temps libre? Des questions qui semblent incongrues, inopportunes, sans doute ingénues, mais que nous devrions nous poser, en les regardant dans les yeux et en leur demandant pardon. En regardant leurs visages et en les appelant par leur nom. Qui peut le faire? Nous connaissons la réponse: quiconque, chacun de nous pourrait le faire, s’il le voulait. Mais c’est toute la question: que voulons-nous vraiment? Sans doute est-il préférable de rester dans l’étourdissement des nouvelles en rafale et dans ce flou confus des chiffres: quatre-vingt douze. Une nouvelle placée à côté d’autres nouvelles, avec d’autres chiffres, pas de visages, pas de noms, pas d’histoire. Et aucun contact, aucune proximité.
Ces quatre-vingt douze hommes nus et blessés dérangent. En effet, entre la Grèce et la Turquie a éclaté, de façon inévitable, une forte ten-sion diplomatique avec des échanges d’accusations réciproques.
Il vient à l’esprit ce court roman d’il y a dix ans, écrit par l’écrivain albanais Ismail Kadare, La provocation, dans lequel entre deux tranchées enneigées, dans un lieu indistinct mais au cœur de l’Europe, est retrouvée un matin une femme blessée sur une civière. Sans doute s’agit-il d’une femme «légère», en réalité, elle n’est «à» personne et est là, au milieu de deux armées belligérantes saisis d’embarras face à cette scène inédite sur un champ de bataille. «“Nous ne pouvons pas la laisser crever”, dit le médecin. “A rester quelques heures à l’extérieur, elle va geler”. Je ne sus que répondre. Je ne quittais pas des yeux la civière posée sur la neige, la couverture formant une bosse au milieu, là où se trouvaient peut-être les genoux, et je me dis que le toubib avait raison. La scène dépassait vraiment l’imagination. Une plus grande solitude n’était pas concevable. “La laisser là... ne serait pas humain”, poursuivit le médecin. “Ecoute”, fis-je avec brusquerie en me tournant vers lui, “à quel humanisme t’attends-tu par ici? C’est une frontière, un lieu de traîtrise et de mort, et tu voudrais de l’humanisme? Trop lourd pour mes épaules, l’humanisme. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin”, m’écriai-je, en indiquant du doigt, sans savoir moi-même pourquoi, la civière qui était là dans la neige. Le médecin affichait un air désespéré. “Il n’empêche”, murmura-t-il bientôt, “que ça ne serait pas humain”».
La provocation est là, forte, et elle a le visage, pour l’instant inconnu, de quatre-vingt douze hommes, au milieu de deux tranchées le long de la frontière qui traverse notre con-science, cette limite qui sépare l’humain de l’inhumain.
Andrea Monda









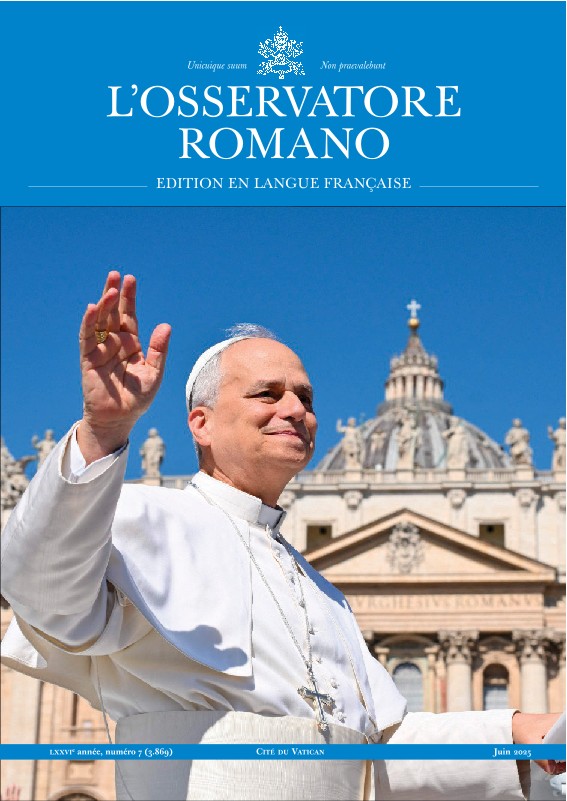



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
