Le recit
Les sœurs martyres

Un jour, Dieu décida de jeter un coup d’œil du haut du ciel pour voir comment allaient les choses sur terre. Il remarqua immédiatement que Londres avait beaucoup changé depuis la dernière fois qu’il avait regardé et que l’Egypte n’était pas du tout comme il se la rappelait. Mais le Yémen... eh bien, – sourit Dieu – le Yémen n’a pas changé du tout depuis le jour où je l’ai créé. J’écoute cette ancienne légende tandis qu’un paysage lunaire défile devant mes yeux, de grands cratères gris descendent en pente vers l’immense plage déserte. Le silence rompu uniquement par le roulement apathique des vagues et le cri des mouettes. Il n’y a pas une seule maison en vue, ni à vrai dire, aucun autre signe de vie humaine à perte de vue. Nous sommes sur la côte sud du Yémen et il semble vraiment que rien n’ait changé ici depuis le premier jour de la création. Mais on doute qu’aujourd’hui, Dieu se mette à sourire avec satisfaction en voyant ce paysage. En effet, le sable blanc cache un terrible secret.
Ces pierres de lave noires, disséminées le long de la plage ne sont pas là par hasard, elles signalent la présence de fosses communes. Des dizaines et des dizaines de corps d’hommes, de femmes, d’enfants. Des Somaliens fuyant leur pays dans de petites embarcations, morts lors de la traversée du golfe d’Aden, souvent noyés à quelques mètres du rivage car ils ne savaient pas nager. Les pêcheurs d’un village voisin les ont enterrés en creusant de grands trous sur la plage ; d’après le nombre de pierres noires, on peut deviner combien de cadavres reposent en dessous : « vingt pierres, vingt corps... », explique Aoud, un jeune Yéménite qui nous accompagne sur place. « Nous n’avons pas pu faire plus, les visages étaient méconnaissables, les documents perdus en mer ». Enterrés sans un nom, sans une pierre tombale, leurs proches n’auront jamais de lieu pour les pleurer. J’écoute le récit du dernier naufrage et je me demande comment il est possible que tant de douleur coexiste avec tant de beauté. Enfant, je n’arrivais à imaginer la guerre qu’en noir et blanc, avec le ciel sombre, l’air froid et la terre sale. Maintenant encore, j’ai du mal à imaginer que des garçons de l’âge de mon fils soient morts en se battant dans un pré fleuri, effrayés, sous un ciel bleu et un air chaud. Ou que des enfants comme Amhal, avec qui j’ai joué quelques heures plus tôt dans un camp de réfugiés, se soient noyés dans une mer si belle, et qu’ils gisent maintenant là-dessous, tous recouverts de sable.
Nous sommes le 12 mars 2008. Au Yémen, Andrea Martino et moi devons réaliser un reportage pour Tg2Dossier sur ce pays suspendu entre l’enfer et le paradis. C’est à cette occasion que je rencontre les religieuses de Mère Teresa de Calcutta, dans leurs maisons de Sana’a et d’Aden où elles accueillent des personnes pauvres atteintes de handicaps physiques ou mentaux, parmi lesquels également des réfugiés somaliens.
Je n’arrive pas à oublier le sourire de ces religieuses, le sentiment de paix profonde qu’elles transmettaient. En mars 2016 – huit ans exactement après mon voyage au Yémen – la maison d’accueil d’Aden a été attaquée par un commando d’hommes armés, probablement des terroristes islamiques, qui ont massacré quatre des cinq religieuses et seize bénévoles qui assistaient les personnes âgées. Toutes les victimes ont été retrouvées avec les mains liées et une balle dans la tête.
Le Yémen n’avait pas encore sombré dans la guerre civile, mais notre voyage, organisé par le HCNUR, l’agence des Nations unies pour les réfugiés, était déjà considéré comme dangereux en raison des fréquents enlèvements d’étrangers et de la présence de cellules actives d’Al-Qaïda. L’une des routes que devions emprunter pour traverser le pays du nord au sud s’appelle Bin Laden road, elle a été construite par le père d’Osama Bin Laden, idéologue de l’attaque aux Twin Towers. Nous avons été obligés de voyager sous escorte, accompagnés à chaque déplacement par un pick-up sur lequel était placée une grosse mitrailleuse ; des précautions nécessaires, nous dit-on, car un convoi de l’ONU avait lui aussi récemment été la cible de tirs.
La première rencontre avec les Missionnaires de la Charité eut lieu dans la capitale Sana’a. Lorsque l’on franchit les murs de la vieille ville, on perd toute notion du temps, on est catapulté dans un monde féerique, avec ces palais colorés qui semblent être de carton et qui sont en revanche en argile, les façades en terre blanche et les balcons sculptés qui ressemblent à de la dentelle. On comprend pourquoi Pier Paolo Pasolini en a été fasciné et a même réalisé un documentaire sur les antiques murs de Sana’a sous forme d’un appel à l’Unesco : « Sur le plan architectural, le Yémen est le plus beau pays du monde. Sana’a, la capitale, est une Venise sauvage dans la poussière sans Saint-Marc et sans la Giudecca, une ville-forme, dont la beauté ne réside pas dans les monuments périssables, mais dans le dessin incomparable... ».
Je lisais ces paroles de Pasolini lorsque, avec d’autres collègues et l’interprète somalien, je me dirigeais vers la maison des missionnaires de la charité. Pasolini fut le tout premier écrivain à découvrir mère Teresa de Calcutta. Avant de nombreux cardinaux de Curie, avant la presse catholique, avant tout le monde : il la rencontra dès 1961 à Calcutta, quand le nom de la religieuse albanaise n’était pas encore connu des médias internationaux, et il fut frappé par « son regard doux qui, là où il se pose, voit » et par sa « bonté sans connotation sentimentale, sereine, puissamment concrète ».
Les mêmes caractéristiques humaines que je voyais à présent illuminer le regard des religieuses de la maison-couvent de Sana’a, où elles hébergeaient une vingtaine de personnes abandonnées, « les plus pauvres d’entre les pauvres », comme le voulait Mère Teresa. L’extérieur du bâtiment ne présentait aucun symbole de la foi chrétienne. Un détail qui avait attiré l’attention de certains collègues. Ils voulaient faire dire aux religieuses catholiques – certaines indiennes, d’autres africaines – ce qu’elles ne pouvaient pas dire, c’est-à-dire que le pays dans lequel elles avaient choisi de témoigner de l’Evangile, le Yémen, était un pays difficile, avec une histoire d’enchevêtrements sans précédent entre l’islam et le marxisme, et que dans cette situation, il n’était pas prudent d’afficher les signes de la foi chrétienne en public. Elles étaient bien conscientes des dangers qu’elles couraient. En 1998, un fanatique avait déjà tué trois religieuses dans la maison de Hodeida, dans le nord du pays, et le gouvernement avait promis une protection spéciale aux missionnaires qui avaient débarqué au Yémen en 1973. Mais les risques persistaient. Une « dénonciation » publique contre l’intolérance islamiste n’aurait pas amélioré leur situation, elle les aurait même exposées à de plus grands dangers. Et puis c’était leur style : être là, une présence qui parlait avec leur visage, avec leurs gestes, avec leur charité.
Je me souviens de la réaction d’un collègue qui insistait, sur un ton presque réprobateur, en demandant quel sens avait alors, pour des religieuses missionnaires, leur présence dans cet endroit si elles ne pouvaient pas « évangéliser ». Comme si évangéliser signifiait faire des prosélytes et ne pas témoigner de sa foi par sa vie, même dans les endroits les plus hostiles, en confiant au bon Dieu la conversion éventuelle des personnes rencontrées. Pris dans cette discussion, j’avais perdu de vue mon interprète, un somalien musulman. Je suis parti à sa recherche et je l’ai retrouvé assis sur un lit de camp, en train de parler à une vieille dame, accueillie dans la maison des Missionnaires de la Charité. L’homme avait les larmes aux yeux. Je lui ai demandé ce qui s’était passé, pourquoi il pleurait. L’interprète ne réussissait pas à parler, il balbutiait quelques mots et secouait la tête. Ce n’est qu’après quelques minutes qu’il s’est repris et m’a dit que la femme était somalienne comme lui : « elles l’ont traitée comme une reine, c’est exactement ce qu’elle m’a dit : les religieuses m’ont traitée comme une reine ! De nombreuses années auparavant, cette femme avait fui la Somalie ; elle avait subi de nombreuses violences et pleuré la mort des membres de sa famille, victimes de la guerre civile ; elle avait réussi à se rendre au Yémen après avoir traversé le golfe d’Aden sur un canot pneumatique, mais ensuite, après avoir erré sans but et sans aucune aide, sa vie avait précipité toujours plus bas, dans la dépression et l’avilissement. Une épave humaine. Les religieuses l’avaient recueillie dans la rue. Et elles l’avaient traitée comme si, à leurs yeux, elle était la personne la plus importante du monde, une reine, comme continuait de le répéter l’interprète, stupéfait. Maintenant, elle était toute propre, plus sereine, sortie de l’obscurité, pleine de gratitude. Je repensais à la discussion quelques instants auparavant, à l’absence de croix sur la façade extérieure du couvent et au reproche voilé adressé aux religieuses d’être trop soumises à l’islam et de renoncer à l’évangélisation... Et je regardais cette femme qui était renée et mon interprète musulman, étonné et ému par la façon dont les religieuses catholiques avaient traité sa compatriote détruite par la vie.
Je pensais à la différence qui existe entre la façon dont Dieu agit dans le monde et nos raisonnements présomptueux.
La deuxième rencontre avec les Missionnaires de la Charité eut lieu dans la ville portuaire d’Aden. Nous nous sommes vus à l’église de la Sainte Famille dans le quartier Crater, la plus ancienne église d’Aden, datant de la période coloniale britannique, qui a été déconsacrée dans les années 1960 par le régime communiste du Yémen du Sud, et par la suite restaurée.
Les religieuses en saris blancs bordés de bleu nous ont salués avec leurs sourires habituels. Elles auraient pu partager avec nous leurs pensées et leurs problèmes sur leur sécurité précaire. Mais elles préféraient nous communiquer leur joie, dont la source se trouve dans leur relation avec le Christ.
A la sortie de l’église, nous avons également rencontré les trois seules familles chrétiennes yéménites d’Aden. Il y avait à peine trois cents catholiques dans toute la ville, pour la plupart des étrangers, des immigrés philippins ou indiens. Mais il y avait aussi cette très petite mais émouvante présence de catholiques autochtones.
Les femmes avaient les mains tatouées à la manière arabe. Le chapelet et le henné : cela m’impressionne toujours, lorsque je voyage au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique ou en Amérique latine, de voir comment le christianisme peut facilement se répandre et s’exprimer dans toutes les cultures, en assumant leurs traits particuliers sans se dénaturer.
Ces femmes yéménites, catholiques, nous dirent qu’elles avaient reçu la foi de leurs parents qui, à leur tour, l’avaient reçue de leurs grands-parents. A côté d’elles se tenaient les religieuses de Mère Teresa, joyeuses.
Je ne me souviens pas de leurs noms. Je ne sais pas si ces mêmes religieuses étaient encore là, à Aden, lorsqu’à huit heures du matin, le 4 mars 2016, alors qu’elles servaient le petit-déjeuner à leurs pauvres, une meute de bêtes humaines fit irruption dans leur maison d’accueil et exécuta quatre des cinq missionnaires présentes (l’une a réussi à se cacher et a survécu) et seize volontaires innocents. Sœur Annselna, Sœur Judith, Sœur Margarita et Sœur Reginette : tels étaient les noms des religieuses assassinées, l’une était de nationalité indienne et les trois autres africaines. Il y avait eu des alertes de danger imminent. L’année précédente, l’église de Crater avait d’abord été pillée, puis incendiée. La condition des religieuses, comme celle de l’ensemble de la population yéménite, s’est compliquée avec la guerre civile qui éclata au début de 2015. Les missionnaires de la charité étaient la présence la plus vulnérable, la cible la plus exposée à la folie fondamentaliste. Mais elles décidèrent de ne pas abandonner le pays. Elles restèrent à Aden. Lorsque les bombes pleuvaient autour du couvent, elles se serraient fort sous les escaliers et priaient. « Nous vivons ensemble, nous mourons ensemble », écrivirent-elles à la mère supérieure, quelques mois avant leur mort.
Le texte de la lettre fut révélé par Tv2000 le 12 mars 2016. A cette époque, j’étais directeur de l’information de la radio de la Conférence épiscopale italienne et ce fut une profonde émotion de découvrir l’existence de cette lettre et de pouvoir la diffuser : « Chaque fois que les bombardements deviennent violents, nous nous agenouillons devant le Saint-Sacrement, suppliant Jésus miséricordieux de nous protéger, ainsi que nos pauvres, et d’accorder la paix à ce pays. Nous ne nous lassons pas de frapper au cœur de Dieu, certaines que tout cela prendra fin. Alors que la guerre se poursuit, nous essayons de calculer si nous aurons assez de nourriture. Les bombardements se poursuivent, les coups de feu fusent de tous côtés et nous n’avons de la farine que pour aujourd’hui. Comment allons-nous nourrir nos pauvres demain ? Avec une confiance pleine d’amour et un abandon total, nous courons toutes les cinq vers notre maison d’accueil, même lorsque les bombardements se font lourds. Nous nous réfugions parfois sous les arbres, pensant que c’est la main de Dieu qui nous protège. Puis nous courons à nouveau en toute hâte pour rejoindre nos pauvres qui nous attendent, sereins. Ils sont très âgés, certains sont aveugles, d’autres ont un handicap physique ou mental. Nous commençons immédiatement notre travail en nettoyant, en lavant, et en cuisinant en utilisant les derniers sacs de farine et les dernières bouteilles d’huile, précisément comme l’histoire du prophète Elie et de la veuve. Dieu ne peut jamais manquer de générosité tant que nous restons avec lui et ses pauvres. Quand les bombardements sont lourds, nous nous cachons sous les escaliers, toutes les cinq toujours ensemble. Nous vivons ensemble, nous mourons ensemble avec Jésus, Marie et notre Mère ».
Lucio Brunelli
Le blog de Lucio
Cet article a été publié sur le blog de Lucio Brunelli journaliste, vaticaniste del Tg2, directeur des journaux de Tv2000 et InBlu2000, radios de la CEI. Il se définit aujourd’hui de « journaliste émérite, dans le sens de retraité », et raconte sur son blog ses plus belles rencontres.
luciobrunelli.com









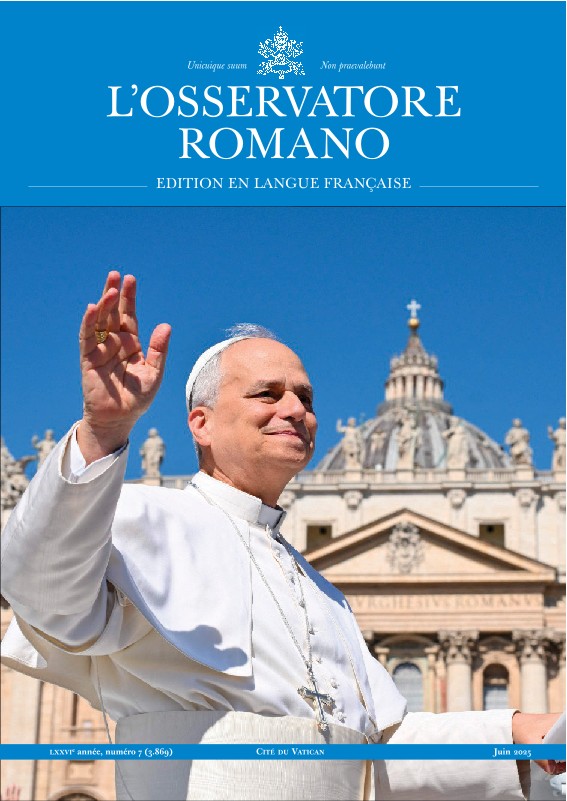



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
