
Il leur proposa une autre parabole : « Il en va du Royaume des Cieux comme d’un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, il a semé à son tour de l’ivraie, au beau milieu du blé, et il s’en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épis, alors l’ivraie est apparue aussi. S’approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent : "Maître, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il s’y trouve de l’ivraie ?" Il leur dit : "C’est quelque ennemi qui a fait cela. " Les serviteurs lui disent: "Veux-tu donc que nous allions la ramasser ?" "Non, dit-il, vous risqueriez, en ramassant l’ivraie, d’arracher en même temps le blé. Laissez l’un et l’autre croître ensemble jusqu’à la moisson ; et au moment de la moisson je dirai aux moissonneurs : Ramassez d’abord l’ivraie et liez-la en bottes que l’on fera brûler ; quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. " ».
Matthieu 13, 24-30
Chaque nuit, chaque jour, l’ivraie croît silencieusement autour de moi et en moi. A six heures du matin, tous les matins, alors que le café chauffe, je vide, encore étourdie, le lave-vaisselle, dans une cuisine étroite où les chiens et les chats affamés entravent mes mouvements. Je jette avec irritation la vaisselle dans le placard, le lait bout et se répand sur la cuisinière, mais je n’ai pas le temps de nettoyer. La nourriture pour les animaux déborde des bols, inondant le sol : chiens et chats grignotent en silence, me jetant des regards intimidés. J’appelle les enfants, leur criant qu’il est l’heure de se lever, de prendre le petit-déjeuner, que les vêtements et les sacs à dos ne sont pas prêts, ni les goûters. Alors ils se réveillent étourdis, agités, et la petite commence à accuser sa sœur de lui avoir pris son sweat-shirt rose. Il est déjà sept heures et le sweat-shirt est introuvable, et bien sûr qu’il est introuvable parce que votre chambre est en désordre et que tout ce que vous n’avez pas envie de plier, vous le jetez par terre ou vous le mettez à laver !
A sept heures et demie, en criant, je sors et démarre le moteur pour le faire chauffer : tandis que je klaxonne avec insistance parce qu’ils doivent se dépêcher de descendre, je lève les yeux et je vois encadrée de bleu la cime arrondie du Mont Subasio. Elle est recouverte de neige fraîche. Il a neigé la nuit dernière et je ne l’avais même pas remarqué avant, lorsque j’ai ouvert les volets. Le sommet est un énorme pandoro tout mou, saupoudré de sucre glace, qui invite tout le monde à s’approcher et à s’asseoir à la table de fête.
Et c’est là que je voudrais aller : dans ce blanc riche de paix. Mais je veux aussi y aller avec les enfants, avec les chiens, avec les chats, parce que seule, je ne saurais pas quoi faire de cette sérénité éblouissante. Ainsi, quand les enfants sautent dans la voiture avec leurs tabliers pas encore attachés, et que je lis dans le rétroviseur leur peur de moi, j’ai honte. Je fixe mon regard sur le mont Subasio et sa blancheur innocente et joyeuse contribue à désinfecter mon cœur des bouillonnements de noirceur. Je le laisse agir avec soumission. Me déchirer dans la culpabilité me renverrait aux prisons séduisantes de mon ego. Je m’accepte telle que je suis : j’accepte d’être un champ, limité et exposé, dans lequel les graines germent et produisent des plantes mauvaises et bonnes, que j’ai du mal à distinguer. Ce sont des graines qui ne sont pas les miennes. Mais je ne veux pas avoir peur. Apprendre plutôt la douceur. C’est à moi, terrain, de vivre en supportant l’absurdité du mal, de l’accueillir en moi et hors de moi. Sachant que, de façon inattendue, aussi soudaine que l’éclair d’une épée, comme un coup qui éclaire, le discernement arrive : juste au moment où les griffes de l’ivraie semblent être sur le point de submerger le blé. C’est alors que l’ennemi révèle son visage et que le champ cultivé peut enfin devenir un champ de bataille. Résister aux attaques du mal, en gardant le regard fixé sur ce blé au nom duquel on combat.
Et en ce froid matin de février, je reconnais une joie impensable qui risquait de m’échapper et qui, au contraire, s’est épanouie dans le champ, pour moi, précisément pour moi : la beauté de la neige, la présence de mes enfants. J’allume la radio et on fonce à l’école en chantant. D’abord avec hésitation, puis à tue-tête.
Dans le tableau intitulé L’ange blessé, du peintre finlandais Hugo Simberg, deux garçons ont eu, comme moi, l’occasion de percevoir le mal en eux et d’y réagir. Ils transportent un ange blessé sur une civière. Eux. Ils ne s’attendaient pas à cette inversion des rôles : c’est eux qui devaient être guidés, aidés, secourus. C’est eux qui, chaque soir, récitaient avec dévotion la prière de l’ange gardien avant de s’endormir paisiblement, la conscience libre de tout remord. Mais un après-midi, dans un pré près de la maison, ils avaient eu une dispute furieuse. La colère et la haine s’étaient enflammées en eux, leurs cœurs étaient devenus noirs, leurs langues avaient sifflé des mots violents, des mots empoisonnés.
Il est difficile de se souvenir de la raison.
En essayant de les calmer avec des mots doux et sincères, murmurés dans leur esprit, en essayant de les séparer en flottant entre les garçons qui commençaient à se battre, l’ange gardien se blessa à une aile et tomba. En entendant ce bruit sourd, les deux garçons s’arrêtèrent ; ils virent avec étonnement un ange en sang au milieu d’eux ; ils se regardèrent longuement dans les yeux tandis que la haine s’estompait et, libérés, ils redevinrent deux garçons. La honte qu’ils sentirent grandir en eux ne les paralysa pas : avec des bâtons, ils construisirent une litière et l’un d’eux sortit un mouchoir blanc de la poche de sa veste pour panser les tempes écorchées de l’ange. Ils le soigneraient, et ce seraient eux qui le protégeraient cette fois, qui le réconforteraient : ils lui cueillirent un bouquet de jonquilles pour qu’il leur pardonne, et, accélérant le pas, ils se mirent en route avec précaution.
Elena Buia Rutt









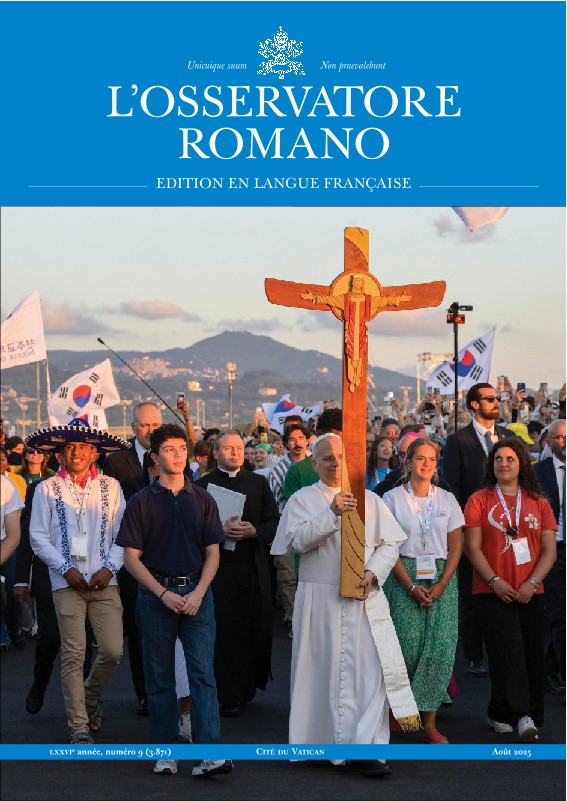



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
