Les monastères

L’expérience des clarisses capucines, dites les Trentatré, de Naples
Quand je sonne à l’interphone de via Pisanelli n. 8, je ne suis pas seule : trois mille ans d’histoire marchent jour et nuit le long de cette rue, qui est le cœur du cœur de Naples, le troisième decumanus, celui que les touristes ne fréquentent pas, et qui depuis le Moyen-âge est appelé l’Anticaglia.
Ce nom est dû au grand amphithéâtre où chanta Néron, englobé par les courbes des bâtiments, dont les arcs séparent encore les fenêtres via Pisanelli, et dont la cavea apparaît sous une maison sans fenêtre au niveau de la rue, un « basso » typique : la maîtresse de maison ouvre la porte aux visiteurs, en déplaçant le lit pour les faire descendre dans le temps à l’époque de l’empire romain, dans le quartier où les Alexandrins organisaient des courses aux flambeaux.
Mais ce ne sont pas seulement les traces grecques et romaines qui rendent l’Anticaglia précieuse : ici est stratifiée l’histoire sacrée millénaire de la ville. Sur les lieux mêmes où s’élevaient les temples de Caponapoli, de l’époque du duché byzantin jusqu’au dix-neuvième siècle, le long de cette rue qui coupe l’acropole de Parthenope se sont superposés des monastères et des églises, à l’époque angevine, aragonaise, espagnole. Un chevalier aragonais en pose aulique scrute les passants dans la cour du Palais Bonifacio, entre le linge étendu et un chauffe-eau. Un peu plus loin, il y a la maison du poète Torquato Tasso.
Et c’est là, via Pisanelli 8 que se trouve le dernier monastère de clôture de Naples, demeuré intact depuis sa fondation au seizième siècle, voulue par la vénérable Maria Lorenza Longo, dame catalane miraculée par la Vierge de Lorette, dont la cause de béatification est en cours. Nous sommes à Santa Maria di Gerusalemme, c’est-à-dire le Monastère dit des Trentatré (Trente-trois), où la règle impose qu’il n’y ait jamais plus de trente-trois sœurs accueillies, une pour chaque année du Christ. L’histoire de Maria Lorenza Longo est célèbre, parce que Naples (et l’Europe) lui doivent le premier hôpital public ouvert également aux pauvres de l’Histoire, les Incurables, pôle et phare de science médicale pendant trois siècles, siège d’une somptueuse pharmacie du dix-huitième siècle et d’un musée des arts sanitaires. Il fallut une femme pour penser à un hôpital qui ne fasse pas de distinction entre riches et pauvres, tout comme, trois siècles plus tard, il fallut une autre femme, Teresa Filangieri, pour imaginer un hôpital consacré uniquement aux enfants, l’actuel Santobono, le plus ancien hôpital pédiatrique au monde.
Je sonne ainsi chez les clarisses capucines des Trentatré précisément parce que, si ce sont les femmes qui accomplissent de grandes œuvres, ce sont toujours les femmes qui ne sont pas reconnues ni récompensées pour leurs intuitions ou vocations : par exemple, les religieuses ne sont pas soutenues économiquement par l’Eglise, elles ne reçoivent pas d’aides financières, à plus forte raison si elles font profession d’absolue pauvreté comme les clarisses capucines de la vénérable Longo.
Comment fait un monastère du seizième siècle, avec tous les frais de manutention qu’il a, pour se financer ? Comment font les Trentatré, qui depuis de nombreuses années, sont beaucoup moins nombreuses, pour vivre ? Je suis venue le demander à l’abbesse, sœur Rosa Lupoli.
Quand le portail de métal s’ouvre, une kinésithérapeute monte aussi avec moi, allant vers les pièces où se trouvent les religieuses plus âgées. Elle me dépasse à la hauteur du parloir, tandis qu’une sœur souriante me passe une clé pour que j’ouvre une petite porte et que j’entre dans une pièce avec des fenêtres de style renaissance donnant sur le jardin, austère et très simple, où j’attends sœur Rosa, le parloir.
Aujourd’hui, des chercheurs sont venus à l’improviste photographier la tête de Maria Longo, relique précieuse du Monastère, ainsi, j’ai le temps de profiter un peu du vent qui souffle entre les murs antiques en cette brûlante journée d’été. Mais une autre bouffée d’air doit arriver, avec sœur Rosa, qui a presque mon âge et semble une enfant, débordant d’intelligence, de joie et d’enthousiasme. Précisons tout de suite que nous avons continué de parler avec sœur Rosa bien au-delà de l’interview, partageant souvenirs et passions, mais la première question a été fondamentale : comment faites-vous ? Comment survit-on, avec quelles ressources économiques continue à vivre un monastère ?
L’indépendance totale des monastères féminins est depuis toujours considérée comme établie, de sorte que dans le monde laïc, la nouvelle semble même inédite, surprenante : le cas des Trentatré est encore plus spécifique, parce que la pauvreté personnelle est une condition obligatoire pour la profession solennelle. Les clarisses capucines entrent en clôture en renonçant devant un notaire, au moins deux fois, à tout bien personnel, héritage familial, et à tout éventuel héritage qu’elles pourraient recevoir à l’avenir de tierces personnes. L’origine de l’ordre, liée à sainte Claire, établit une authentique pauvreté : il faut vivre avec la Providence, jour après jour, ce que l’on reçoit en don gratuit. Et c’est tout.
Aucune propriété, donc, uniquement des dons, mais non continus, et, à la limite, un travail artisanal : en d’autres temps, le monastère était célèbre pour les statues de cire et pour la production de broderies de soie sur les parements religieux mais aujourd’hui, avec un nombre très réduit de sœurs et l’âge élevé de celles-ci, ces activités ont disparu.
Alors, comment mange-t-on ? Comment se procure-t-on des médicaments ? Et les dépenses de l’antique bâtiment ? Parce que celles-ci retombent également entièrement sur les habitantes du monastère : récemment, raconte sœur Rosa, les tuyauteries se sont cassées. Et au prix de grandes difficultés, elles ont obtenu le raccordement au gaz de ville pour le chauffage. Comment payer ces dépenses ?
Par ailleurs, la surintendance établit des projets et des plans, dans le respect du caractère antique et historique du bien, qui avec l’Unité d’Italie, est devenu la propriété de l’Etat : mais, à part les vérifications, elle ne dépense pas un euro. Les Trentatré, qui sont aujourd’hui huit, vivent donc de dons volontaires qui arrivent à Noël ou à Pâques. Certaines des sœurs qui étaient présentes dans le monastère au cours des années qui ont suivi le tremblement de terre de 1980 ont bénéficié d’une minuscule retraite sociale, qui s’est ensuite interrompue.
Parmi les obligations laissées par la vénérable Maria Longo, c’était aux Incurables de s’occuper des Trentatré, mais en réalité, raconte sœur Rosa, l’hôpital a toujours tenté de se libérer de cet engagement et, dans le même temps, de s’approprier de certaines parties du monastère : ce n’est que récemment qu’elles ont récupéré le dispensaire historique de traitement contre la tuberculose et le réfectoire décoré de fresques, et elles espèrent bientôt également éliminer le mur édifié au milieu du jardin claustral.
Quand elle est arrivée, il y a trente ans, sœur Rosa ne s’est pas découragée et a peu à peu récupéré le réfectoire décoré de fresques du couvent, et l’a confié à une Ong, l’Atrio delle Trentatré, qui accueille en échange de libres dons des concerts, des congrès et des expositions culturelles, mais elle ne me cache pas que certaines fois, elles ont dû accepter les repas de la Caritas.
Du reste, les cas d’ostracisme, de préjugés et d’abandon qui concernent les vœux monastiques des femmes sont anciens et incluent également une vision unilatérale et résolument antiféministe des faits : Quand on parle de vœux monastiques, on pense surtout à ceux forcés, ceux qui, au cours des siècles, ont produit l’image de la religieuse de Monza de Manzoni, tandis qu’est devenue invisible, oubliée et effacée l’action violente de l’abolition des ordres après l’Unité, qui vida par la force les monastères féminins de toute l’Italie, qui étaient très nombreux à Naples.
On comptait des milliers de moniales de tout ordre dans la ville : la ville leur doit également ne serait-ce que la tradition pâtissière des « sfogliate » et des « santarose ». Des ordres très antiques, des églises bien entretenues et très remplies. Avec l’Unité, réplique de l’action analogue bonapartiste un demi-siècle plus tôt, les monastères napolitains furent vidés, les sœurs déportées, les biens confisqués. Tout devenait propriété de l’Etat : et il y avait une raison à cela, étant donné la richesse artistique de certains de ces lieux, comme Santa Patrizia, monastère millénaire à San Gregorio Armeno, ou Santa Chiara, noyau de la religiosité liée au pouvoir angevin et aragonais. De cette gigantesque spoliation et de la violence infligée aux religieuses contraintes à rentrer dans le monde sans aucun soutien économique, la seule à avoir raconter cela est Matilde Serao.
Son roman de 1901, intitulé Suor Giovanna della Croce, est une fresque extraordinaire de l’évacuation du couvent de Sœur Orsola, un portrait de la peur et de l’incompréhension des religieuses de clôture jetées dans la rue du jour au lendemain, souvent privées d’une famille dans laquelle retourner, chassées de la dimension d’ascèse choisie avec un profond amour et désir, soustraites à une communauté, leur nouvelle véritable famille d’élection, jetées dans la panique par la perte de tout soutien économique. Si l’abbesse âgée du monastère revient, bien qu’avec douleur et confusion, à sa riche famille d’origine, sœur Giovanna, elle, endure la faim, les humiliations, les tromperies et les violences. A la pauvreté matérielle s’unit la pauvreté humaine qu’elle trouve dans les rues et dans les maisons : une sœur et un neveu qui la trompent, la volent et la chassent, l’humiliation de vendre des broderies à une prostituée, l’assistance à une femme en couches moribonde, le service dans la maison d’un juge brouillé avec son épouse.
L’angoisse profonde que communique le roman de Matilde Serao devient un fantôme tangible dans le parloir ventilé, en parlant avec sœur Rosa, surtout quand elle me raconte son histoire personnelle : originaire d’Ischia, une mère très dévote et une jeunesse très éloignée de l’Eglise, sœur Rosa a été une joueuse de volley-ball professionnelle, de treize à vingt-trois ans, elle a joué en série B, s’est diplômée en Lettres modernes à l’institut oriental de lettres. Puis un accident l’a empêchée de poursuivre le sport et c’est alors que s’insinue en elle le doute d’avoir laissé en suspens une question entre elle et Dieu. Elle commence à suivre et à étudier à la paroisse ; elle est l’unique femme inscrite à la faculté de théologie napolitaine. Mais c’est la décision d’une de ses amies, qu’elle ne fréquente d’ailleurs pas beaucoup, qui lui fait découvrir les Trentatré : le 3 février 1990, avec de nombreuses autres jeunes filles d’Ischia, elle accompagne Angela, qui a choisi la clôture, au tour du monastère. Il lui semble impossible que ce monde puisse l’intéresser ou l’attirer : elle voit son amie entrer, assiste au désespoir des parents d’Angela, puis s’informe. Elle parle longuement au tour avec sœur Chiara, à laquelle elle demande des informations et des explications.
Ainsi, en quelques mois, tout change : sœur Rosa entrera dans le monastère le 5 mai de la même année, et en verra sortir six ans plus tard Angela, son amie, restant quant à elle pendant trente très heureuses années. Ce n’est pas un parcours indolore : elle doit convaincre son curé, faire surmonter le choc à ses parents : il n’est pas évident que les personnes chères acceptent un choix si radical, qui inclut, précisément, de renoncer à toute sécurité économique (la sécurité, fausse divinité de notre temps).
Mais c’est de cet espace si serein, joyeux, qui ne méconnaît pas le monde (sœur Rosa est supporter de l’équipe de Naples, c’est elle qui a décidé qu’il devait y avoir un site mis à jour, une présence sur Facebook et une relation plus intense avec la ville, notamment grâce à l’Onlus qui organise des visites guidées dans les espaces accessibles des Trentatré), que vient la certitude d’une autre réalité.
Je demande à sœur Rosa qui se présente aujourd’hui à ce tour où elle vint un jour demander, qui pense à la clôture : ce sont souvent des femmes adultes qui viennent, âgées d’une quarantaine d’années, déçues par la vie, qui renoncent ensuite, qui ne comprennent pas que la clôture est un moyen et non un vœu.
Désormais, me dit-elle, on commence enfin à parler d’instituts consacrés à direction mixte, masculine et féminine ensemble, même si l’on a du mal à dialoguer avec la partie masculine de l’Eglise, peu intéressée, ne connaissant pas le monde monacal féminin.
Je sors de Santa Maria in Gerusalemme avec l’impression de voir encore plus silencieuse la magnifique Naples antique, privée d’autres voix, d’autres témoignages, de nouvelles vérités au féminin. Il semble impossible qu’ici aussi, précisément d’ici naisse la disparité que nous combattons encore et qui concerne les femmes. Pourtant, me semble-t-il, c’est précisément d’ici que viennent les véritables nouveautés, de cette clôture ayant survécu à l’Unité d’Italie parce qu’elle était si pauvre qu’elle n’intéressait les poches de personne.
Une pauvreté qui représente la plus authentique et antique richesse et dont nous devrions tous nous préoccuper un peu plus.
Antonella Cilento
L’auteure
Antonella Cilento (Naples) finaliste du Prix Strega en 2014 avec Lisario o il piacere infinito delle donne (Mondadori), a publié des romans, des recueils de récits, des reportages historiques.
Elle dirige depuis 1993 l’une des plus anciennes écoles d’écriture italiennes, Lalineascritta - Laboratori di Scrittura (www.lalineascritta.it) et coordonne le premier master d’écriture et d’édition du Sud de l’Italie, Sema, avec l’Université Suor Orsola Benincasa.
La caffettiera di carta (Bompiani) recueille ses presque 30 ans de leçons d’écriture. Elle dirige le festival de littérature internationale Strane Coppie.
Elle écrit pour le théâtre et La Repubblica - Napoli.









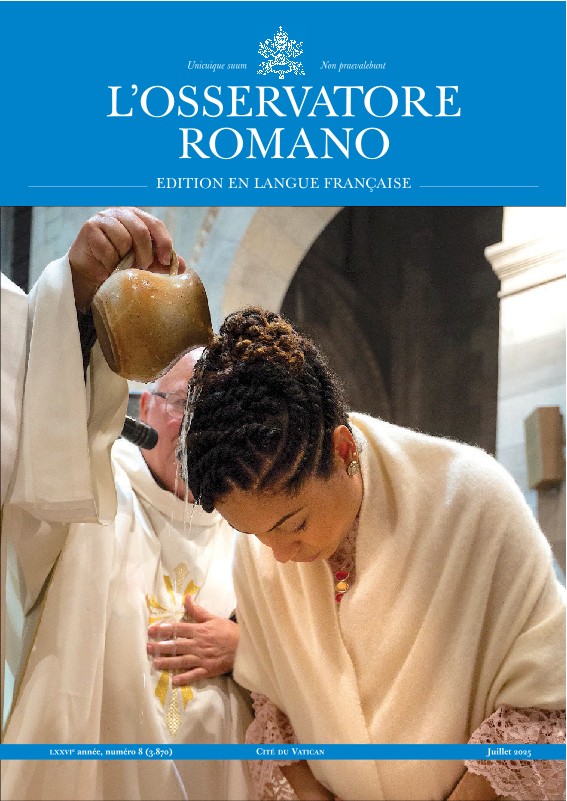



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
