
Adriana Zarri et les choix anticipateurs de Laudato si’
« Aspirante théologienne », « papesse prétentieuse ». Adriana Zari fut souvent apostrophée à travers des titres méprisants à une époque où les femmes n’avaient pas encore conquis une compétence et une parole théologique reconnue. Elle, en revanche, s’appropriait le droit à la parole et, à travers sa plume savante et fine, discutait, dénonçait, élaborait.
C’était les années précédant et suivant le concile Vatican ii, Adriana écrivait sur les journaux et les revues qui aspiraient à la réforme de l’Eglise, à une redécouverte des racines évangéliques : « Il Gallo », « L’Ultima », « Il Regno », « Settegiorni », « Rocca », arènes intelligentes de réflexion culturelle, spirituelle, sociale.
Sa voix prenait position sur les questions ecclésiales les plus brûlantes : autoritarisme hiérarchique, le rôle des laïcs et des femmes dans l’Eglise, compromis et complicités avec la politique, célibat et divorce, sexualité et contraception, se faisant le défenseur d’un « catholicisme adulte » et pensant. En 1962, elle publia un livre au titre évocateur, L’Eglise notre fille, dans lequel elle réclamait pour les laïcs pas moins que pour les ecclésiastiques un amour génératif, de pères et de mères, avec le devoir de signaler les « pathologies » et les déformations de la communauté des croyants. En 1967, avec le recueil d’essais Teologia del probabile (théologie du probable), elle relança de nombreux points brûlants et en suspens du débat conciliaire, en ouvrant un véritable chantier de discussion de l’identité catholique par rapport à la modernité.
Mais elle se sentait surtout écrivaine et penseur et, à travers des essais et des romans, elle se reconnut l’autorité d’élaborer sa propre théologie trinitaire personnelle, à l’époque en plein renouveau dans la pensée théologique et depuis lors perspective fondamentale de son expérience et de sa réflexion.
Sa vocation théologique était née prématurément, au cours des années de l’enfance.
Elle était née le 26 avril 1919 à San Lazzaro di Savena, aux portes de Bologne, après deux frères, dans une famille qui gérait un moulin. Son enfance, apparemment sereine, était en réalité agitée par un sentiment dramatique de refus de Dieu, résolu par une fulgurante révélation d’amour divin, qu’elle vécut comme une véritable « conversion », et le début de la recherche religieuse à l’âge de onze ans à peine.
Les paroles à travers lesquelles, dans des journaux inédits et de rares entretiens, Adriana évoqua cette expérience, qui se répéta dans sa vie, rappellent des pages suggestives de Simone Weil et Raïssa Maritain. Elle ressentit la certitude intérieure d’un Dieu proche, Présence porteuse de communion et de lumière : un amour passionné qu’elle allait ensuite retrouver chez Thérèse d’Avila et Catherine de Sienne et chanté, avec des paroles apprises du Cantique des Cantiques et de la littérature mystique, dans Tu. Quasi preghiere (1971).
Le lycée classique et la Jeunesse féminine d’Action catholique, fréquentés à Bologne où la famille s’établit en 1933, lui transmirent une solide formation culturelle et morale. L’institut religieux de la Compagnie de Saint Paul, dans lequel elle entra en 1942 animée par un esprit de « mystique apostolique et active contemplative », lui offrit d’autres opportunités d’approfondissement et d’étude.
Très tôt, Adriana nourrit l’exigence d’une spiritualité nouvelle, qui réévalue l’expérience humaine dans sa plénitude, en surmontant l’attitude pessimiste et mortifiante de l’éthique traditionnelle. Il fallait une nouvelle liberté, en dehors de toute sécurité de statut ou d’institution religieuse, pour partager l’humanité et l’histoire de tous.
Elle quitta la Compagnie en 1949, vécut dans un appartement à Rome, en vivant de façon précaire grâce à des collaborations de journalisme, se consacra à son écriture et à sa théologie. Ainsi virent le jour des essais comme Giorni feriali (1955), Impazienza di Adamo (1964), È più facile che un cammello… (1975), dans lesquels elle proposait son interprétation de Dieu et du monde.
Au milieu de sa vie, faisant trésor d’une sagesse intuitive dans laquelle elle identifiait des traits spécifiques de la pensée féminine, Adriana Zarri percevait un rythme trinitaire imprimé dans l’univers et dans l’homme : un rythme qui investissait la relation entre les sexes, le chemin de l’humanité, chaque dimension de la vie. Un rythme transmis à travers l’acte de la création et le don de l’incarnation d’un Dieu qui, en soi, était en relation trine et dialectique de Père Fils et Esprit.
Plus que l’élaboration théologique, c’étaient les catégories qu’elle tirait de cette pensée qui étaient créatives et vitales, signes des temps à la hauteur d’une époque, la deuxième moitié du vingtième siècle, qui favorisait des transformations rapides. L’image plurielle, communicative, bienveillante de Dieu détrônait la précédente figure monolithique, distante et redoutable ; elle redéfinissait le style humain et chrétien sur des valeurs comme la richesse de la diversité, la validité de la confrontation, la dynamique de la relation ; elle revalorisait des qualités féminines comme l’accueil, l’ouverture, l’écoute ; elle nourrissait le sentiment mystique, en renforçant l’intime persuasion d’une « solidarité totale » entre le Créateur et les créatures, d’un Dieu qui « est autre, mais est un Autre dans » la réalité et les choses, la conscience d’« une semence divine » est ensevelie « dans la mortalité » des êtres.
Ni systématique, ni académique, la réflexion d’Adriana Zarri bénéficiait de la connaissance de nombreuses sources de la pensée chrétienne passée et présente : des Pères de l’Eglise à Thomas d’Aquin, de Charles de Foucauld à Teilhard de Chardin, de Karl Rahner à Marie Dominique Chenu qui fut son correspondant affectueux.
La maturation d’une théologie et d’une spiritualité propres n’atténua pas la vis polémique de la parole d’Adriana, pas même quand, à la fin des années 60, elle donna vie à une expérience monastique-érémitique originale dans divers lieux de la campagne piémontaise : Albiano d’Ivrea, Molinasso, Ca’ Sassino. Le choix érémitique, soutenait-elle, avec sa perspective de détachement, n’apaisait pas ni n’isolait pas de l’histoire de tous, mais rendait la conscience critique plus aigue et plus vigilante. Elle continua à l’exercer dans ses romans (Dodici lune, 1989; Quaestio 98, 1994; Vita e morte senza miracoli di Celestino vi , 2008), sur les pages du quotidien Il Manifesto, à travers des émissions de radio et de télévision comme Samarcanda.
Ce fut, une fois de plus, un choix de liberté et de laïcité, étranger à toute institution ou vœu ecclésiastique, confié exclusivement à une promesse intérieure fortement ancrée. Un choix qui dérangea ou fascina en raison de sa radicalité ressentie un peu comme exotique à une époque où commençait à s’éveiller en Italie l’intérêt pour la vie érémétique. Adriana accepta des entretiens et des services photo sur la presse populaire de l’époque, mais épousa ce choix avec une rigueur et une cohérence absolues, en réalisant « simplement » la vie « qu’elle voulait vivre », comme l’observa le journaliste Sergio Zavoli dans un admirable article.
Conjuguant essentialité et pauvreté à travers le langage de la beauté, elle restitua grâce et splendeur à des objets et des environnements abandonnés, fit fleurir des jardins et des potagers, donna une nouvelle vie à des terres désertiques. Ses ermitages devinrent des oasis d’harmonie retrouvée, des lieux où étaient accueillis, sans préjugés ni discriminations, des chrétiens mal à l’aise avec l’institution ecclésiastique et ceux qui aspiraient à un Absolu auquel ils n’attribuaient aucun nom : des espaces d’ample souffle à une époque où, dans l’Eglise, comme on l’écrivit, « il manquait un souffle ». Y trouvèrent une hospitalité des âmes intensément religieuses, comme le moine camaldolais Benedetto Calati, ou fièrement laïques, comme la journaliste et intellectuelle Rossana Rossanda, et nombre d’amis affectueux qui accompagnèrent Adriana jusqu’à son dernier jour, le 18 novembre 2010.
Elle habita ces demeures isolées comme l’anticipation d’un Eden promus et cru, prémisse d’une vie sans fin dont elle se sentait déjà partie prenante, « immergée », comme elle aimait l’écrire, dans la « communion cosmique ». Elle put y réaliser cet esprit contemplatif qu’elle avait toujours ressenti comme sa vocation la plus véritable.
Elle devint maîtresse de prière et de nouveaux équilibres entre humanité et nature et en parla dans Nostro Signore del deserto (1978) et dans Erba della mia erba (1981), et à présent dans Un eremo non è un guscio di lumaca (2011). Plusieurs décennies avant que l’urgence environnementale ne fasse écrire à un Pape un document évangélique et révolutionnaire comme Laudato si’.
Quand, en 1996, la philosophe Luce Irigaray l’invita à une réflexion sur la qualité spéciale de l’âme féminine, elle écrivit : « Nous abandonner dans les bras cosmiques de la terre, nous abandonner dans les bras de la vie est la façon féminine de nous abandonner entre les bras de Dieu ».
Mariangela Maraviglia
Auteure de Semplicemente una che vive. Vita e opere di Adriana Zarri, Il Mulino.









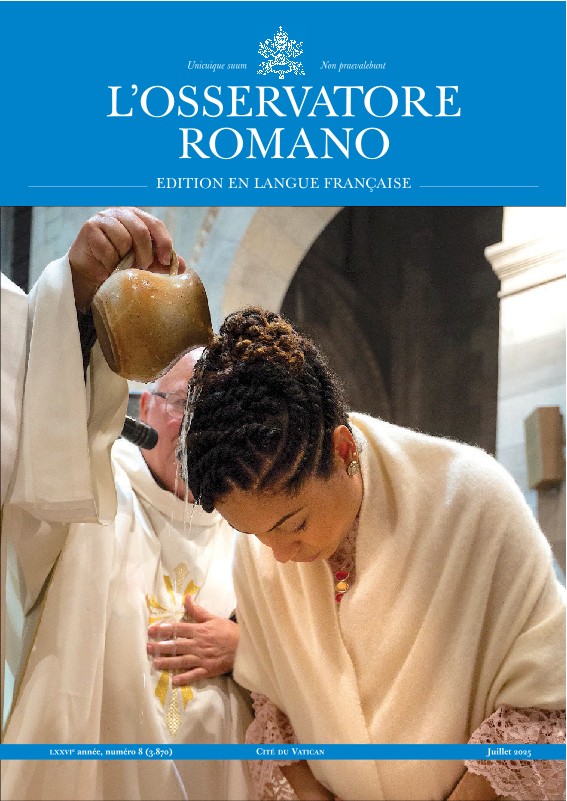



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
