
Deux miracles reliés, en particulier aujourd’hui où la pandémie, en accentuant l’isolement, accentue la solitude
La naissance est femme. Le miracle de la naissance ne peut pas avoir lieu sans que le corps de la femme ne devienne un sein accueillant et protecteur, jusqu’au passage dans la lumière.
Dans les moments cruciaux, la femme qui accouche est aidée par d’autres femmes: mère, sœurs, amies. La sage-femme est femme. La féminité est génératrice et maïeutique. Le début de la vie est rendu possible, encouragé, accompagné par un ventre, des mains, des bras, des voix, des chants, des prières, des gestes, des soins féminins.
Et cela vaut dans chaque culture et à chaque époque.
L’histoire même du salut, pour les croyants, commence ainsi. Par une incarnation, par le passage par la porte étroite d’un corps de femme et par la tendresse d’un toucher délicat et accueillant.
C’est peut-être pour la même raison, comme le dit un dicton d’une île de Guinée Bissau, qu’également «les choses de la mort sont des choses de femmes».
Et également dans l’histoire du salut, ce sont les femmes qui prennent soin de Jésus qui va mourir (Véronique qui lui essuie le visage sur le chemin du Calvaire), qui en accompagnent fidèlement la mort, au pied de la Croix (les trois Marie), qui pleurent sur son corps mort (comme dans la riche iconographie de la Déploration du Christ mort, de Giotto à Mantegna) qui assistent à la déposition au sépulcre, qui reçoivent de l’ange l’annonce de la résurrection.
Les femmes rendent témoignage et annoncent le miracle du salut, qui est pour tous: naissance, mort, résurrection comme des pas sur un unique chemin, où la mort est un pont entre la vie mortelle, dans le temps, et la vie immortelle, dans l’éternité.
C’est aux femmes que ce mystère est remis; ce sont elles qui en témoignent avec leur capacité d’engendrer et de laisser aller, en confiant à la vie le fruit de leur sein. Une dimension théologique qui réunifie le corps et le souffle de l’esprit, la terre et le ciel, le début, la fin et l’éternité dans un unique grand cadre de salut.
On doit encore beaucoup s’interroger sur ce mystère.
Des passages (qui ne sont plus) accompagnés
Dans chaque culture, le mystère de la mort, du passage a toujours été au centre d’une élaboration culturelle collective. Mais à partir de la modernité, qui a liquidé une grande partie de cette culture comme infantilisme et superstition, la cadre de sens dans lequel interpréter et réélaborer cette dimension inéluctable de l’existence est venu à manquer. C’est ce qu’a écrit, parmi d’autres, le sociologue allemande Norbert Elias dans La solitude du mourant: dans les sociétés que l’on définit comme avancées, on tombe malade, on vieillit et on meurt toujours plus souvent seuls, isolés de la communauté, dans des structures spécifiques spécialisées qui médicalisent la fin de l’existence et ôtent le malade et la personne âgée du regard d’autrui, le laissant en proie à l’angoisse.
Une condition que l’apparition du Covid a davantage radicalisée.
C’est la dimension du rite qui disparaît, cette forme particulière d’action sociale collective dont l’étymologie plonge dans l’idée d’ordre, de correspondance, de lien. Le rite produit du sens en reliant le ciel et la terre, l’immanent et le transcendant, et à l’intérieur de cette alliance, il crée les conditions pour un lien plus profond entre les personnes. C’est un langage qui parle à travers des éléments sensibles (le corps, les symboles), où chaque chose signifie elle-même et plus qu’elle-même; une séquence de gestes qui relie la communauté et les générations, dans une histoire partagée qui demeure au-delà de ce qui passe.
De même que l’on vient au monde grâce à d’autres et avec d’autres, la mort doit aussi être accompagnée. Et ce sont surtout les femmes qui dirigent ces moments de passage et de transmutation.
Les rites funèbres sont typiquement des rites de passage et d’accompagnement à la mort, caractérisés par la triple structure séparation/marge/agrégation. La veillée du défunt pour élaborer le détachement, le rite d’accompagnement à la sépulture, les prières pour les âmes des morts qui, de leur nouvelle condition, peuvent veiller sur les vivants s’insèrent dans ce schéma qui organise la vie sociale dans ses moments les plus cruciaux. Mais également toutes les coutumes qui renforcent le lien entre le monde des morts et celui des vivants, comme celle présente dans de nombreuses régions d’Italie de “mettre le couvert pour les morts ” lors des jours de novembre consacrés à leur mémoire, en cuisinant leurs plats préférés et en s’échangeant des souvenirs, pour conserver vivante leur présence entre les générations.
De cette manière, la mort, qui est également abîme et mystère, peut devenir une partie de notre quotidien, comme une fenêtre de sens. C’est l’invitation de la poétesse Mariangela Gualtieri: «Rends la mort familière en l’habitant».
Les rites sont un langage pour habiter la mort, pour la rendre familière, pour transformer le déchirement du départ en un nouveau lien entre le ciel et la terre, qui renforce également le lien entre ceux qui restent.
C’est de ce lien mystérieux mais prégnant que parle Cristina Campo dans l’une de ses poésies: «Je ne prie jamais pour les morts, je prie les morts. L’infinie sagesse et clémence de leurs visages – comment peut-on penser qu’ils aient encore besoin de nous? A chaque ami qui s’en va, je parle d’un ami qui reste; à cette infinie politesse sans rides, je rappelle un visage d’ici-bas, torturé, titubant».
La sécularisation a effrité le cadre de sens qui relie la mort à la résurrection, alors que l’individualisation nous a laissés seuls pour affronter le moment du détachement, qui devient simplement une fin, un anéantissement, une dissolution de ce qui a été.
Banaliser le rite, le vider ou le ridiculiser signifie priver l’individu d’un soutien collectif et d’un horizon de sens, en le laissant seul avec lui-même, écrasé par l’angoisse et muet, sans espérance face à la mort.
Effacer le rite empêche également de voir que la vie n’est pas une vraie vie si elle prétend faire disparaître la mort de son horizon, comme une présence gênante, mais qu’elle le devient seulement si elle l’assume comme une partie d’elle-même.
Deux miracles, un paradoxe
“Les vivants ” sont également appelés “les mortels ”. Notre existence se déroule entre le moment de la naissance et celui de la mort, “notre sœur la mort corporelle à laquelle nul homme vivant ne peut échapper ”, comme l’a écrit saint François.
Naissance et mort, deux miracles liés. Deux signes qui continuent à susciter l’émerveillement, l’étonnement, l’effroi; deux brèches par lesquelles fait irruption l’inouï dans la répétition de notre existence, qui la transforment de manière irréversible; deux symboles, deux moments d’une histoire plus grande, lourde de mystère et d’espérance pour tous.
S’il n’y avait pas un lien, pas même le miracle de la transformation de la mort en vie, que nous voyons pourtant se produire autour de nous si nous apprenons à la reconnaître, ne serait possible: des parents qui, à partir de la perte d’un enfant, commencent un parcours de renaissance en faisant quelque chose pour d’autres; des traumatismes qui, au lieu de détruire, ouvrent une possibilité inouïe d’existence; des vies dans lesquelles le fait d’avoir tout perdu inaugure une nouvelle allure et entrouvre un horizon de plénitude.
Nous ne devons donc pas penser la vie et la mort comme l’une étant le contraire de l’autre. Leur lien est paradoxal, il ne répond pas à la logique et au principe de non contradiction. C’est ce que nous dit l’Evangile (celui qui est disposé à perdre sa propre vie la trouve) et que nous raconte également notre temps, plein de douleur et de mort, de souffrance et d’angoisse, mais qui voit également fleurir tant d’humanité, tant de capacité de résilience nourrie par le soin et le dévouement pour les malades et les plus fragiles. Quelqu’un a perdu sa vie, mais paradoxalement il l’a sauvée, il l’a rendu entière, il lui a donné un sens qui ne finit pas avec la mort du corps, mais qui reste comme une promesse de plénitude dans laquelle d’autres peuvent avoir confiance. Un signe qui nourrit la vie.
Paradoxalement, ce temps où la mort ne peut pas être occultée, où chaque jour l’information présente des données sur les contaminations et sur les décès, est un temps de révélation d’une vérité sur la vie. C’est ce qu’écrivait Etty Hillesum dans son Journal: «Je sais, à présent, que la vie et la mort sont liées de manière significatives entre elles». Deux faces de la même réalité qui nous rend tous frères dans un destin commun.
Si nous concevons la mort comme sœur, au lieu d’une ennemi, notre regard sur la vie change.
Si les deux sont liées, et si le lien n’est pas d’exclusion, mais d’union paradoxale, un renversement de perspective devient possible, en particulier quand la mort se fait sentir plus fort - comme en ce moment.
En attendant, du point de vue de la mort la vie n’apparaît pas comme une donnée, mais comme un don. Comme la condition de la transformation, de ce dynamisme qui passe par la mort pour affirmer la vie (seul le grain de blé qui meurt donne du fruit). «Meurs et deviens!» écrivait Wolfgang Goethe. Et Rainer Maria Rilke écrivait ainsi: «La grande mort que chacun a en soi /C’est le fruit autour duquel tout change».
Et ensuite, alors que considérer la mort du point de vue de la vie angoisse, considérer la vie de la perspective de la mort fait voir davantage de vie, offre une amplitude nouvelle à notre existence qui trop souvent, écrasée sur un horizon d’urgence et d’immanence, est pâle et éteinte. Comme dans les vers de Patrizia Valduga: «Seigneur, donne à chacun sa mort, donne-la toute, rendue vraie par la vie; mais donne-nous la vie avant la mort, dans cette mort que nous appelons vie».
Il y a une vie mortelle et il y a une mort vitale. Les séparer et faire disparaître la mort, contrairement à ce que nous avons cru, ne fait pas du bien à la vie.
C’est ce qu’écrivait le jésuite scientifique et philosophe Teilhard De Chardin: «La mort est chargée de pratiquer, jusqu’au plus profond de nous-mêmes, l’ouverture nécessaire».
Et Etty Hillesum le reconnaît elle aussi dans son journal: «La possibilité de la mort s’est parfaitement intégrée dans ma vie; celle-ci est rendue comme plus ample par celle-là, du fait d’affronter et d’accepter la fin comme partie de soi. Cela semble presque un paradoxe: si l’on exclut la mort, on n’a jamais une vie complète; et si on l’accepte dans sa propre vie, celle-ci s’amplifie et s’enrichit».
Maintenant que la mort ne peut pas être exclue, que nos délires de toute puissance ont subi un échec, que nous avons compris que nous sommes tous liés entre nous (un virus a servi à le démontrer) et que nous avons besoin de donner un sens, ensemble, à ce temps, peut-être pouvons-nous jeter un regard nouveau sur la vie. Et apprendre le mouvement que suggère Cristina Campo dans l’un de ses vers: «Avec un cœur léger, avec des mains légères, prendre la vie, laisser la vie».
Chiara Giaccardi









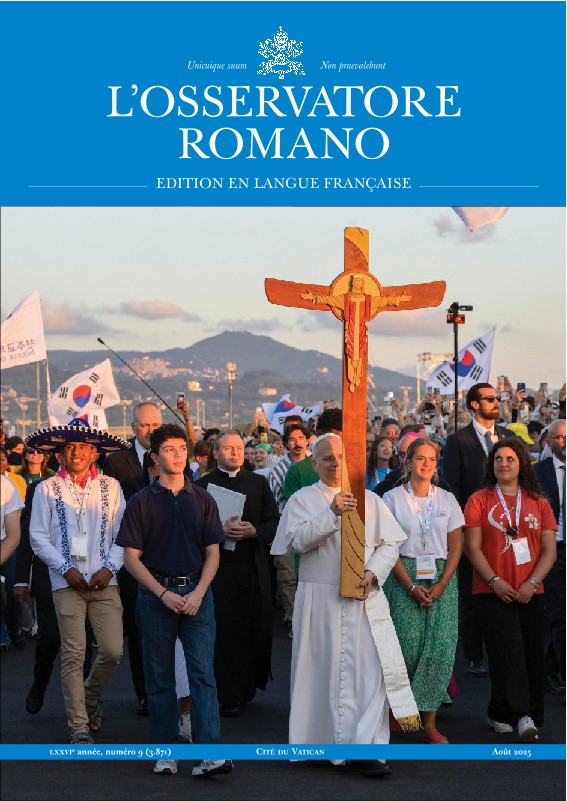



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
