
... des femmes a marqué les relations entre les genres en Occident
Dans quelle mesure également dans l’Eglise ? L’analyse d’une historienne théologienne
A la fin des années 1300, un confesseur inquiet, Jean le Graveur, s’attacha à transcrire les visions d’Hermine de Reims, une jeune veuve considérée comme « folle ». De ces rêves imaginatifs émergeait une femme qui souhaitait quitter l’étroitesse de sa maison et voyager à travers le monde, qui espérait se remarier et qui souhaitait se libérer du contrôle strict de son confesseur afin d’avoir un dialogue plus libre avec Dieu. L’étude de cet ancien manuscrit, qui nous est parvenu avec le commentaire de l’historien érudit André Vauchez, met en évidence la peur des hommes du passé face à toute manifestation d’autonomie féminine, la difficulté, dirons-nous, d’accepter des espaces de liberté pour les femmes : les rêves d’Hermine, en effet, furent jugés comme le résultat de tentations démoniaques.
La peur des femmes a été, et est encore dans de nombreux milieux, l’une des grandes craintes de l’Occident. En est-il de même dans l’Eglise ? Et dans quelle mesure ?
Depuis le Concile Vatican II déjà, le Magistère a fait preuve d’une attention et d’une sensibilité nouvelles envers les femmes défendues dans leur dignité et valorisées pour ce que Jean-Paul II appelait le génie féminin, mais il reste encore beaucoup à faire pour vaincre les résistances et les préjugés. Le Pape François lui-même a récemment affirmé que « nous devons aller de l’avant sans peur pour insérer les femmes dans les postes de conseil, même de gouvernement », montrant ainsi, entre les lignes, combien de difficultés existent encore pour accepter une participation féminine pleine, faisant autorité et responsable dans la vie de l’Eglise. La peur existe encore. Mais en quoi consiste cette peur à l’égard des femmes ? Un regard sur le passé peut peut-être aider à comprendre les raisons profondes de cette émotion primaire de défense que les hommes expriment en activant des pratiques de déni ou de marginalisation. Surtout parce qu’il n’en a pas toujours été ainsi.
La communauté des origines
Assurément Jésus n’avait pas peur des femmes. Plus encore, la libération la plus radicale des femmes a commencé avec lui. En effet, il a entamé un dialogue empathique avec les femmes, leur offrant une oreille attentive, une participation émotionnelle, des espaces d’action ; à elles, tout comme aux hommes qui le suivaient, il a adressé des messages de salut, annoncé les exigences du Royaume, demandé des choix radicaux. Les femmes n’étaient pas considérées comme une catégorie à part, à marginaliser ou à plaindre, et elles partageaient leur vie, leurs attentes et leurs actions avec le Maître de Galilée. Pour cette raison, les disciples étaient gênés et ne comprenaient pas sa façon mûre et équilibrée de se relationner avec les femmes et, surtout, ils avaient du mal à accepter sa manière d’être libre de tout conditionnements et tabous. En effet, si dans la culture juive le corps féminin était maintenu sous contrôle pour ne pas contaminer le sacré (Nombres 15, 38) et, par conséquent, était exclu des activités de culte par le biais de strictes réglementations, avec Jésus ce dernier n’est plus un lieu et une cause de ségrégation et d’exclusion car rien ne peut rendre une personne impure si ce n’est le mal qu’elle commet et qui naît du fond de son cœur souillé (Marc 7, 15). De la même manière, il s’est montré étranger à toute limitation préjudiciable : aujourd’hui, on le qualifierait d’homme inclusif. Il l’exprime bien dans le dialogue avec la Samaritaine où il explicite comment la présence de Dieu n’est pas liée à un lieu sacré (le Temple) et comment la relation avec le transcendant n’est pas le privilège d’une ethnie (hébraïque), d’une condition sociale ou religieuse (le ministre du culte) ou d’un sexe (masculin), mais est possible pour toute personne qui sait l’accueillir « en esprit et en vérité » (Jean 4, 23).
Avec le temps, les disciples de Jésus ne furent pas toujours cohérents avec son comportement libre : « Ils s’étonnaient qu’il parle avec une femme » (Jean 4,27), ils ressentirent une rancœur et se montrèrent jaloux de l’autorité de Madeleine (voir aussi les textes gnostiques), ils reproposèrent les rôles traditionnels (« Vous, les femmes, vous êtes soumises à vos maris ») et les anciennes structures patriarcales (« Que la femme écoute l’instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d’enseigner, ni de prendre de l’autorité sur l’homme; mais elle doit demeurer dans le silence.» (1 Timothée 2, 11-12). Et pourtant, dans les communautés des origines, nous trouvons des femmes, comme Lydie de Philippes, Tabatha, Priscille, Chloé, Nympha qui offraient l’hospitalité dans leurs maisons, véritables lieux d’accueil, de prière et d’évangélisation, ou alors des chrétiennes engagées dans le domaine de la charité, du diaconat, de la catéchèse, de l’évangélisation, de la mission et de l’apostolat comme les femmes mentionnées avec respect et gratitude par l’apôtre Paul : la diaconesse Phoebe, les missionnaires Priscilla, Evodia et Synthias, l’apôtre Junia, les évangélisatrices Tryphena, Trifose et Persis, les bienfaitrices Apfia et Nympha. Mais ni cette présence de femmes actives et collaboratrices, ni l’exemple de Jésus n’ont été décisifs pour donner une structure inclusive à l’église naissante qui a embrassé la culture et les structures patriarcales dominantes dans les sociétés environnantes avec lesquelles elle est entrée en contact. Madeleine a été vite oubliée (Saint Paul ne la mentionne même pas) et dénaturée (de disciple elle est devenue à partir de Grégoire le Grand une prostituée repentie), les diaconesses ont joué au fil du temps un rôle de plus en plus marginal, la prophétie féminine a été étouffée, les épouses ont retrouvé leur rôle d’épouses soumises, le corps des femmes est redevenu un tabou.
L’ancienne gynécophobie
Les auteurs chrétiens de l’Antiquité partageaient en grande partie l’anthropologie de la culture gréco-romaine, qui plaçait la supériorité de l’homme au centre, et étaient en grande partie d’accord pour réaffirmer l’imperfection et l’insuffisance de la nature de la femme, née pour être soumise à l’homme. Et pour saint Augustin, si les deux sexes ont été créés à l’image de Dieu dans une égalité spirituelle substantielle, la subordination féminine était néanmoins déterminée par l’ordre de la création. Cette conception a traversé le christianisme, renforcée par la rencontre avec l’anthropologie d’Aristote : le genre masculin était le modèle de l’humain et la femme un homme raté. Cette vision a été acceptée et intégrée dans la philosophie scolastique et, plus précisément, dans la théologie de Thomas d’Aquin, constituant au fil des siècles le fondement de l’incapacité du genre féminin à la fois pour accomplir les tâches de pouvoir et pour représenter l’image même de Dieu. Le peu de connaissance de la physiologie féminine, la peur d’être contaminés par une personne porteuse d’impuretés, ont accru les craintes des hommes vis-à-vis de la sexualité des femmes, et conduit à les brider et les éloigner des lieux sacrés. Rappelons-nous le franciscain Alvaro Pelayo qui, dans De statu et planctu ecclesiae, a exposé cent deux raisons pour démontrer non seulement l’infériorité, mais aussi le danger de la femme, « origine du péché, arme du diable, expulsion du paradis, mère de l’erreur, corruption de la loi antique ». L’obsession pour le corps féminin, désiré et en même temps refusé et rejeté, apparaît avec force dans les traités contre les sorcières, manifestant une peur croissante envers les femmes qui sont devenues pour quelques siècles les boucs-émissaires d’angoisses anciennes et profondes.
De même, la loi sur le célibat ecclésiastique, qui s’est affermie au XIIe siècle lors d’un processus consolidé d’institutionnalisation de l’Eglise, favorisa inévitablement l’affirmation d’une conception négative de la femme, qui était éloignée des lieux sacrés parce que considérée comme impure. La transgression continuelle de la part du clergé a conduit le Concile de Trente à mettre en œuvre une approche éducative plus large et plus appropriée, visant, à travers l’institution de séminaires, à la formation spirituelle et culturelle du clergé, sévèrement éduqué et séparé du monde laïc. La pédagogie de Paolo Segneri, qui a identifié chez la femme le point de danger le plus élevé, en est un signe éloquent ; dire corps signifiait indiquer une menace permanente à la vie vertueuse. D’où la multiplication des préceptes dans lesquels le soupçon de péché pèse sur la nature même de la femme, perçue comme menaçante, et qui caractériseront l’Eglise de la Contre-Réforme jusqu’au seuil du Concile Vatican II.
Le dépassement de la peur
Il est certain que la dévotion mariale contribua à redécouvrir la dignité de la femme et inspira certains fondateurs, parmi lesquels Guillaume de Verceil, à projeter une double communauté (masculine et féminine) dirigée par une femme, l’abbesse. C’est le cas du monastère de Goleto et de son histoire passionnante, dont les vestiges sont encore visibles aujourd’hui en Irpinia. Mais, plus encore, il existe des exemples dans l’histoire de l’Eglise d’amitié féconde entre hommes et femmes. On ne pourrait pas comprendre autrement la compréhension, profonde et intense, entre Claire et François d’Assise qui proposent et vivent une fraternité-sororité dans laquelle est accueilli quiconque veut suivre le Christ pauvre et souhaite établir des relations de soutien mutuel. On ne pourrait pas comprendre les nombreuses expériences de vie religieuse, comme celles nées du travail commun de Francoise de Chantal avec François de Sales, de Louise de Marillac avec Vincent de Paul, de Léopoldine Naudet avec Gaspare Bertoni, pour n’en citer que quelques-unes. Nous ne pourrions pas nous prévaloir aujourd’hui de communautés innovantes nées des provocations prophétiques du travail missionnaire s’il n’y avait pas eu des couples de fondateurs comme Maria Mazzarello et don Bosco, Teresa Grigolini et Daniele Comboni ou Teresa Merlo et Giacomo Alberione. Et nous ne comprendrions pas les nombreuses amitiés qui se nourrissaient de la foi et des passions communes. Comment ne pas se souvenir, pour se rapprocher de nous dans le temps, du chemin mystique qui a uni Adrienne von Speyr à Hans Urs von Balthasar et de l’activisme culturel de Romana Guarnieri qui lia sa vie de façon indissoluble à don Giuseppe de Luca ? Ces exemples sus-mentionnés sont marqués par des relations intenses de profonde harmonie, d’affection intime et sincère, de pudeur mystique. L’amour, en se sentant enraciné dans le Christ, devient le dépassement des peurs, un espace de liberté et de maturation, reformulant les relations entre la femme et l’homme dans la dimension amicale du soutien mutuel.
Le retour à l’utopie
Aujourd’hui cela a-t-il encore un sens de parler de la peur des femmes ? Personne ne croit plus aux sorcières, et de nombreux autres boucs-émissaires ont catalysé les peurs de l’humanité. Enfin s’est affirmée une culture des genres anti-discriminatoire et le Pape François a entamé un processus fondamental de décléricalisation de notre Eglise, sollicitant en permanence la présence significative des femmes dans les structures de la communauté ecclésiale. Cependant, malgré les nombreux changements culturels auxquels nous participons, les institutions ecclésiastiques ont de la peine à accepter les femmes dans des rôles de responsabilité. Probablement parce que l’on n’a pas assez travaillé sur la formation du clergé qui, parfois, comme l’a récemment déclaré le cardinal Marc Ouellet, « n’a pas une relation équilibrée avec les femmes », parce que le clergé n’a pas été éduqué à interagir avec elles à travers des échanges et des confrontations. Un travail pédagogique profond est donc nécessaire avec les hommes qui devraient réfléchir sur eux-mêmes et sur leur propre masculinité souvent violente, sur la difficulté d’accueillir la diversité et la fragilité humaine, et sur la complexité du partage des sentiments et des projets avec l’autre sexe. Ils devraient apprendre à aimer les femmes, en les reconnaissant comme des singularités, en acceptant de partager avec elles l’autorité et la responsabilité. Peut-être conviendrait-il alors de reprendre la vision poétique et utopique de certains textes sacrés. Dans le récit mythique des origines, en effet, la rencontre entre Adam et Eve n’est pas marquée par la peur, mais par l’émerveillement de la découverte d’un « toi » dans lequel se refléter. Dans le même horizon poétique se trouve le Cantique des Cantiques, qui reprend et exalte la réciprocité des genres dans un extraordinaire chant d’amour où c’est la femme, autonome et responsable, qui se reconnaît dans l’homme, qui met de côté son comportement prévaricateur pour trouver refuge en elle. Dans l’amour, les logiques de la domination disparaissent et la peur n’a aucune raison d’exister.
Adriana Valerio
Historienne et théologienne, professeure d’histoire du christianisme et des Eglises à l’université Federico II de Naples, auteure du livre « Donne e Chiesa. Una storia di genere», (Femme et Eglise. Une histoire de genre), Carocci, et «Il potere e le donne nella Chiesa», (Le pouvoir et les femmes dans l’Eglise), Laterza.









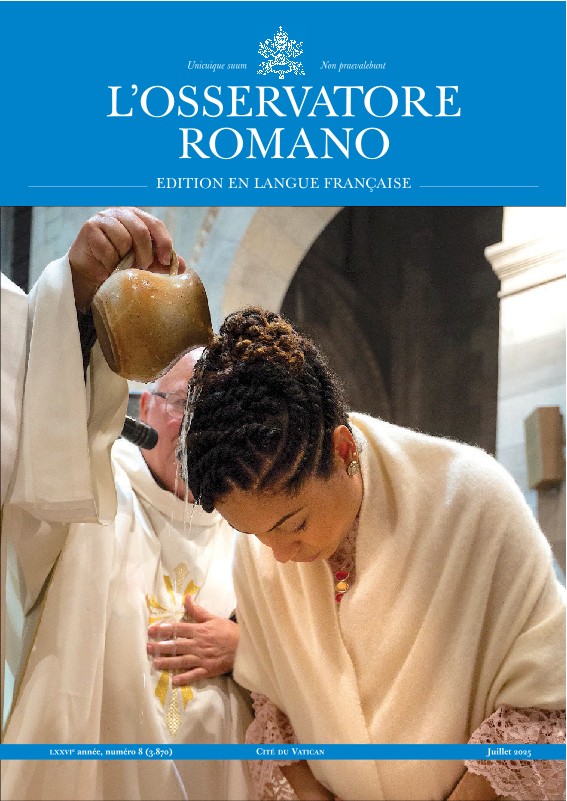



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
