
Avocate des opprimés, tuée le 13 mars il y a trente-huit ans au Salvador. Une biographie parallèle à celle de Monseigneur Romero
Raconter l’histoire de Marianella Garcia Villas signifie non seulement tirer de l’oubli la vie et la mort d’une jeune femme forte et courageuse, amoureuse des parfums, mais aussi célébrer sa mémoire, une liturgie pascale. Le pain rompu de sa vie avec les pauvres, le sang versé pour les femmes et les hommes opprimés.
Il y a trente-huit ans, les militaires de son pays l’a capturèrent et la torturèrent pendant des heures. Son corps a été retrouvé le 13 mars 1983.
Née en 1948 dans une famille de la haute bourgeoisie du Salvador, de mère salvadorienne et de père espagnol, Marianella étudie à Barcelone dans le riche et prestigieux collège religieux Las Teresianas où les religieuses, outre l’équitation et le violon, offrent à leurs élèves la possibilité d’enseigner le catéchisme aux enfants du barrio de La Torraza. C’est là que Marianella, adolescente, croise pour la première fois le regard de ceux qui ont faim et froid, les visages des enfants des rues et des adultes marqués par la pauvreté. A partir de ce moment, ses yeux ne cherche plus rien d’autre.
De retour dans sa patrie, au cours des années de l’Action catholique universitaire, elle commence à travailler à La Fosa, où les gens vivent dans des baraques, dans la misère et la précarité totale. Elle s’interroge et demande comment, dans un pays si catholique, jusqu’à son nom, peuvent être présentes et enracinées des formes d’injustice et de marginalisation. Elle encourage les groupes universitaires à la lecture de l’Evangile pour comprendre le « choix préférentiel des pauvres », en puisant dans les documents conciliaires et dans les textes relatifs à la théologie de la libération de l’historique Conférence de l’épiscopat latino-américain de Medellin en Colombie (1968)
Sa passion pour les études juridiques, pour la philosophie du droit et pour la politique active la conduira à devenir l’avocate du Secours juridique du diocèse de San Salvador, le diocèse d’Oscar Arnulfo Romero, et à fonder et à présider la Commission des droits humains et à s’engager dans la démocratie chrétienne salvadorienne. Avant de faire des adieux indignés à son parti, en raison des arrestations et des persécutions des forces de sécurité du pouvoir démocrate-chrétien, Marianella fonde avec Maria Paula Perez le Mouvement des campesinos de mujeres democratas cristianas. Les deux femmes vont rendre visite aux paysannes dans des endroits inaccessibles, lisant la Bible avec elles, célébrant la Parole, analysant la réalité et essayant d’organiser un réseau de communautés et de familles engagées dans la défense de leurs droits.
Marianella aide les personnes à trouver « "le nom des mots", c’est-à-dire à identifier les choses, à les reconnaître, à les accepter ou à les combattre, et ensuite à savoir qu’au-delà du potager, ou du sommet de la montagne, au-delà du fleuve et de la mer, il y a d’autres hommes qui prononcent les mêmes paroles que leurs, même si c’est dans une langue différente, et qu’un pont peut être établi entre ces langues, un canal d’amitié et de solidarité » (Linda Bimbi, Il Margine, 1984). Elle vit la foi avec « une vraie passion, presque mystique pour l’homme, une réelle incarnation de l’amour ».
C’est en portant ce riche bagage de spiritualité incarnée, que née et grandit l’amitié particulière avec le Pulgarcito d’Amérique, l’archevêque aujourd’hui saint, Oscar Arnulfo Romero.
Chaque semaine, Marianella dépose son fardeau entre les mains de Romero : des photographies, des chiffres, des noms, des histoires, des blessures, des tortures, des preuves, des données qui, au contact du feu de l’Ecriture, se transforment en charbons ardents de sa prédication.
Elle lui apporte ces visages, capturés avec son autre œil, l’objectif d’un appareil photo, compagnon fidèle devenu un instrument de dénonciation et de preuve de la violation des droits humains. « Visages de campesinos sans terre, outragés par les forces armées et par le pouvoir. Visages de travailleurs licenciés sans raison, visages de personnes âgées, visages d’exclus, d’habitants de bidonvilles, visages d’enfants pauvres qui, dès l’enfance, commencent à ressentir la morsure cruelle de l’injustice sociale » (Homélie d’Oscar Arnulfo Romero).
Entre les mains de ce pasteur, elle dépose aussi sa douleur, la difficulté de poursuivre la lutte après avoir vu mourir des ami(e)s, la rébellion après ses arrestations et son silence tragique après l’agression sexuelle dont elle a été victime. Au récit froid et terrible de son viol, Romero éclate en sanglots, et ses larmes inattendues réussissent à apaiser la haine et à transformer le désir de vengeance en une nouvelle occasion de dénonciation impitoyable de la part de l’avocate Marianella.
« Violer une femme que l’on tient entre ses mains est considéré comme un acte de virilité, celui qui ne le fait pas avec une femme capturée, qui la respecte, est mis au pilori, moqué comme impuissant et ce sont les chefs eux-mêmes qui inculquent à leurs subordonnés ce mélange d’inculture, de machisme et d’aliénation. Ainsi, cette violence, qui a toujours existé, est devenue une pratique habituelle et institutionnalisée pour les corps de sécurité et pour l’armée » (entretien dans Marianella et ses frères, de Linda Bimbi et Raniero La Valle - Ed. Linda Bimbi 1983).
Le 24 mars 1980, cette sainte amitié semble s’interrompre. Romero est assassiné, comme annoncé et ordonné dans les sièges de la politique nationale, sans défense, malgré les recours aux tribunaux nationaux et internationaux, les enquêtes ouvertes par les organisations et par les associations de défense des droits de l’homme, et les voyages effectués par ce dernier à Rome, au Vatican, pour dénoncer cette situation, ainsi que par Marianella elle-même en Europe et en Amérique du Nord. La sentence est prononcée et exécutée : l’archevêque doit mourir, et c’est ce qui arrivera des mains d’un tueur à gages. Ce n’est qu’une suspension de l’amitié terrestre, car en ce même mois de mars, mois des ides et des luttes des femmes, trois ans plus tard, Marianella rejoindra son frère évêque et ses compagnes dans l’album des saints martyrs du Salvador. Le 13 mars 1983, un communiqué de presse informe que la terroriste, Marianella García, est tombée lors d’une fusillade. La seule arme retrouvée de la combattante pacifiste et non violente est l’appareil photo qui l’accompagne dans son travail de recherche de la vérité, cette vérité « splendeur de la réalité » de la bien-aimée Simone Weil. La réalité maîtresse de vie et de mort, avec sa dureté, son injustice, son côté négatif et sombre, celle qui brille dans la couleur livide des cadavres à l’intérieur de la chambre noire et qui, cependant, se transforme en source de sagesse, ou comme le dirait aujourd’hui la théologienne Antonietta Potente, en « mystique politique ».
« Le grand défi qui nous vient de l’histoire est l’effort pour devenir capables, sans éluder la réalité dans laquelle nous vivons, de prendre de la distance par rapport à cette même réalité et de l’interroger, de nous interroger pour chercher des réponses qui se trouvent au-delà de la surface des choses. C’est ainsi que nous passons d’une conscience naïve à une conscience critique, c’est ainsi que nous allons à la racine des faits et que notre vision devient plus complète et que nous parvenons à comprendre les causes et, au-delà des contradictions, à faire de la vie quotidienne un événement historique. Telle est la sagesse », écrivait-elle en 1981.
C’est l’héritage de la mémoire dangereuse d’une femme qui a fait et fait encore l’histoire.
Grazia Villa
Avocate spécialisée en droit des personnes









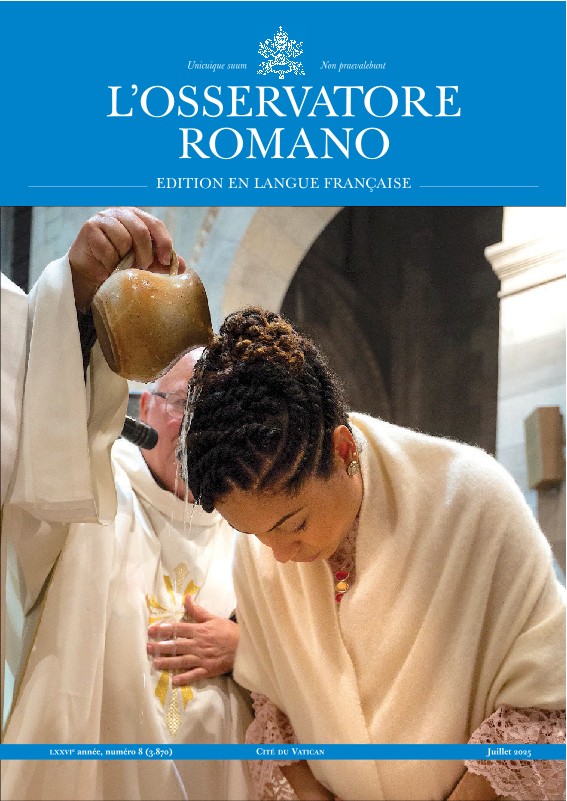



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
