Une lumière

«Je suis venu ici chez vous, pour vous remercier de votre témoignage et pour rendre hommage au peuple martyr de la folie du populisme nazi. Et je vous répète avec sincérité les paroles que j’ai prononcées du fond du cœur à Yad Vashem et que je répète devant chaque personne qui, comme vous, a beaucoup souffert à cause de cela: pardon Seigneur, au nom de l’humanité».
Le Saint-Père se lève pour saluer; il y a plus d’une heure qu’il est en conversation avec -Edith Bruck, mais avant de s’en aller, il tient à expliquer les raisons qui l’ont poussé à agir et à répéter le concept qui est à la base de sa dernière lettre encyclique: «Nous sommes tous frères, même si, parfois, Caïn l’oublie, comme cela s’est passé au xxe siècle». «Oui, cela arrive souvent aujourd’hui encore», soupire -Edith en regardant le Pape et elle ajoute: «Jusqu’à quand cela se passera-t-il ainsi?». Le Pape lui rend son regard et lui répond: «Vous êtes en train de lutter pour cela... et ce n’est pas sans signification». L’image qui revient souvent dans cette longue conversation est celle de la goutte d’eau dans la mer, une petite chose, mais la mer qui est immense est faite d’infinies petites choses.
Mais revenons un peu en arrière, au début, car chaque histoire n’a peut-être pas de fin
(celle-ci assurément) mais a toujours un début. Et tout part des pages de L’Osservatore Romano en italien du 26 janvier dernier. A l’initiative de Giulia Galeotti, responsable du service de la culture, est publié sur la première page du supplément hebdomadaire Quattro Pagine, l’entretien de Francesca Romana de’ Angelis avec Edith Bruck (texte ci-contre). Le Pape la lit et est frappé; il me fait savoir qu’il veut rencontrer cette personne. Je me mets à l’œuvre et j’organise la visite au Vatican d’Edith Bruck, j’en informe ensuite le Pape qui m’appelle et me dit: «Vous n’avez pas compris, ce n’est pas vous deux qui devez venir, c’est moi qui irai rendre visite à Madame Bruck chez elle, si cela est possible». Eh bien, que dire? En inversant l’ordre des facteurs de l’équation, le résultat change, et comment! J’annule tout ce que j’avais fait et je réorganise la visite du Pape chez Mme Bruck.
Et nous y voilà: le Saint-Père et moi, au cours d’un après-midi déjà printanier, dans une rue bondée du centre de Rome, nous montons les deux étages pour arriver chez Edith Bruck. Elle est là, sur le seuil et elle n’arrive presque pas à parler, «Je suis émue et honorée» essaye-t-elle de dire, mais le mot le plus compréhensible (le reste sont des «gémissements inexprimables») qui sort à plusieurs reprises de sa bouche, ainsi que de celle du Pape est un seul: «Merci». Elle le remercie d’être là, maintenant, il la remercie d’avoir toujours été là pour témoigner à travers sa présence, sa parole, sa vie. Edith s’excuse pour ses pleurs et ses tremblements et, avec difficulté, elle cherche à se reprendre et à indiquer la voie au Pape le long du couloir qui conduit au salon où se sont rassemblées les personnes qui lui sont les plus chères: Deborah, la fille de sa sœur Judit, qui a elle aussi survécu à l’horreur des camps («si nous ne nous étions pas serrées l’une l’autre et encouragées, nous n’aurions jamais résisté»), avec son mari Lucio et, ensuite, un autre neveu du côté de son mari, Marco Risi (metteur en scène, qui est le fils de Dino), et encore Olga, la dame ukrainienne qui depuis vingt ans accompagne Edith et, enfin, Francesca Romana, la journaliste de «L’Osservatore Romano» dont tout est parti. Ce moment sur le seuil de la porte a été le moment le plus intense du point de vue émotionnel et comme cela arrive souvent, il n’a pas permis une «verbalisation»: les gestes et les silences, précisément les gémissements, ont exprimé la force de cette rencontre. «On n’est jamais préparé aux beaux moments de la vie» a ensuite commenté Edith, une fois assise sur le divan, comme pour justifier le «désordre» heureux et ému avec lequel elle a accueilli son visiteur, «de même que l’on n’est jamais prêts pour les moments les plus affreux», a-t-elle ajouté. Et le Pape, en acquiesçant, a tout de suite répondu: «C’est ainsi, et il y a ensuite la surprise de ce que cela fait jaillir en nous, dans notre cœur».
La surprise est la nuance, la couleur que l’on peut apercevoir sur les visages des quelques personnes qui, dans ce salon, se retrouvent en train de vivre, presque incrédules, un moment qui est spécial en raison de sa merveilleuse normalité et simplicité. Il y a d’abord l’échange des dons, car le Pape n’est pas venu les mains vides, mais il a voulu apporter deux petits cadeaux: une menorah, le candélabre à sept branches, et un livre, le Talmud babylonien en version bilingue hébreu-italien. Edith et sa «famille» sont émus du geste délicat et «en retour», ils offrent une table pleine de gâteaux et de confiseries, tous «de fabrication artisanale» dit avec une pointe d’orgueil Olga, «d’ailleurs ceux qui viennent dans cette maison veulent toujours y revenir».
Qui sait si le Pape reviendra dans cette maison, mais assurément, il est venu pour être là, pour s’arrêter et rencontrer ces personnes. Et la conversation est douce, lente, un «espace» dans lequel tous participent. A un certain moment, Deborah cite Borges, grand poète argentin et grand «causeur», car la nièce d’Edith a vécu pendant de nombreuses années à Buenos Aires et elle adresse au Pape (en espagnol) les saluts d’un ami commun, le rabbin Daniel Gold-man. Le visage du Pape s’éclaire et il commence à raconter de vieilles anecdotes drôles qui le lient à cet ami juif. Voilà quelle est précisément l’atmosphère, celle légère d’une heureuse réunion de famille avec le Pape qui goûte et apprécie le gâteau à la ricotta (à la joie d’Olga) et Edith qui lui montre les photos de famille. François est attentif et montre qu’il connaît déjà de nombreux détails de cette histoire de famille dramatique: il a lu le livre Il pane perduto et il anticipe souvent les paroles d’Edith qui rappelle les cinq «points de lumière» qui ont éclairé l’abîme d’horreur dans lequel elle est tombée à treize ans, quand elle a été déportée à -Auschwitz. «Cet épisode du peigne a touché mon cœur» dit le Pape, face à l’étonnement ému d’Edith et des autres. Ce peigne fut donné à celle qui avait alors treize ans par le cuisinier de Dachau, qui lui demanda d’abord comment elle s’appellait («je répondis en disant mon nom, je ne le faisais pas depuis longtemps, j’ai alors perçu à nouveau que j’étais une personne avec un nom, pas un numéro») et ensuite il lui dit: «J’ai une petite fille de ton âge» et «regardant ma tête dont les cheveux venaient à peine de repousser, il sortit de sa poche ce petit peigne et me l’offrit. J’eus la sensation de me retrouver devant un être humain après tant de temps. Je fus émue par ce geste qui était vie, espérance». Cette femme hongroise de presque quatre-vingt dix ans et le Pape continuent à reparcourir les épisodes de «lumière dans l’obs-curité»: le premier au sens chronologique qui signifia la vie pour la petite Edith, quand elle fut séparée de force par un soldat (à coups de crosse d’un fusil) de sa mère envoyée vers les chambres à gaz; ensuite, quand un soldat allemand lui lança sa gamelle pour qu’elle la lave, mais en ayant laissé de la confiture au fond; et quand un autre lui donna des gants, déchirés et percés, mais précieux pour elle, et, enfin, quand faisant partie d’un groupe de 15 jeunes filles qui devaient porter des blousons pour les militaires à la gare qui était à 8 kilomètres de distance, elle en jeta quelques-uns car elle n’avait pas la force de marcher avec ce poids. Un soldat allemand s’en aperçut et s’élança contre elle, mais sa sœur Judit le frappa et le fit tomber par terre, cependant le soldat ne tira pas, car il fut frappé par leur courage et les épargna. Il y a toujours des «signaux» disséminés dans la vie, parfois indéchiffrables au moment où on les vit, mais qui portent certains signes distinc-tifs. Pour le Pape, ce signe est souvent la tendresse, cette force qui «change les personnes» et ensuite il ajoute, presque en soupirant, comme pour tirer une conclusion: «Que de courage, que de douleur». Mais Edith est comme un fleuve en crue, au point qu’elle s’arrête parfois et nous demande de l’interrompre pour ne pas divaguer en parlant, à la fin elle tient cependant à affirmer que: «Au fond j’ai eu de la chance. Même si à présent c’est comme si je sentais toutes les douleurs du monde». Tous les deux sont d’accord sur l’importance de raconter, de rappeler. Le bien comme le mal. «Il y a un livre très important qui est sorti il y a peu, Sindrome 1933, de Siegmund Ginzberg qui est une lecture je dirais “urgente” parce qu’elle reflète et d’une certaine manière explique, comment tout ce mal a été possible. Et comment il peut donc se répéter».
Le Pape reprend le thème qui lui est très cher des grands-parents, la nécessité d’écouter les histoires des personnes âgées, de dialoguer avec elles et il cite le prophète Joël: si les vieux auront des rêves, les jeunes pourront avoir des visions. Et il cite sa grand-mère Rosa et l’histoire de la petite table qui est restée imprimée en lui jusqu’à aujourd’hui: «Il y avait autrefois une famille qui déjeunait toujours ensemble, y compris le grand-père. Qui cependant ne réussissait plus à manger sans baver et tout faire tomber, en se salissant et en salissant... jusqu’à ce que le père décrète que le grand-père aurait mangé tout seul sur la table de la cuisine, ainsi le reste de la famille aurait eu la possibilité d’inviter sans embarras les amis qu’elle désirait. Quelques jours plus tard, le père voit son petit garçon qui travaille avec des clous, un marteau et des planches de bois... “Que fais-tu?” lui demande-t-il: “Je fabrique une petite table pour toi, où tu mangeras quand tu seras vieux”». Entre les rires et l’admiration, Edith Bruck semble s’assombrir et, pleine de préoccupation, elle confie qu’elle a peur «pour cette crise sanitaire; je ne voudrais pas que l’on arrive au point de devoir choisir qui soigner et qui refuser. Le fait est que l’on devrait soigner à la maison». Et alors que le Pape rappelle le risque toujours actuel de la culture du rebut, le souvenir d’Edith va à l’histoire de son mari, Nelo Risi et à ces dix dernières années, marquées par la démence sénile et par l’Alzheimer. «Cela peut sembler étrange — dit Edith — mais ces années ont été heureuses, j’ai continué à dialoguer avec mon mari, à être proche de lui, main dans la main. Les médecins me disaient qu’il serait mort en quelques jours, et nous sommes allés de l’avant ainsi, pendant plus de dix ans». «Parce que vous l’avez aimé», ajoute le Pape.
Il est beau de sentir de manière tangible les sentiments qui unissent les membres de cette famille autour de cette vieille tante Edith. Le Pape s’adresse un peu à tous, la conversation s’élargit, on parle de nombreuses choses, des jeunes et des personnes âgées, du fait que chaque minute, un enfant meurt de faim et que, dans le même temps, on dépense des sommes immenses pour les armements. «Le problème est l’égoïsme» dit le Pape, «tendre la main coûte peu, mais l’égoïsme bloque ce geste, engourdit la main qui serait prête à se tendre vers l’autre».
A un certain moment, on finit par parler du cinéma. Marco Risi évoque du chef-d’œuvre de son père Dino, Le fanfaron «qui eut un grand succès dans le monde entier, au point que mon père tourna immédiatement après un autre film en Argentine, Il gaucho». «Mais moi je l’ai vu Le fanfaron, c’est un grand film! Tous ces virages le long de la route, ce va et vient, une image puissante de la vie». Marco Risi est agréablement surpris et commente le final amer du film (que De Sica aurait voulu différent): «A la fin un jeune meurt, l’innocence meurt et le cynisme reste; on était en 1962 et c’est presque une prophétie de l’Italie qui était en train de changer». Le Pape se révèle (également) un expert de cinéma: «Le fait est que pendant des années, j’avais plaisir à aller au cinéma et que j’ai vu pratiquement presque tous les films italiens de l’après-guerre, ceux avec Anna Magnani, Aldo Fabrizi, les premiers films de Fellini, je me rappelle avoir vu tous ses films jusqu’à la La dolce vita. Ensuite, vers ces années-là, également à cause de mes engagements toujours plus pressants, j’ai perdu un peu le contact avec le cinéma italien, j’étais aussi fasciné par les films de Berg-man, comme Le septième sceau, un très grand metteur en scène. Mais Le fanfaron, je m’en souviens très bien, c’était un film puissant... tout ce drame raconté en seulement 24 heures». Marco Risi, à la fois étonné et encouragé, lui parle du nouveau film qu’il est en train de réaliser, qui raconte précisément l’histoire de personnes âgées enfermées dans une maison de repos où arrivent deux jeunes qui sont obligés, pour purger leur peine, d’accomplir un service social; il en naîtra un rapport difficile et intense. François est très curieux, pour lui, ce thème du dialogue entre les générations est fondamental: on doit réussir à apprendre de l’histoire et il est donc nécessaire que quelqu’un la raconte. -Edith Bruck reprend ce thème pour parler des nouveaux et toujours anciens fascismes et de l’importance d’aller dans les écoles raconter ce qui s’est passé. A ce moment-là, le Pape reprend la parole pour réaffirmer avec force ses remerciements pour le travail de témoignage qu’Edith réalise à travers sa parole et, plus encore, à travers sa vie.
Nous sommes ainsi remontés au début de l’histoire, mais au plus profond des cœurs de ceux qui étaient présents a été enregistré bien davantage que les simples paroles que nous avons cherché à rappeler et à fixer dans la mémoire.









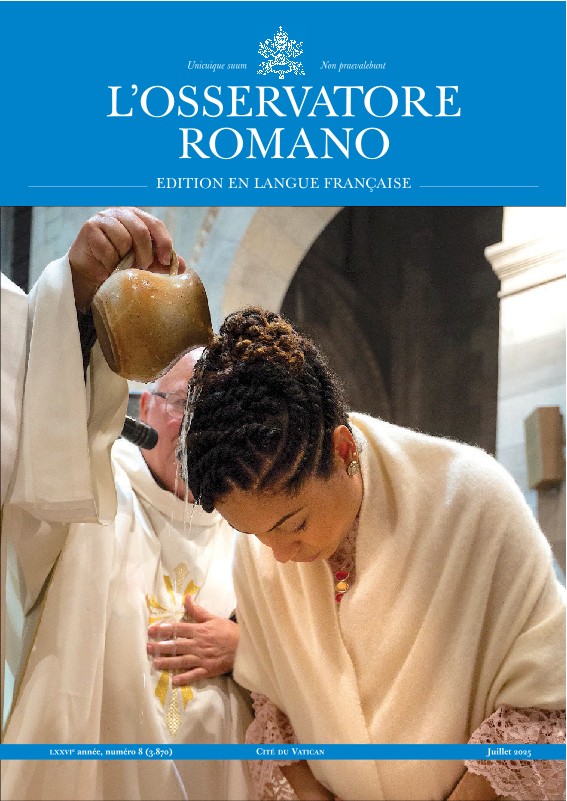



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
