La force mystérieuse

L’entreprise de Hroswitha de Gandersheim, abbesse et écrivaine de cour
Quand j’allais en classe de 3e, à Palerme, dans un petit immeuble de style art nouveau à la limite entre la ville de la petite bourgeoisie et la ville du sous-prolétariat, j’avais une camarade de classe qui désirait devenir religieuse de clôture. C’était à la fin des années soixante-dix, le monde à l’extérieur de la classe nous effrayait et nous attirait: il y avait le terrorisme, il y avait l’héroïne, mais le féminisme fleurissait, on ressentait une détérioration culturelle qui indiquait une crise, le prélude d’un changement. Garçons et filles, chacun à sa façon, nous nous élancions vers la place, l’extérieur, l’avenir. Tous sauf elle. La majeure partie de mes camarades garçons et filles la regardaient de loin, la laissaient en dehors des discussions, auxquelles elle ne s’intéressait d’ailleurs pas. Parfois, ils l’oubliaient complètement. Je le faisais moi aussi. J’allais vite, je discutais tout le temps, ou bien je lisais, des livres, des journaux, des étiquettes, tout ce qui passait devant mes yeux, je lisais, j’interprétais, j’interrogeais: comment pouvais-je tenir compte de son immobilité trop harmonieuse?
Ce fut pendant cette période que je découvris dans la bibliothèque de mon père un petit livre de la collection Bur, grisâtre et austère, sur lequel était écrit Rosvita. Tutto il teatro [Hroswitha, Tout le théâtre]. Italianisé de cette façon: sans w ou h, sans aucun élément caractérisant, pas même Hroswitha de Gandersheim, comme si tout le monde devait connaître Hroswitha. Quand je me suis retrouvée avec ce petit livre à la main et que j’ai découvert que c’était une moniale, une jeune abbesse qui écrivait en latin avant l’an Mille, je fus profondément fascinée. J’aimais un peu au hasard Sapho, Vittoria Colonna, Gaspara Stampa, je cherchais ma généalogie féminine, avant encore de me penser vraiment femme. C’est ainsi que j’ai accueilli Hroswitha de Gandersheim. Je m’enthousiasmai à propos de la légende qui circulait – elle circulait à une époque lointaine, certainement pas la mienne – disant que son théâtre avait été écrit pour être représenté au couvent. J’imaginai les jeunes moniales aux vêtements souples qui, dans une salle de pierre, se déguisaient en antiques personnages puissants de l’âge classique qui cherchaient à forcer des jeunes filles fragiles, qui, cependant, comme dans un dessin animé de la Warner&Bros, l’emportaient toujours en mettant en déroute les puissants. J’imaginais les moniales comme de toutes jeunes filles, Hroswitha aussi, dans un lieu exempt de brutalité, où coulaient des fontaines gelées en hiver, un lieu de paix, de voix et de rires éclatants. Je les imaginais se pencher sur le monde des portiques de leur cloître comme des angelots du ciel, complices, curieuses, mais sans furie. C’était peut-être la même chose qui me fascinait dans l’horizon de ma compagne, Elisabetta, c’est ainsi qu’elle s’appelait: ce cloître, lieu de soin protecteur, refuge éternel, qui me semblait le plus mystérieux des balcons
J’apportais fréquemment des livres à l’école, à lire sous mon pupitre, c’était souvent le théâtre de Hroswitha, qui était un livret si petit qu’il rentrait vraiment dans les poches. Je levais la tête du livre et je regardais Elisabetta. Elle faisait parfois l’effet d’un aimant sur moi, d’une provocation. Elle portait une couronne de boucles claires, entre le blond et le roux, sur un visage large et plat couleur de lait, deux petits yeux sombres qui lorsque je l’approchais, regardaient avec ironie qui sait où, au-delà de moi. Qu’elle s’imagine religieuse de clôture était quelque chose qui me remplissait d’inquiétude. Comme par hasard, je la croisais à la récréation pour lui demander comment elle pouvait penser, face à un monde désespéré, plein de douleur et de besoins, tourner la tête de l’autre côté, je la provoquais: tu veux cultiver ton petit jardin, tu n’en a rien à faire de rien. Elle, qui s’habillait en rose, en saumon, et qui bougeait lentement en apportant avec elle un calme exaspérant, était sereine. Imperméable à mes pièges, elle m’expliquait le pouvoir de la prière, elle essayait de me faire entrevoir une autre voie, un soin du monde par d’autres moyens, elle étirait ses lèvres claires dans un sourire doux qui contenait toujours de l’amusement et un léger sens de supériorité. Qui sait si elle connaissait la violence qui me semblait l’intolérable caractéristique de l’époque, la violence entre les hommes et les femmes, entre qui a de l’argent et qui n’en a pas, qui est au-dessus et qui est en dessous. Quand j’étais avec elle, je sentais que notre envie de vie à tous, garçons et filles, l’envie des corps et des pensées, même l’envie de justice, n’étaient pas tout, ne représentaient pas toute la réalité. Dans ses paroles, je ressentais la fascination d’une autre possibilité d’être au monde, qui échappait à la furie, mais qui pour autant n’en était pas moins dangereuse. Qui sait si la lecture de l’œuvre de la moniale de Gandersheim n’avait pas quelque chose à faire avec cette autre possibilité: dans la seule image que j’avais vue d’elle, Hroswitha montrait elle aussi un mince sourire amusé.
Hroswitha est considérée comme la première écrivaine allemande, même si elle écrivit toujours en latin. Elle vécut à une époque difficile même à imaginer, elle naquit vers 935; elle était noble. Son œuvre fut connue en 1501 grâce à l’humaniste allemand Conrad Celtis. Certains pensent qu’elle est entrée dans l’abbaye de Gandersheim, en Basse Saxonie, dès l’enfance et qu’elle y a étudié, d’autres pensent qu’elle est entrée au couvent adulte après une vie à la cour, ils le pensent également car dans son œuvre il semble qu’elle a observé directement les pulsions mondaines dont elle parle. Il semble qu’elle a été également une véritable écrivaine de cour, qui a eu une familiarité avec les murs séculiers, qu’elle a vécu, au moins pendant une période de sa vie, en n’étant pas du tout protégée du monde du pouvoir, de la violence, des mariages arrangés par les nobles et les rois. Elle écrivit Gesta Oddonis Caesaris Augusti et Sept légendes. A propos de sa formation au couvent, nous avons son témoignage direct: Hroswitha écrit qu’elle élabora ses Légendes «tout d’abord à travers l’enseignement instructif de la très cultivée et très gentille maîtresse Rikkardis (…) ensuite sous la considération bienveillante de la royale Gerberga». Il y avait, avant l’an Mille, un réseau de femmes très cultivées spécialistes des classiques et d’enseignantes qui se passaient le témoin dans l’abbaye de Gandersheim, se reconnaissant mutuellement de l’estime et de l’autorité. A travers leur enseignement, Hroswitha avait probablement lu Terence, Virgile, les auteurs latins chrétiens, Boèce. Elle connaissait la scolastique. Elle écrivit en latin les six comédies que je tenais à la main, recueillies dans le livret de la Bur: Ahbraham, Pfnutius, Calimachus, Dulcitius, Gallicanus, Sapientia. Son modèle était Terence, son théâtre était de la comédie, dans tous les sens du terme, il faisait rire et finissait bien, même si souvent dans ses trames la fin heureuse était la mort. Les six comédies de Hroswitha racontent l’histoire de personnages puissants qui veulent obliger des jeunes filles très belles à faire des choses qu’elles ne veulent pas, au sexe, au mariage, à renoncer à leur foi; ou bien elles racontent des histoires des prostituées qui, avec l’aide d’hommes sages et saints, réussissent à quitter la voie du vice et à devenir des ermites. Parmi les deux typologies, je préférais décidément la première, j’étais très satisfaite par l’histoire de Dulcizio qui cherche à violer trois jeunes filles qui se cachent dans un débarras et qui, quand Dulcizio entre par la force, disparaissent en laissant l’agresseur serrer une batterie de casseroles à la place de leur corps. Ensuite, bien sûr, un agresseur pire que Dulcizio réussira à les tuer, mais pas à les obliger à faire quelque chose contre leur volonté. J’étais enthousiasmée par les jeunes filles de Hroswitha qui renonçaient à la vie sans souffrir et sans même donner trop de poids à la chose, du moment qu’elles échappaient à la violence, à l’oppression, aux mariages imposés, et j’aimais naviguer sur ce grand guignol médiéval, imaginatif en tortures qui heureusement étaient rendues vaines, car les corps coupés en morceaux ne souffraient pas (ils s’en moquaient presque) et même la mort venait reconnaissante et sans poids. Le retournement de situation m’émouvait, comme par la suite je serai également toujours émue par le petit qui vainc le grand, le faible qui vainc le fort, le sans défense qui enseigne au puissant qu’il existe une autre force bien plus grande que la force. Je ne savais pas donner un nom à cette force, mais je la rencontrais ici et là dans la réalité ou dans les livres: dans la légende de Numa Pompilio qui se libère des gardes du corps de Romulus pour se présenter au peuple romain sans défense, dans l’Adelchi de Manzoni, chez Ermengarde, dans les histoires que quelqu’un me racontait sur la non-violence de Gandhi, et également dans sa version la plus bizarre, chez Hroswitha, dans ses dialogues de scène.
J’avais l’intuition que ma compagne de classe Elisabetta était elle aussi capable de rester de côté, de ne pas glisser sur la pente du désir, de la curiosité, du conformisme naturel de nos treize ans, parce qu’elle était soutenue par une force mystérieuse. Je ne sais pas quelle est sa vie à présent, si ensuite elle est vraiment devenue religieuse, mais elle connaissait déjà sa paix. Moi, en revanche, j’étais emportée par le désir qui m’appelait et le refus qui me reconduisait en arrière: j’épiais le monde comme je le pouvais, sans aucune protection réelle.
On peut facilement lire les légendes et les comédies de Hroswitha, elles ont été republiées en italien en 2017 par Castelvecchi sous le titre Leggende e drammi sacri.
Carola Susani
L'abbaye
L'abbaye de Gandersheim est une maison supprimée de chanoinesses séculières. Elle fut fondée en 852 par le duc Ludolphe de Saxe et par sa femme Oda, qui, au cours d’un pèlerinage à Rome en 846, obtinrent la permission du Pape Serge II, ainsi que les reliques des saints Anastase et Innocent, encore actuellement patrons de l’église abbatiale. La “Libre fondation séculière impériale de Gandersheim”, telle qu’elle était reconnue jusqu’à sa dissolution en 1810, fut une communauté de filles célibataires de la haute noblesse qui conduisaient une vie pieuse, mais sans avoir prononcé les vœux, un fait qui explique le terme de “séculière”.
Chanoinesses
Les chanoinesses, connues comme Stiftsdamen, pouvaient détenir des propriétés privées et, n’ayant pas pris les vœux, elles pouvaient quitter l’abbaye à n’importe quel moment. Elles n’étaient pas éloignées du monde: elles fréquentaient la cour des souverains ottoniens et de la dynastie salique qui, avec leurs suites, résidaient fréquemment à Gandersheim. L’une des pincipales tâches des consœurs était celle de l’éducation des filles de la haute noblesse, qui cependant n’étaient pas obligées de devenir membres de l’abbaye.
L’auteure
Elle écrit pour les adultes et pour les jeunes. Elle est rédactrice de Nuovi Argomenti, elle dirige des ateliers de lecture et d’écriture et fait partie de l’association Piccoli Maestri.
En 1995 a été publié son premier roman, Il libro di Teresa (Giunti). Parmi ses livres, on trouve Il licantropo (Feltrinelli 2002), Eravamo bambini abbastanza (minimum fax 2012), Terrapiena (minimum fax 2020). Elle fait partie du Comité de direction de Femmes Eglise Monde









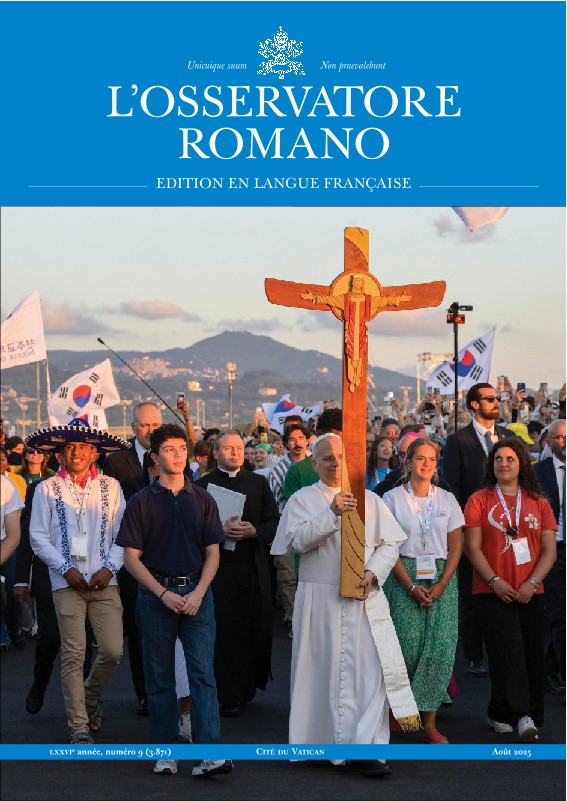



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
