Gertrude

Les religieuses protagonistes de grands romans
Gertrude et Maria. En Italie, n’importe quel discours sur les religieuses dans la littérature tourne autour d’une polarité, celle qui oscille entre la puissante figure de la religieuse de Monza des «Fiancés» et la protagoniste désespérée de «Une fauvette à tête noire». Toutes les deux des religieuses forcées.
Depuis toujours, la dimension tragique d’une vie dévastée par un choix imposé, et donc cruel, est prépondérante et dominante dans la littérature. Malgré cela, on trouve des histoires solides et vigoureuses dans la vie de l’Eglise de femmes qui, échappant aux politiques ambitieuses de la famille, souvent encouragées par des mères et des sœurs conscientes de l’aliénation d’une vie matrimoniale imposée par la force, prétendirent avoir le droit à une alternative conforme à leurs aspirations. Sainte Claire le fit pour toutes.
La réputation de Gertrude est sans aucun doute liée au caractère central du roman d’Alessandro Manzoni dans la littérature italienne, outre que dans l’histoire de la langue; mais la Fauvette est elle aussi un personnage que presque tous connaissent, en dehors de la lecture effective du roman de Giovanni Verga, et qui s’impose dans l’imaginaire en raison de la désolation poignante de son destin sans appel.
Elles ne pourraient pas être plus différentes l’une de l’autre. Autant Gertrude est une créature incandescente et corrompue par le péché, sulfureuse et capricieuse, autant Marie est laiteuse, virginale, animée par un sentiment panique envers la nature. Gertrude est sombre, et sans rédemption, Maria est d’une blancheur de neige, docile comme un agneau, et si résignée qu’elle ne fait pas même le geste d’ôter la tête du billot.
Elles sont différentes par leurs caractères, par leurs mésaventures biographiques, par l’époque et les lieux où elles vivent - l’une au XVIIe siècle à Milan, l’autre au XIXe siècle en Sicile - par leur extraction sociale, mais elles ont deux choses en commun. La première est le dénominateur fixe de cette thématique littéraire, omniprésente à toutes les époques, c’est-à-dire la prise de voile forcée imposée par la famille.
La deuxième est la conséquence directe de la précédente: l’impossibilité de se soustraire à la volonté des hommes qui disposent de leur destin de manière impitoyable, comme si elles étaient des choses, des objets de nature fonctionnelle à utiliser exclusivement selon des logiques de profit et de convenance. Ce sont les pères, mais parfois aussi les mères, les belles-mères, les frères, les sœurs qui interviennent par un véritable lavage de cerveau, surtout dans le cas de Gertrude. Car à la différence de Maria, qui est humble est vulnérable, mais qui a très vite l’intuition de la force des mailles qui se resserent autour d’elle, Gertrude, assurément plus âpre et orgueilleuse, est celle qui subit de manière inconsciente le poids d’une éducation impitoyable, et que l’on convainc par tous les artifices possibles à croire qu’elle désire ce qui ne lui correspond pas, selon un modèle pédagogique qui pourrait susciter de l’admiration en raison de son efficacité, si seulement on pouvait le détacher de la férocité qui l’anime.
Le destin de Gertrude s’ouvre et se referme autour d’une phrase, la plus célèbre de l’histoire qui la concerne: et la malheureuse répondit. Comme cela arrive souvent avec des auteurs de la grandeur d’Alessandro Manzoni, la périphrase a un sens beaucoup plus large que celle référée au contexte dans lequel elle est prononcée. Dans le roman, elle coïncide avec l’acte qui perd Gertrude pour toujours, écouter la voix et les paroles mielleuses de son amant Egidio au lieu de les ignorer comme son état de religieuse l’exigeait, et lui répondre. Mais elles sont aussi l’épitomé d’un destin plus vaste et omniprésent par rapport aux limites de l’épisode. La malheureuse répond non seulement à Egidio, mais au dessein tout entier de la famille sur elle, et elle commence à le faire bien avant la rencontre avec cet homme, tragiquement instrumentalisée pour accepter l’expropriation de son destin en faveur de l’intérêt de ceux qui, plus que tous, auraient dû la protéger et l’aimer. C’est en cela que se trouve la tragédie et plus encore la modernité. Les contextes changent, pas la nature des relations. Il n’y a pas de douleur plus lancinante que celle qui vient de la trahison de ceux qui auraient dû prendre soin de nous.
Le destin d’emprisonnement et de malheur qui frappe les femmes devenues religieuses par la force est un thème extrêmement central dans toute la littérature consacrée aux religieuses. Nous en avons des exemples puissants, assez fréquemment de nature autobiographique. «Les mystères du cloître napolitain», publié en 1864, de l’écrivaine Enrichetta Caracciolo qui devint très jeune religieuse par trahison à Naples, dans l’église de Saint-Grégoire l’Arménien, qui après s’être libérée de ses vœux devint une patriote dévouée à Giuseppe Garibaldi et une partisane des droits des femmes; et, deux siècles auparavant, «Les lettres d’une religieuse portugaise», d’un auteur anonyme, publiées la première fois à Paris en 1669, qui explorent les implications érotiques et sensuelles des prisonnières séduites au couvent; ou l’histoire de Suzanne, «La Religieuse» racontée par Denis Diderot (le roman fut publié posthume en 1796), qui dans les premiers chapitres rappelle la douceur candide de la Fauvette de Verga, mais qui ensuite se révèle une femme d’une tout autre trempe, déterminée à décider pour elle à n’importe quel prix.
Pour rencontrer un point de vue différent, nous devons tourner le regard bien avant ou bien après cette période chronologique. D’un côté, le XXe et le XXIe siècles, de l’autre le moyen-âge. Une sœur est présente dans un récit des débuts de deux écrivaines italiennes, dont l’une est déjà pleinement comprise dans le canon et l’autre en activité: Elsa Morante et Rosella Postorino. La première avec «Le ambiziose», publié dans la revue Oggi en 1941, et la deuxième avec «In una capsula», qui fait partie du recueil Ragazze che dovresti conoscere, sorti en 2004. Elles ont beaucoup en commun, aussi bien parce qu’elles parlent de deux femmes d’une force cristalline qui embrassent le choix de foi radical avec une détermination privée d’ombres, que parce que toutes les deux allient leur volonté avec le corps, et par extension avec tous les sens. La moniale de Rosella Postorino s’allonge en prière dans la nef pour fondre le marbre et la chair en elle. Concetta, en revanche, la protagoniste du récit d’Elsa Morante, est éblouie par l’esthétique du sacré qui remplit ses yeux uniquement pleins de la solennité des cathédrale, des lys, des flammes des cierges, des légendes historiées sur les vitraux.
Deux hommes privilégient en revanche une représentation différente de leur âme. Guido Piovene et Giovanni Arpino sont respectivement les auteurs de «Lettres d’une novice», de 1941, et de «La jeune sœur», de 1959. Seul le premier reprend de manière rigoureuse le thème de la mauvaise prise de voile. Mais indépendamment du désir de prendre les vœux – à l’apparence la protagoniste de Giovanni Arpino, Serena, entre spontanément au couvent, ce n’est cependant pas un choix de foi, plutôt une nécessité -, ce qu’elles ont en commun est la malice. Un signe distinctif et dérangeant qui ne peut pas être comparé à la dimension tragique de Gertrude, mais qui est plutôt un caractère artificiel, une malice à caractère vulgaire, plus opportuniste dans le cas du roman de Giovanni Arpino, où Serena se limite à duper un homme dans l’objectif de se ranger, plus crue dans celui de Piovene, qui décrit une femme, Rita, qui fuit toute responsabilité jusqu’à arriver au délit.
Mais en même temps que de nombreuses femmes obligées d’entrer dans un cloître détesté, il y eut celles qui suivirent le parcours inverse. La littérature médiévale en est pleine.
La Legenda Sanctae Clarae Virginis, attribuée à Tommaso da Celano est un texte officiel, commandé par un Pape, composée dans un but éducatif et dévotionnel, et d’autant plus surprenante précisément pour cette raison. La prose curiale et canonique vibre parcourue par la résolution impétueuse de Claire, qui en plusieurs points crève la surface de la rhétorique du genre hagiographique – il viendrait à penser que l’auteur ne s’en aperçoit même pas – pour révéler avec la force d’une brûlure la nature volcanique de la protagoniste. Il y a un geste, un acte parmi ceux nombreux de la biographie de Claire d’Assise, qu’il ne me semble pas du tout inapproprié de définir comme politique. Quand les hommes de la famille, furieux, arrivèrent au monastère où elle s’était réfugiée après sa fuite, tout à fait décidés à la ramener avec eux, les menaces ne réussirent pas à l’ébranler. Et les hurlements, la violence, ou le refus obtus de comprendre n’obtinrent eux aussi rien du tout. Mais ils durent s’arrêter et désister face à un acte sans paroles. Claire s’agrippa à l’autel de toutes ses forces, et découvrit son crâne en montrant la tonsure, les cheveux que François d’Assise lui avait coupés à la Portioncule pour marquer son nouveau statut de pénitente consacrée. Ce fut ce qui les réduit au silence. La concordance entre foi et choix, entre corps et volonté, entre âme et ambition. Ce geste dit à tous: je suis cela. Et sans cela je ne suis pas. Respectez ma volonté.
Emanuela Canepa
Son dernier livre écrit est «Insegnami la tempesta» (Einaudi, 2020). L’une des trois protagonistes est une sœur, Irene, un personnage qui incarne aussi bien l’idée de force que celle de maternité spirituelle. Quand l’auteure parlait d’elle, Teresa Forcades m’est venue à l’esprit, une moniale catalane bénédictine, mystique, activiste, médecin, créature du cloître et, dans le même temps, ouverte au monde, même dans ses instances les plus extrêmes.









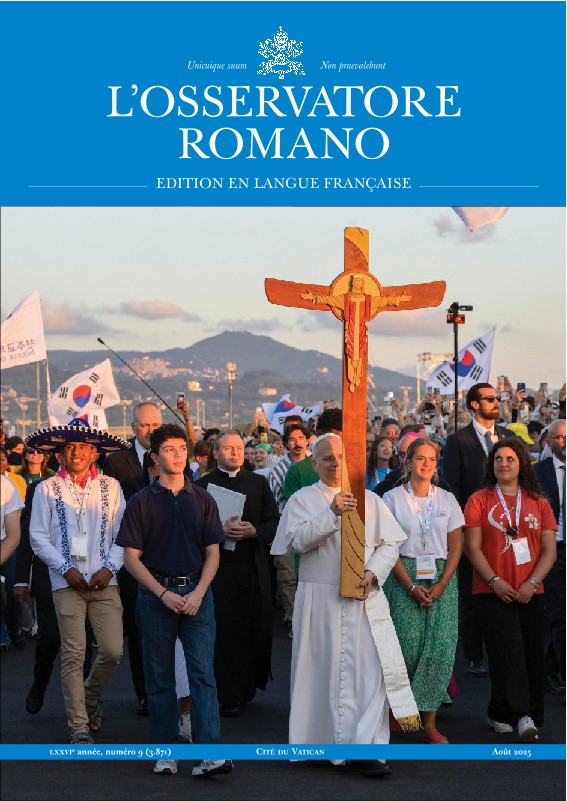



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
