
“Echangez-vous un signe de paix ”. J’ai souvent eu envie de pleurer à ce moment précis. Je ne savais pas bien pourquoi, cela avait probablement un rapport avec la possibilité de mon corps, tendu pendant la messe pour suivre des geste rituels précis, de se relaxer pour quelques instant, de s’approcher de corps (parfois inconnus), d’échanger un regard, une poignée de main, et un mot précis, susurré: paix. En « donnant » la paix je souhaitais probablement un peu de paix pour moi, une quiétude qui provient tout d’abord de la relaxation des muscles, comme si la tension accumulée dans le corps pouvait devenir liquide.
Pendant quelques instants, s’accorder le luxe de sortir des limites de son propre corps, tout en restant dans la forme d’une danse rituelle précise, qui prévoit subtilement l’embarras immédiatement avant, et le plaisir d’un contact immédiatement après. J’entre souvent dans des lieux de prière, mais j’assiste rarement à une messe, si ce n’est pour une raison liée à une contingence douloureuse ou à une fête. En ces temps de distanciation physique – il serait bon de donner les noms opportuns à la condition que nous vivons depuis des mois – je me suis adressée plusieurs fois à des formules profondes (les prières, les chansons, les poésies, les imprécations, les demandes d’aide et de pardon) mais le manque d’un contact physique avec d’autres personnes implorantes et reconnaissantes me manque beaucoup. Une nostalgie antique, comme une vague de l’océan, lente et très haute, est donc apparue et m’a ramenée à une époque où aller à la messe était une habitude, pas une exception. Il y a des années que l’institution de l’Eglise catholique me paraît plus lointaine que déplorable. Quand j’étais en son sein de manière plus consistante – de nombreuses années de scoutisme – j’en voyais plus nettement les défauts, j’en détestais le pouvoir, la richesse, la temporalité, l’arrogance, l’incohérence; maintenant que j’en suis sortie, je la regarde avec une distance sidérale, comme si elle était un corps étranger, et pas moi. En parlant d’elle dans les conversations avec des amis, j’ai désormais recours sans y faire attention à une longue série de stéréotypes typiques de celui qui connaît très peu un monde immense, mais qui se sent quand même en mesure de le juger avec assurance et également en mesure d’en modifier les injustices à travers un mot performatif (l’Eglise fait, l’Eglise dit, l’Eglise est …). D’altérer les rapports de force de l’extérieur. Je ressens donc la nécessité de revenir à un mot plus vrai. Le mot est paix, et son corrélatif est détente.
Dans l’Evangile de Jean, l’une des plus belles œuvres jamais écrites, Jésus réconforte ses disciples désespérés. L’un d’eux vient de le trahir, un autre sur lequel il fondera son Eglise le reniera à trois reprises – la situation est plutôt dramatique. Ses disciples, que nous pourrions aussi appeler ses amis et ses frères, sont désespérés, parce qu’ils ne savent pas où il va aller, ils croient l’avoir perdu pour toujours, leur maître est là qui va affronter son destin, et ils ont très peur de rester seuls. Ils ont plus peur pour eux-mêmes que pour lui, comme il est vil et comme il est humain de se sentir ainsi! Pour toujours. Je ne crois pas que ce soit un hasard quand Jésus, avant de s’éloigner, leur dit: “Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ”. Il remet à deux reprises le mot paix dans la même phrase. Mais la deuxième fois, ce « ma » ne remet pas seulement un mandat sur la manière dont ils peuvent être dans le monde, mais il remet également sa paix, en gardant tout son opposé pour lui, comme cela est plausible. Dans ma lecture très personnelle du texte, je vois un homme/Dieu qui ne garde pas la paix pour lui, mais qui la souhaite et l’offre à ses frères. C’est pour cette raison que, quand à l’église on échange un signe de paix, je suis encore émue aujourd’hui: on se rencontre (parfois juste le temps d’un regard) et on se salue (en se touchant) en s’offrant mutuellement un legs et un avertissement qui n’a pas à voir avec le comportement, mais qui concerne l’essence d’une possibilité: celle de s’éloigner en paix. La rencontre a été possible grâce à la tension, le salut est possible seulement avec la détente.
Les trois lignes ci-dessus pourraient être la conclusion consolatrice d’une pensée du matin, lors de l’un des nombreux réveils de ces jours particuliers, où l’aube se pose avec violence sur mes yeux. Mais je ne peux pas omettre l’angoisse initiale qui m’a obligée à repenser la paix comme condition possible: si le corps de l’autre personne manque, si sa forme et ses limites sont impossibles à toucher, que faisons-nous d’un don et d’une réception qui a lieu séculièrement dans un échange également physique? Est-ce que je peux donner (et recevoir) la paix des fantômes? Instinctivement– dès que je rencontre une personne que j’aime beaucoup – je pose ma main sur le cœur, comme pour dire « tu es là, tu es aussi là », c’est le geste qui pour le moment correspond rituellement le plus à une étreinte et à une poignée de main dans une église. Je me lève définitivement du lit et je me rappelle avec nostalgie du «fou rire» qui nous prenait, petites filles et jeunes filles, à cause de l’embarras pour un geste erroné au cours des rites (s’agenouiller trop vite, se lever quand tous sont assis, s’asseoir au beau milieu du Credo) et je m’attache à l’idée qu’en donnant la paix, aujourd’hui, en ces temps de distanciation physique, nous avons la grande opportunité de ne plus savoir comment faire. Et d’en sourire en peu.
Viola Lo Moro
Associée de la Librairie des femmes de Rome, Tuba.
Auteure d’un recueil de poésies intitulé «Cœur joyeux» (2020, Giulio Perrone Editeur)









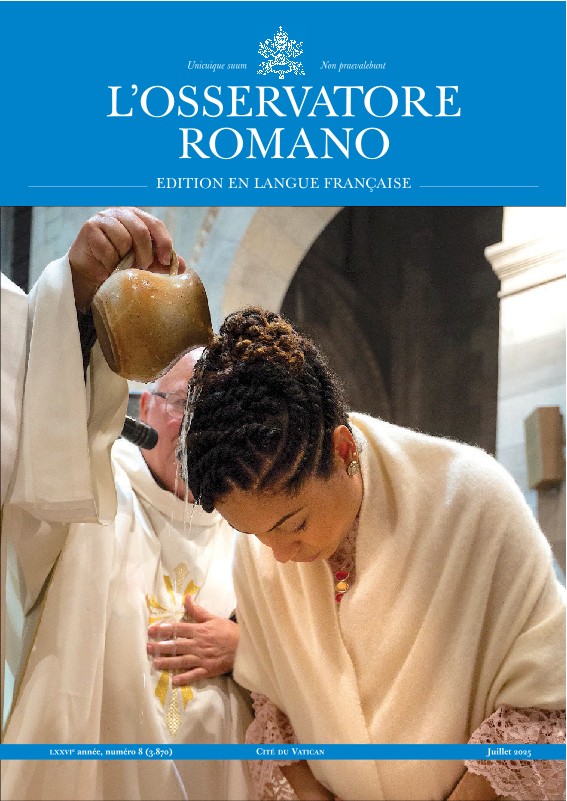



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
