
Ceux qui traversent la frontière avec les Etats-unis reçoivent de l'aide de Las Patronas, les femmes de la famille Romero
«A Córdoba, Veracruz/les très belles patronnes/ papillons courageux/ apportent la lumière au migrant», dit le corrido (chanson populaire), l'un des nombreux consacrés aux «papillons courageux» de Guadalupe ou La Patrona, un village minuscule de trois mille habitants dans le municipio d'Amatlán de los Reyes, à quatre-vingt-dix kilomètres du port de Veracruz. Là-bas, entourée par des champs de canne à sucre et de café, il y a la maison, vaste et spartiate, de la famille Romero. Et la cuisine avec des briques apparentes, la longue table de bois, les casseroles sombres et l'image de la Vierge de Guadalupe – La Patronne, dont la communauté prend son nom – où, il y a vingt-cinq ans, Leónida Vazquez, ses quatre filles et sept neveux et voisines ont commencé à préparer les rations de nourriture pour les centaines de migrants qui fuient de la violence et de la misère de l'Amérique centrale sur la croupe de la Bestia. C'est ainsi qu'est connu, au Mexique, le train de marchandises délabré qui traverse le pays du sud au nord, jusqu'à la frontière avec les Etats-Unis. Blindés dans les compartiments métalliques voyagent le blé, le ciment, les briques à exporter. Accrochés au toit ou encastré dans les articulations entre les wagons, il y a les migrants. Ils n'ont pas le choix pour rejoindre La Línea, les 3.200 kilomètres de frontière qui unissent ou séparent — selon les intérêts politiques — les deux Amériques. La porte, fermée sur un tiers de sa longueur par un mur high tech, de l’El Dorado Usa. Dans les bus ils risquent d'être interceptés par la police et, dans le meilleur des cas, renvoyés sur leurs pas en tant qu'irréguliers. Sur la Bestia aussi, en théorie, ils ne devraient pas voyager. Cependant, les machinistes et les autorités ferment un œil ou tous les deux en échange d'un pot de vin. Et c'est ainsi que les centraméricains avancent dans une gymkhana infinie qui dure au moins deux semaines. Il n'y a pas de ligne directe du Chiapas au Rio Bravo. Les diverses locomotives s'alternent sur la toile d'araignée des rails lors de trajets de dix-douze heures, avec des pauses de deux, trois, voire même sept jours, où les migrants deviennent le butin de groupes criminels qui contrôlent le territoire. Un petit nombre d'entre eux réussissent à sauver un peu d'argent pour la nourriture et l'eau. La faim et la soif sont les opprimantes compagnes de voyage dans le calvaire vers les Etats-Unis.
Le 7 février 1995, un groupe de migrants épuisés, dans l'attente de repartir de Guadalupe-La Patrona, a rencontré les sœurs Romero. Rosa et Bernarda revenaient de l'épicerie avec un sac plein de pain et de lait qu'elles venaient d'acheter. Amassés le long des rails, il y avait de centaines et des centaines d'êtres humains, sales, dépenaillés, affamés. Un spectacle coutumier pour les personnes de la communauté. Mais ce jour-là trois jeunes garçons ont levé le regard. Leurs yeux ont croisé ceux des deux femmes. Il s'est agi d'un instant, qui a duré une éternité. «S'il vous plaît donnez-nous quelque chose, nous ne mangeons pas depuis des jours». Rosa et Bernarda sont revenues chez elles sans pain ni lait et avec une profonde angoisse. Elles ont immédiatement raconté ce qui s'était passé au reste de la famille. «Vous avez bien fait mes filles, vous avez bien fait — a sussuré leur mère Leónida en les embrassant — La Vierge de Guadalupe sera contente: mais nous devons faire plus».
«On les appelle les mouches, parce qu'ils voyagent accrochés au train comme des insectes. Mais ce ne sont pas des mouches. Ce sont des êtres humains, comme moi», raconte Norma Romero, elle aussi une fille de Leónida et la plus connue des douze papillons qui adoucissent la Bête. «Si je pouvais l'être! Je pourrais voler et distribuer les sachets avec de la nourriture à tous les migrants du train. Je suis une paysanne humble, mais qui a de la chance. Dieu m'a donné une famille, un travail dans les champs grâce auquel je peux me procurer à manger sans être obligée d'émigrer. Et de très nombreux enfants en plus de mon Jafet». Norma, les mains calleuses, de long cheveux foncés rassemblés en queue de cheval et un Chapelet autour du cou, dit qu'elle considère comme tels les milliers et les milliers de personnes à qui elle a donné de la nourriture et de l'eau au cours de ce dernier quart de siècle. Cependant, son appel n'est pas arrivé ce 7 février. «Il a eu lieu un an ou deux plus tard. J'aidais déjà ma mère et mes sœurs dans la distribution. Cela n'est pas facile: tous les machinistes ne diminuent pas la vitesse quand ils nous voient. Tu dois lancer le sachet le plus rapidement possible et avoir déjà l'autre prêt… Un soir, j'ai été trop lente. Et un jeune homme n'a pas réussi à la prendre. En revanche, il avait perdu l'équilibre en se penchant. Deux de ses compagnons l'ont attrapé chacun par une épaule. Le garçon, jeune et avec la peau foncée, est resté en équilibre je ne sais pas combien de temps, avec le corps et les bras tendus, comme Jésus sur la Croix. Alors, j'ai compris: le Seigneur se trouvait réellement dans ce physique prostré, offensé, refusé par tous. Je me suis dit: «Vierge de Guadalupe, dorénavant je saurai reconnaître ton Fils dans le corps des migrants».
C'est la certitude de servir Jésus qui pousse Norma, chaque jour, entre 21h00 et 22h00, et les autres onze Patronas, comme ont les a rebaptisées, à charger des rations de riz, de haricots, de tortillas (galettes de maïs) et des bouteilles d'eau dans des sacs à dos et de grand sacs. Pour ensuite rejoindre les rails, dans l'attente du sifflement de la Bête. «A présent, nous sommes organisées. Sœur Maria de los Ángeles nous téléphone de Tierra Blanca dès qu'elle voit la locomotive passer. Nous savons qu'après environ trois heures elles arrivera chez nous. La religieuse nous dit également la quantité de migrants qui sont à bord pour calculer les portions». Depuis dix ans, outre la distribution de la nourriture, les Patronas ont ouvert un petit refuge pour ceux qui veulent se restaurer avant de poursuivre la voyage. «C'était une petite maison que mon père m'avait offerte. Nous l'avons réadaptée. Avec quels moyens? Les mêmes que ceux avec lesquels nous nous procurons la nourriture pour les migrants. Nous mettons ce que nous pouvons. La Providence pense au reste. Nous n'avons pas de contributions fixes, nous ne sommes même pas une association: nous recevons seulement les offrandes de ceux qui veulent nous aider. Heureusement, ils sont nombreux. Beaucoup de personnes critiquent aussi. Elles disent que nous sommes complices des trafiquants, que nous donnons à manger à des criminels, comme si émigrer était une faute et pas une nécessité…. Nous n'y faisons pas trop attention et nous allons de l'avant. Pour combien de temps? Tant que la Vierge de Guadalupe le voudra. Sans Elle, les Patronas ne seraient pas là…».
Lucia Capuzzi









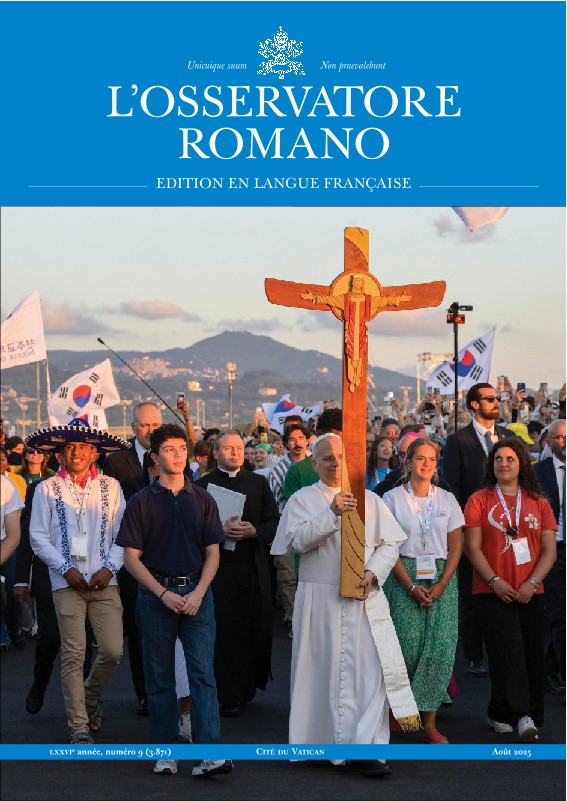



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
