
Sur l’écran de l’ordinateur, Stella sourit. «Je suis contente de parler avec quelqu’un. Je suis seule ici depuis des jours». Et ce n‘est d’ailleurs pas à cause du covid-19: «Quand les restrictions sont entrées en vigueur en Italie, en parlant avec ma famille, avec mes amis, j’ai pensé qu’ils étaient en train de comprendre ce qu’était ma vie de tous les jours: pour les humanitaires qui travaillent dans des zones de conflit, ne pas sortir de chez soi, vivre le moment de l’approvisionnement comme le sommet de la semaine, avec l’excitation de pouvoir rencontrer des gens, est une chose normale. Maintenant je suis au bureau, mais vous voyez l’escalier derrière moi? Il conduit chez moi».
Il n’y a pas trace de revendication ou de plainte dans la voix de Stella Pedrazzini, 35 ans, coordinatrice de programmes pour Intersos au Yémen du Nord. «La joie de se réveiller le matin et de savoir que tu fais quelque chose de grand, te permet de supporter un fort compromis: ne pas voir grandir une nièce, à part en vidéo; voir les années qui passent pour tes parents et ne pas avoir de souvenirs, si ce n’est celui d’un coup de téléphone sur Skype ou WhatsApp. Quand, à 25 ans, j’ai dit à mes parents “je vais en Palestine”, cela a été une tragédie. Comme chaque communication d’un nouveau travail, d’un nouveau lieu. Je cherche à adoucir cet état de chose tous les jours et cela fonctionne assez bien, parce qu’ils me voient sereine: tu perds beaucoup de choses de la vie normale, mais il y a cette vie anormale qui te donne tellement».
Cette vie anormale a commencé en 2010; quand Stella, de Melzo, aux environs de Milan, est partie au Moyen-Orient: quatre ans en Palestine, puis la Jordanie, l’Irak, le Liban. «Depuis mars 2018 je suis au Yémen. Tout d’abord à Aden, dans le Sud, où je m’occupais d’un projet de protection s’adressant aux personnes déplacées yéménites. Depuis février, à Sana’a, la capitale de la région qui depuis 2015 est contrôlée par le gouvernement de facto des milices houthis». Depuis cinq ans, le Yémen est dévasté par une guerre qui l’a divisé en deux: «Au Sud, il y a le gouvernement sunnite de Hadi internationalement reconnu, soutenu par la coalition guidée par l’Arabie saoudite; au Nord, les milices houthis, chiites. Ensuite, il y a d’autres factions dans d’autres zones, avec lesquelles nous les opérateurs humanitaires, nous devons dialoguer. Chacun a ses règles et impose ses restrictions, c’est très compliqué».
Intersos Yémen est une mission gérée uniquement par des femmes. «Du chef de mission Evelyn, à toutes les coordinatrices: Chiara et moi, programmes Sud et Nord, Luma, ressources humaines, Loubna, protection. Nous sommes des femmes fortes, qui ont choisi une vie différente, en première ligne; qui trouvent leur satisfaction en utilisant leurs capacités là où cela est nécessaire, en se mettant au service de ceux qui en ont le plus besoin». Et ici 24 millions de personnes, 80% des habitants, ont besoin d’assistance humanitaire. La malnutrition tue plus que les bombes, disent les analystes d’Intersos: presque 16 millions de personnes, plus de 53% de la population, sont dans une condition d’«insécurité alimentaire sévère» et l’on prévoit qu’en 2020, le nombre d’enfants de moins de cinq ans victimes de «malnutrition sévère moyenne» aura dépassé un million 900 mille, alors qu’il y aura plus de 325 mille enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. «La faim au Yémen est un problème historique, il y a beaucoup de zone reculées où l’on satisfait les besoins de base et rien de plus, et parfois même pas ceux-ci de manière appropriée», explique Stella Pedrazzini. «La situation est dévastatrice, tragique, elle ne concerne pas que les enfants, mais aussi les femmes, les hommes, les personnes âgées. L’accès à la nourriture était déjà limité avant la guerre».
Les projets que Stella coordonne, concernent l’assistance médicale et nutritionnelle, la protection des réfugiés et des migrants, l’accès à l’éducation et les cours de formation professionnelle, l’assistance psychologique et la protection des catégories les plus vulnérables, des interventions Wash, un acronyme pour dire eau, santé et hygiène. «En ce qui concerne la malnutrition, nous exerçons une activité de base à travers des équipes mobiles ou à travers le soutien aux divers types de structures sanitaire sur le territoire. Le paquet va du screening maternel et des enfants pour l’identification des cas aiguës sévères et aiguës moyens, jusqu’à un réseau de coordination avec d’autres organisations ou institutions gouvernementales, qui proposent des services de traitement à travers les Centres de nutrition thérapeutique et, quand cela sert, l’hospitalisation».
Mais ensuite, on revient au quotidien et il est très difficile de sortir du cercle de la faim. «Une partie importante de notre intervention est de rendre la dignité aux personnes, de leur donner la capacité de subvenir à leur famille et à eux-mêmes. Nous tentons de donner des réponses intégrées à travers la protection des victimes d’abus, l’accès aux soins médicaux, l’organisation de cours de formation pour exercer des activités qui permettent d’avoir des entrées, l’éducation et la conscience alimentaire. Nous promouvons les bonnes pratiques d’alimentation et d’allaitement, car les femmes n’ont personne qui le leur enseigne ou qui suive leur grossesse; elles engendrent souvent des enfants frappés de malnutrition, elles n’ont pas de lait pour les nourrir ou ne savent pas le gérer». Quoi qu’il en soit, «dans des familles de 10/15 enfants, il est difficile de pourvoir à une alimentation correcte: on tente surtout de conserver la force de l’homme qui doit aller travailler». Mais il n’est pas dit que cela signifie rapporter de l’argent à la maison: «Il existe la plaie sociale du qat, une plante hallucinogène qui a remplacé les plantations de café qui faisaient la célébrité du Yémen. Un travailleur journalier réussit à gagner une dizaine de dollars (dans le bâtiment, le transport de matériaux, le nettoyages, le lavage de voitures…) qui ne finissent pas toujours par être dépensés pour les besoins de la famille: ils sont plutôt investis dans une portion de qat. C’est un marché légal, un rituel social; tous les accords, les affaires entre hommes, même les rencontres dans les ministères ont lieu en mastiquant du qat».
Les cours, le travail, la vie sociale, tout a été bouleversé par le coronavirus et par les mesures de distanciations. Si l’on considère que la malnutrition mine le système immunitaire et multiplie de manière exponentielle, surtout chez les enfants, la possibilité de contracter des infections mortelles et que la guerre a détruit 49% des structures sanitaires, on peut attendre des résultats catastrophiques des infections et des pandémies. Et il ne s’agit pas seulement du coronavirus: «Choléra, dengue, malaria, diphtérie sont présents dans le pays, revenant par vagues saisonnières. Cette année est également réapparue la H1N1», surnommée la peste porcine. Le tout sous les bombes, avec des trêves déclarées à plusieurs reprises et ensuite violées. Pourtant, raconte Stella, «quand la possibilité s’est présentée de prendre le dernier vol qui sortait du Yémen, avant la fermeture pour le virus, ma mère, de la Lombardie au sommet de l’épidémie, m’a dit: “mais non, reste là-bas, c’est plus sûr”». Ce qui rend les choses encore plus dures: «On ne s’habitue jamais à l’éloignement de la famille et si tu n’as pas une limite temporelle, un objectif, c’est plus compliqué».
Elle ne renonce cependant pas au projet d’avoir une famille à elle, du moment que cela ne la détourne pas de la mission de la vie. «J’ai vu beaucoup de familles naître, mais rester dans le secteur. Un homme et une femme qui ont des exigences et des passions en commun, qui se rencontrent, se marient, ont des enfants et vont travailler dans des zones classées Family Duty Stations: Liban, Jordanie, de nombreuses parties de l’Afrique, des pays dans lesquels on ne fait pas d’assistance, mais du développement et où il est donc normal d’avoir une famille. Evidemment pas le Yémen, on ne vient pas ici avec des enfants».
Se déplacer ne serait pas un problème, et jusqu’à aujourd’hui elle considère avoir de la chance. «Je vois le Moyen-Orient comme une seconde maison, je me suis toujours sentie accueillie, j’ai trouvé des personnes merveilleuses et une culture merveilleuse. A présent, cette vie me semble le sommet de mes aspirations; mais trouver la personne juste et avoir une famille un jour est une idée qui m’appartient… Je viens d’une petite ville, ma mère me dit toujours: on ne peut pas être heureux tout seul, comment peux-tu être heureuse? Mais je lui réponds qu’on n’est pas forcément heureux à deux. Lorsqu’on est autant au contact de la misère et de la souffrance, chaque jour est une bénédiction. Les choses à trop long terme me font peur. Ma vie est faite de contrat en contrat, d’année en année. La chose qui compte est d’être en paix avec soi-même».
Federica Re David









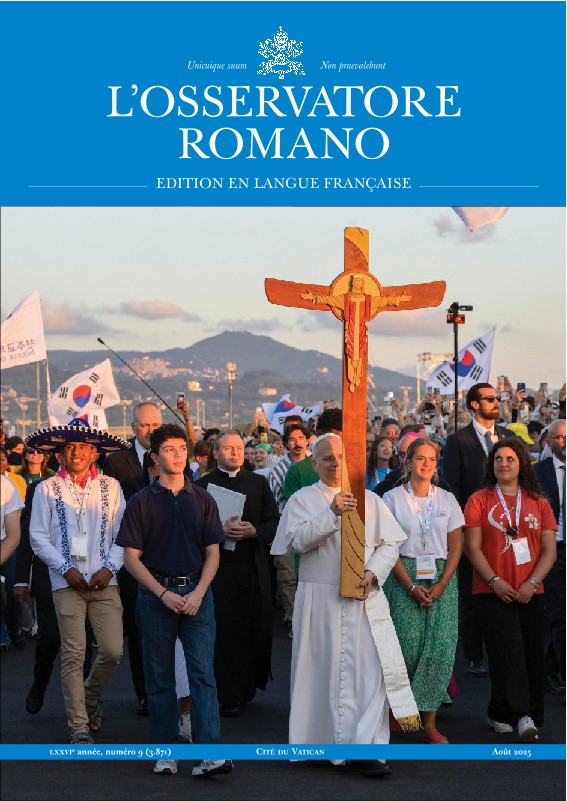



 Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
Achetez ici l'Encyclique Fratelli Tutti
